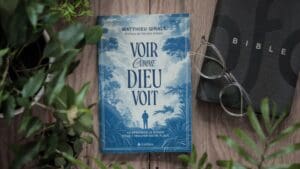Les « Lettres pour notre temps » transcription moderne des épîtres de Paul par Alfred Kuen vont avoir une suite sous la forme d’un deuxième volume : « Messages pour notre temps » qui contiendra l’épître aux Hébreux, les épîtres catholiques et l’Apocalypse.
Nous reproduisons ci-dessous le début de l’introduction à l’une de ces épîtres, l’épître aux Hébreux, cet écrit à certains égards mystérieux et au sujet duquel les croyants se posent bien des questions.
1. Une épître entourée de mystères
Contrairement aux grandes épîtres de Paul, un mystère impénétrable entoure l’origine et les circonstances de rédaction de l’épître aux Hébreux. Après dix-neuf siècles de recherches, son auteur et ses destinataires restent inconnus.
Aussi fut-elle longtemps ignorée, puis contestée. Après avoir été appréciée et citée par les premiers écrivains chrétiens post-apostoliques, elle disparaît pendant plus d’un siècle de l’Église d’Occident. Lorsqu’elle reparaît au IIIe siècle, après avoir connu la faveur de l’Orient, on lui dénie la canonicité. L’anonymat de son auteur et l’absence de toute référence à une autorité apostolique la desservent. Son attribution à Paul, trop visiblement démentie par la différence de style et de mode de pensée, ne contribue guère à améliorer sa position. Aussi, n’est-ce qu’au début du Ve siècle, qu’elle sera définitivement admise dans le recueil des Saintes Écritures.
Généralement, nous ne portons pas beaucoup d’intérêt à une introduction aux livres bibliques. C’est comme s’il fallait absorber d’abord une préface ennuyeuse avant de pouvoir se lancer dans la lecture d’un roman passionnant.
« Nous avons l’impression, écrit W. Neil, que le commentateur éprouve, comme un devoir de conscience, la nécessité d’inclure un certain nombre d’essais sur l’arrière-plan historique, l’identité de l’auteur et des premiers lecteurs, la date de rédaction et les principales idées de chaque livre. Tout cela n’a guère d’importance pour celui qui est préoccupé de trouver le message de la Bible pour nous aujourd’hui. Cependant, dans le cas de l’épître aux Hébreux, de tels raccourcis sont barrés. Nous ne saurions espérer comprendre son message pour le XXe siècle à supposer qu’elle en ait un à moins d’avoir répondu, au préalable, à une ou deux questions, du genre de celles que nous essayons habituellement d’éviter. Si nous commençons en les ignorant allègrement, nous nous retrouverons bientôt en train de patauger dans un marécage de détails s’étendant jusqu’aux mornes plaines du Pentateuque, nous tomberons sur les ustensiles du Temple de Jérusalem, sur des allusions à d’obscurs patriarches, et nous nous retrouverons dans une atmosphère « ultra-Ancien Testament » qui nous paraît plus éloignée de l’Évangile qu’aucun autre écrit de tout le Nouveau Testament [1]» .
Force nous sera donc de nous arrêter un peu plus longuement à ces questions préliminaires. Nous n’aurons guère la prétention de résoudre des problèmes qui restent depuis des siècles en suspens, nous essaierons simplement de faire le point actuel de chaque question et de dégager des données de l’épître, ce qui peut nous aider à mieux la comprendre.
2. Pourquoi l’épître fut-elle écrite ?
L’une des premières questions à élucider est celle du but de l’écrit. C’est en même temps l’une des plus importantes, car de sa réponse dépend, en partie, l’interprétation de l’épître. D’ailleurs, c’est une question relativement facile, car l’épitre elle même y répond.
Les nombreuses exhortations entrecoupant le développement doctrinal, montrent que l’auteur vise un but pratique : il veut encourager ses correspondants à persévérer dans la foi, et les avertir des dangers liés à l’abandon de Christ. Il qualifie, d’ailleurs, son écrit de « parole d’exhortation » ou « d’encouragement » (13 :22). Il exhorte (3 :6 ; 4 :14 ; 6 :11-12 ; 10 :23-25 ; 12 :12-13), avertit et menace (2 :1- 4 ; 3 :7-19 ; 4 :1-11 ; 12 :29). Tantôt il fait des reproches (5 :11-14), tantôt il loue ses correspondants pour leur persévérance (6 : 9-10 ; 10 : 32-34) ; il stimule leur espérance (10 :19 et 36-39) par la perspective de l’avenir glorieux qui attend ceux qui demeurent fermes dans la foi (11 :13-16 ; 12 :22-28).
Il oppose constamment ce que les destinataires de l’épître sont actuellement à ce qu’ils ont été et à ce qu’ils devraient être ; il leur dépeint aussi ce qu’ils sont en danger de devenir. Ils sont paresseux (5 :11 ; 6 :12) et découragés (12 :3, 12). Leur enthousiasme initial pour la foi n’est plus qu’un lointain souvenir (3 :6, 14 ; 4 :14 ; 10 :23, 35). Au lieu de progresser dans la compréhension des vérités profondes de la foi (5 :12-14), ils ont tendance à se laisser entraîner par des doctrines nouvelles et étrangères (13 :9). Ils font l’église-buissonnière (10 :25) et n’obéissent plus aux conducteurs de leur Église (13 :17). Aussi risquent-ils d’être emportés loin de ce qu’ils ont entendu (2 :1), d’abandonner la foi (3 :12 ; 10 :26) et de passer à côté des promesses divines (4 :1). Ils sont aussi découragés et troublés par les persécutions qu’ils subissent.
Pour secouer leur apathie spirituelle, l’auteur ne se contente pas d’exhortations directes, il leur donne un enseignement solide concernant Jésus-Christ, souverain sacrificateur de la Nouvelle Alliance « dont la foi dépend du commencement à la fin ». (12 :2).
Il insiste sur la transcendance de sa personne et de son œuvre, sur la supériorité de la Nouvelle Alliance par rapport à l’Ancienne (le mot « meilleur » revient 13 fois :1 :4 ;6 :9 ;7 :7, 19, 22 ; 8 :6 ; 9 :23 ; 10 : 34 ; 11 :16, 35, 40 ; 12 :24) et sur le caractère céleste de la révélation chrétienne. Il explique à ses lecteurs que les sacrifices sont abolis, que la prêtrise lévitique est dépassée et que le culte matériel a été remplacé par un culte spirituel. Il les exhorte à « sortir du camp » (13 :13). De quel camp ? Si nous savons qu’ils étaient tentés d’abandonner la foi chrétienne, nous ignorons par quoi ils étaient attirés ou vers quoi ils risquaient de revenir.
3. A qui l’épître fut-elle envoyée ?
Plusieurs thèses ont été échafaudées pour identifier les correspondants inconnus de notre auteur anonyme : Juifs convertis ou anciens païens ? Était-ce un groupe de sacrificateurs devenus chrétiens, des Esséniens, anciens disciples de la communauté de Qumrân venus au christianisme, ou des Juifs qui auraient embrassé le christianisme, parce qu’ils y auraient vu une sorte de Judaïsme amélioré, mais n’auraient pas compris la portée universelle de la foi chrétienne ?
Essayons, d’après les données de l’épître, de circonscrire les caractéristiques de ces destinataires.
1) C’étaient des Juifs convertis [2]:
a) « Après avoir autrefois et de bien des manières, parlé à nos pères par les prophètes » (1 :1). D’emblée, l’auteur semble supposer que les destinataires faisaient partie, comme lui, du peuple élu.
b) L’auteur fait constamment appel aux Écritures : elles constituaient donc, pour les destinataires, une autorité de référence, même dans leur ancienne religion dans laquelle ils étaient tentés de retomber.
c) Il évoque de nombreux personnages de l’Ancien Testament (Abraham, Melchisédek, ainsi que tous les héros de la foi cités au chap. 11), qui doivent être familiers aux lecteurs : leur histoire n’est pas rapportée en détail car elle est supposée connue. Seuls, des Juifs pouvaient avoir une telle connaissance à une époque où la lecture privée des Écritures n’était guère répandue.
d) Il suppose également connues les cérémonies du culte juif.
e) Il présente l’Ancienne Alliance comme dépassée, remplacée par une nouvelle, par celle que les prophètes avaient promise. Cet argument, surtout, a de la valeur pour des Juifs tentés de retomber dans l’ancien ordre des choses. Il en est de même des références au temple spirituel remplaçant le temple matériel et à la sacrificature selon l’ordre de Melchisédek opposée à celle selon l’ordre d’Aaron. Cette dernière est censée, acceptée comme institution divine par les lecteurs (7 :11).
f) L’allusion à la postérité d’Abraham (2 :16), l’exhortation à sortir du camp (13 :13) se comprennent mieux si les destinataires sont d’anciens Juifs.
g) Le Messie souffrant n’était en scandale qu’aux Juifs.
h) La suscription « Aux Hébreux » ne figurait évidemment pas sur l’original, mais elle est assez ancienne. Elle apparaît dans les manuscrits dès le dernier quart du IIe siècle. Elle reflète l’impression de l’éditeur qui a vu, dans cette épître, un écrit adressé à des Juifs convertis, peut-être plus précisément à des Juifs qui partageaient les points de vue des Hébreux, c’est-à-dire, du groupe juif parlant l’hébreu, pensant hébreu, opposé aux Hellénistes, parlant grec, et influencés dans leur manière de penser par la philosophie judéo-grecque d’Alexandrie. L’écrit lui-même se rattache plutôt au courant hellénistique, mais les tendances de l’auteur ne doivent pas nous faire présumer celles des destinataires.
2) C’était une église particulière :
L’épître n’est pas une « encyclique » (comme 1 Pierre ou Jacques) ou une lettre circulaire (comme probablement Éphésiens) s’adressant à tous les Juifs convertis. L’auteur écrit à une communauté précise qui lui est familière (13 :19), elle a un passé commun (10 :32 ; 12 :4) et une même attitude actuelle (10 :33-34). Il connaît les circonstances de leur conversion (2 :3), la manière dont ils ont démontré leur foi (6 :10), leurs dispositions intérieures présentes et leurs besoins particuliers (5 :11 SS ; 6 :9 ss ; 13 :17). Il pense leur rendre visite (13 :19, 23) et demande leurs prières (13 :18).
3) C’était une fraction d’une église plus grande :
L’auteur leur demande de ne pas abandonner les assemblées de l’église (10 :25), de se soumettre à leurs conducteurs (13 :17), de les saluer ainsi que tous les saints (13 :24). Ils constituaient, sans doute, une « église de maison » comme il en existait plusieurs à Rome (Romains. 16 :5, 14, 15) et qui manifestait quelques tendances séparatistes. Ils pourraient « depuis longtemps enseigner les autres », vu sans doute, leurs connaissances scripturaires d’avant la conversion, mais ils sont restés à un niveau spirituel élémentaire (5 :11-6 :12).
4) C’était un groupe à tendances particulières :
Les allusions aux anges (2 :1-5), à certaines pratiques ascétiques (13 :9), à des prescriptions alimentaires (13 :9) et rituelles (9 :10) ont fait penser qu’il s’agissait de Juifs ayant subi l’influence d’un enseignement particulier, plutôt non-conformiste.
Après la découverte des manuscrits de la Mer morte, certains spécialistes ont émis l’hypothèse que les destinataires seraient d’anciens membres de la secte de Qumrân qui, en devenant chrétiens, auraient gardé certaines de leurs idées. La théorie semble aujourd’hui abandonnée (voir ci-après note complémentaire : Les « Hébreux » anciens membres de Qumrân ?).
Peut-être, alors, ces « Hébreux » étaient-ils des gens qui ne voyaient dans le christianisme qu’un judaïsme amélioré, et en Jésus, un prophète dans la lignée de ceux de l’Ancien Testament. Cela expliquerait l’insistance de l’auteur sur la grandeur unique de Jésus-Christ. Ils semblent n’avoir pas encore vraiment rompu avec le judaïsme qui leur accordait le statut de « religion licite » dans l’Empire romain. Ils se rapprochaient donc des Hébreux de Jérusalem et des « judaïsants », avec lesquels l’apôtre Paul était si souvent aux prises. Ils voyaient tout ce qu’ils perdaient en quittant le judaïsme, mais non ce qu’ils gagnaient en embrassant pleinement la foi chrétienne. On a pensé, également, qu’ils refusaient d’entrer dans la perspective d’une portée universelle de la foi chrétienne [3] (voir, ci-après, note complémentaire : Un groupe judéo-chrétien « conservateur » ?).
4. Un message pour notre temps ?
En inspirant à un auteur inconnu, cette lettre d’exhortation, le Saint-Esprit a pensé aussi aux besoins des chrétiens de tous les temps, de notre temps. Nous ne descendons peut-être pas d’ancêtres Israélites et pourtant nous ressemblons par plus d’un côté à ces « Hébreux » à qui s’adresse l’épître. Ne sommes-nous pas, nous aussi, facilement découragés, tentés de nous contenter des « rudiments » de la foi ou même de retourner à « la religion de nos pères », c’est-à-dire au paganisme qui, de plus en plus, s’affirme comme la religion la mieux adaptée à l’homme naturel, celle vers laquelle il revient chaque fois qu’il rejette le masque de la chrétienté.
Au lieu de faire l’effort nécessaire pour progresser dans la sanctification « sans laquelle nul ne verra le Seigneur » (12 :14) et accéder ainsi à une connaissance plus profonde de Jésus-Christ, nous en restons, comme les Hébreux, à un stade infantile, et, comme « des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine », nous risquons de nous laisser séduire par des théories nouvelles qui n’ont aucun fondement dans les Écritures.
L’épître aux Hébreux nous rappelle avec force que nous n’avons besoin ni d’un enseignement nouveau, ni de pratiques ascétiques ou ésotériques, mais d’une meilleure connaissance de Jésus- Christ « de qui notre foi dépend du commencement à la fin » (12 :2), et des grâces « meilleures » qu’Il nous accorde dans la communion avec Lui.
NOTES COMPLÉMENTAIRES
Sans entrer dans le détail de toutes les hypothèses soulevées par le problème de l’identité des destinataires de l’Épître, voici quelques précisions sur deux de ces hypothèses qui ont attiré plus spécialement l’attention des spécialistes.
Les « Hébreux », anciens membres de Qumrân ?
C’est Y. Yadin qui, le premier, a lancé l’hypothèse dans un article de la Scripta Hierosolymitana (n° 4, 1958, pp. 36-53). Sa « percée fantaisiste » (Grässer) trouva de nombreux soutiens : Spicq, Flusser, J. Daniélou, K. Schubert, Schnackenburg, J. Betz et K. H. Schelkle. Aujourd’hui, la piste semble définitivement abandonnée, depuis que J. Coppens (Les affinités qumrâniennes de l’épître aux Hébreux Nouvelle revue théol. 94, 1962, pp. 128- 141 et 257 et 282) et F. F. Bruce (« To the Hebrews » or « To the Essenes ? » New Test. Studies 9, 1962-63, pp. 217- 232) ont démontré la fragilité des arguments avancés. H. K. Schelkle, l’un des avocats primitifs de la thèse, écrit dans son Introduction au N.T. (Salvator Muhl., 1965, p. 23) : « Les opinions soutenues dernièrement, d’après lesquelles l’épître était adressée à d’anciens membres de la communauté de Qumrân devenus chrétiens, ne sont pas suffisamment fondées ».
Voir E. Grässer: Der Hebräerbrief, 1938-1963 in Theol. Rundschau n° 30, (1964), pp. 138-236; Feine, Behm, Kümmel: Einleitung in das N.T. (Heidelberg 1964), p. 288. On a prétendu que Melchisédek était un personnage très vénéré à Qumrân, mais Herbert Braun, un spécialiste des études qumrâniennes, affirme : « La communauté de Qumrân n’avait manifestement aucun intérêt pour Melchisédek» (Qumrân u. das N.T. Theol.Rundsch., 1964, p. 20). Dans un commentaire récent, O. Kuss dit qu’« au début, on avait fondé de grands espoirs sur les écrits de Qumrân pour éclaircir les problèmes posés par l’épître aux Hébreux. Ces espoirs ont été déçus… On ne peut affirmer qu’il y ait eu une relation entre l’épître et Qumrân ou les gens de Qumrân, encore moins qu’il y ait une dépendance quelconque » (Der Brief an die Hebräer, Regensburg, 1966, p. 19).
Un groupe judéo-chrétien « conservateur » ?
Dans les Baird Lectures 1949, William Manson a émis une nouvelle théorie qui a connu un vif succès (voir The Epistle to the Hebrews, Hodder and Stoughton, London 1951), selon laquelle les destinataires seraient des Juifs convertis qui s’opposeraient à la mission mondiale du christianisme [4]. L’auteur, un chrétien de la lignée d’Étienne, utiliserait son équipement théologique et dialectique d’ancien Juif helléniste pour convaincre ces gens qui se contentaient d’un niveau « sous-chrétien ». Manson démontre, à partir des passages exhortatifs, puis des développements théologiques, que :
- L’auteur se situe sur la ligne d’Étienne, exaltant Jésus au-dessus de la loi et du culte juif.
- Les destinataires constituaient un groupe minoritaire dans une église. Ce groupe n’a pas compris la signification de la loi dans la prêtrise et dans le sacrifice de Christ. Il est en train de perdre la force et la pureté de son espérance.
- C’est un groupe judéo-chrétien conservateur, attaché à la Loi, à la prêtrise et aux sacrifices lévitiques ainsi qu’aux cérémonies du culte juif.
- L’épître ne combat aucune erreur gnostique ou hellénistique. L’auteur leur demande de ne pas regretter un passé dépassé, mais de se lancer, avec une entière confiance en Dieu, dans l’évangélisation du monde.
Cependant, D. Guthrie (New Testament Introduction, Tyndale Press, 1962, pp. 35 ss.) fait remarquer avec justesse que, si tel était le seul danger qui guettait les Hébreux, on ne comprendrait pas les paroles sévères de l’auteur (6 :6 ; 10 :29) concernant les conséquences de l’apostasie.
[1] « W. NEIL. « The Epistle to the Hebrews » (S.C.M. London, 1959), p. 13.
[2] C’est la thèse traditionnelle. Depuis 1836, cependant, un certain nombre d’exégètes ont défendu l’idée que l’épître aurait été adressée à des chrétiens issus du paganisme. C’est pourquoi, nous donnons ici en détail, un certain nombre d’arguments en faveur de la thèse traditionnelle qui semble regagner du terrain, surtout depuis la publication des travaux de W. MANSON (1952).
[3] Après avoir fait le point de la question, F. F. BRUCE déclare : « On peut dire tout au plus à ce sujet, que les destinataires étaient probablement des Juifs croyants en Jésus, dont l’arrière-plan était moins le judaïsme normatif représenté par la tradition rabbinique que le judaïsme non-conformiste dont les Esséniens et la communauté de Qumran étaient des représentants éminents, mais nullement les seuls témoins ». (The Espitie to the Hebrews, Eerdmans Publ., Grand Rapids, 1964).
[4] La thèse a été reprise par W. NEIL (The Epistle to the Hebrews, S.C.M., London 1955 et 1959) qui en fait « la clé de l’épître » et par Th. HEWITT (The Epistle to the Hebrews, Tyndale Press, London 1960).
Ichtus N°42- Avril 1974 – Page 8 à 12