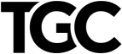Y a-t-il dans l’Ecriture des écrits inauthentiques ? C’est ce que tiennent pour avéré la plupart des critiques.
Alfred KUEN nous montre que leurs arguments sont loin d’être aussi décisifs qu’on le pense. Face à une exégèse trop sûre d’elle, l’autorité de l’Ecriture reste intacte.
Œuvres authentiques et falsifications
Une œuvre artistique ou littéraire est authentique lorsqu’elle émane effectivement de l’artiste ou de l’auteur dont elle porte la signature. Dans tous les domaines de l’activité créatrice, les faux abondent. Leurs qualités esthétiques ou littéraires ne sont pas nécessairement inférieures à celles des œuvres qu’ils imitent. Les faux Vermeer fabriqués par Van Meegeren ont suscité autant d’admiration que les véritables œuvres de l’artiste. Il n’y a problème que sur le plan financier et moral. La cote d’un Rembrandt variera plus que du simple au centuple si l’on passe du faux à l’authentique. Pourquoi ? Orgueil de posséder un original ? Sentiment de sécurité ? « Aucune des théories de l’art aujourd’hui reçues ne rend compte de notre relation avec le faux… le sentiment que nous éprouvons devant la falsification est plus complexe que le dédain : c’est le malaise ». (A. Malraux[1]).
Ce malaise est plus fort devant une œuvre littéraire, surtout si elle a quelque prétention morale ou simplement moralisante. Il est à son comble lorsqu’il s’agit d’un écrit religieux qui donne des conseils d’ordre spirituel au nom d’un homme de Dieu mort depuis longtemps. Or, dans la littérature apocalyptique juive, des hommes ont écrit sous le nom d’Hénoc, de Moïse ou de Salomon. Au IIe siècle, on a composé un Evangile, des Actes et une Apocalypse au nom de Pierre, ainsi que bien d’autres œuvres pseudonymes. « Il faut se poser la question, dit Arnold Meyer, qui a étudié le problème éthique et psychologique soulevé par la littérature pseudonyme religieuse, comment des gens qui, manifestement, prenaient les questions de vérité très au sérieux, qui, à tout moment étaient exposés à mettre leur vie en jeu pour elles et qui étaient effectivement prêts à le faire pouvaient affirmer l’authenticité des écrits qu’ils composaient au nom des apôtres [2]. »
Des faux dans notre Bible ?
Le problème est encore plus aigu et nous touche tous de près lorsqu’on nous affirme que notre Bible elle-même contiendrait des « faux » et que bon nombre des épîtres du Nouveau Testament auraient été composées par des chrétiens inconnus sous le nom d’un apôtre défunt.
Les premières théories pseudépigraphiques naquirent au XVIIIe siècle, dans le sillage du rationalisme. F. Schleiermacher lança l’attaque contre 1 Timothée, suivi bientôt par F.C. Baur qui estima que « si une des épîtres de Paul pouvait être inauthentique, beaucoup d’autres pouvaient l’être ». Un de ses disciples, Bruno Bauer, en arriva à rejeter l’authenticité de l’ensemble des épîtres pauliniennes ! La critique actuelle est revenue à des vues plus raisonnables ; cependant, la plupart des théologiens, même positifs, maintiennent l’origine pseudonyme de certaines épîtres de Paul (Ephésiens, 1 et 2 Timothée, Tite) et de plusieurs des épîtres « catholiques » (Jacques, 1 et 2 Pierre, Jude, 1, 2, 3 Jean). Il serait, par exemple, difficile de trouver, dans la littérature théologique de langue française, un livre défendant l’authenticité de la deuxième épître de Pierre. La cause de cet écrit paraît définitivement jugée : « L’exégèse, tant protestante que catholique, tient pour un résultat certain de ses recherches que l’épître ne provient pas de l’apôtre Saint-Pierre, mais est un écrit pseudépigraphique » (Schelkle[3]).
« L’Epître ne peut pas être de Pierre » (W. Fôrster[4]) « Dans les temps modernes s’est introduite chez les exégètes catholiques l’idée que cette épître ne peut pas provenir de Pierre » (O. Knoch[5]).
Faut-il donc nous résigner à voir, dans certains livres de notre Bible, des faux composés par des admirateurs trop zélés des apôtres, et admis dans le canon des Ecritures à la faveur d’une crédulité excessive des Pères de l’Eglise ? Pourrions-nous, dans ce cas, maintenir notre confiance dans ce qui nous est présenté comme Parole de Dieu, inspirée par l’Esprit Saint et transmise, selon la volonté de Dieu, comme testament authentique de sa révélation ?
Une question accessoire ?
On nous dit : « Peu importe que la lettre soit de Pierre ou de Paul ou d’un illustre inconnu, l’essentiel est que Dieu s’adresse à nous dans ces pages ». On peut se demander si ceux qui parlent ainsi lisent effectivement ces lettres, et, dans ce cas, s’ils sont convaincus de leurs arguments. En effet, lorsque nous lisons : « Je sais bien que je quitterai (cette vie) subitement, ainsi que notre Seigneur Jésus-Christ me l’a fait connaître, mais j’aurai soin qu’après mon départ vous puissiez toujours vous souvenir de ces choses. Ce n’est pas, en effet, en suivant des fables que nous vous avons fait connaître la puissance et l’avènement de notre Seigneur Jésus-Christ, mais c’est comme ayant vu sa majesté de nos propres yeux… nous avons entendu cette voix venant du ciel lorsque nous étions avec lui sur la sainte montagne » (2 Pierre 1.14-18), où: « Ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé et que nos mains ont touché concernant la parole de vie (c’est- à-dire Jésus-Christ)… nous vous l’annonçons » (1 Jean 1.3), pouvons-nous prétendre que l’identité de celui qui fait de telles affirmations n’ajoute ou n’enlève rien à la valeur de sa parole ? Quel prédicateur oserait, sans vergogne, commenter ces textes en demandant à ses auditeurs une entière obéissance à cette « parole de vérité » (Jacques 1.18), rédigée par le chrétien inconnu qui voulait se faire passer pour l’apôtre Pierre ou l’apôtre Jean ? Il est bien évident, ainsi que le reconnaît Albert E. Barnett, qu’«il existe une relation intime entre la vérité concernant l’auteur qui a rédigé un écrit et l’autorité de la vérité dans le christianisme[6] ».
A la rigueur, nous pourrions contrairement d’ailleurs à la conviction de l’Eglise ancienne donner la même valeur à la parole d’un chrétien inconnu qu’à celle d’un apôtre ou de son porte-parole autorisé. Mais, lorsqu’une lettre est signée et authentifiée par des détails biographiques, pouvons-nous lui accorder le même crédit si elle émane de l’auteur qui se nomme ou si elle provient de l’un de ses admirateurs qui veut se faire passer pour lui ?
La pseudonymie : une convention littéraire antique ?
On nous dit aussi que si le fait de composer un écrit sous un pseudonyme nous déroute, il ne choquait personne dans l’antiquité, car c’était alors une pratique littéraire courante. Les «pseudépigraphes », c’est-à-dire les auteurs écrivant sous un pseudonyme, pensaient honorer le personnage auquel ils attribuaient leur ouvrage. On est même allé jusqu’à prétendre que la pseudonymie était la règle et n’avait pas besoin d’être justifiée : c’est le contraire, c’est-à-dire le cas d’un auteur écrivant sous son vrai nom, qu’il fallait expliquer[7].
Différents auteurs ont soumis, ces dernières années, l’ensemble de la littérature pseudonymique de l’antiquité à un examen détaillé pour découvrir les mobiles psychologiques de leurs auteurs[8]. Les conclusions de ces recherches sont loin de confirmer l’axiome admis universellement par les critiques comme justifiant moralement la pseudépigraphie. Déjà Torm avait qualifié l’idée que la pseudonymie était une convention littéraire, d’« invention moderne que l’on voulait rendre probable par la masse des écrits pseudonymes et la crédulité du temps, mais que l’on ne saurait étayer par des arguments historiques véritables ». Après avoir analysé l’ensemble des écrits pseudonymiques de l’antiquité païenne et juive, J. Sint déclare : « On a souvent répété que la pseudonymie était une « coutume littéraire commune » de l’antiquité. Cette affirmation a été acceptée comme une évidence que personne n’a mise en doute. Or, l’ensemble des documents examinés prouve très clairement qu’une telle affirmation est non seulement une manière de parler très vague et creuse qui ne dit rien et n’explique rien, mais que, dans sa généralité indifférenciée, elle est tout à fait fausse ». D. Guthrie aboutit aux mêmes conclusions concernant la littérature chrétienne : « Il n’y a aucune preuve, dans la littérature chrétienne, de l’idée d’une fiction littéraire conventionnelle par laquelle un auteur aurait publié ses productions sous un autre nom parce que telle aurait été la coutume littéraire, et cela avec la pleine approbation du cercle de ses lecteurs [11] ». « Il n’existe aucun document chrétien de valeur écrit par un pseudépigraphe utilisant le nom d’un apôtre ». (Dods[12])
Personne, en particulier, ne saurait prouver que l’Eglise chrétienne ait admis qu’un écrit notoirement pseudonyme pût être inspiré de Dieu. « Ou bien il était accepté comme étant de l’auteur dont il portait la signature, ou bien il était rejeté comme imposture [13] ». Si donc la critique pouvait démontrer péremptoirement qu’un écrit est pseudonyme, « il faudrait l’exclure du canon des Ecritures ». (D. Guthrie [14])
La pseudonymie : vérité démontrée ou axiome ?
A-t-on démontré de façon irréfutable la pseudonymie d’un seul écrit néotestamentaire ? Si oui, on peut, à bon droit, suspecter n’importe quel autre d’être inauthentique, car une fois le principe admis, il n’y a aucune raison de ne pas l’étendre à l’ensemble des livres bibliques.
A quel moment pourrions-nous parler de preuve irréfutable ? Il suffirait de trouver, dans un de ces écrits, une allusion indiscutable à un événement historique postérieur à la mort de l’auteur (par exemple, à la destruction du Temple de Jérusalem dans une lettre signée de Pierre ou de Paul), une citation indubitable d’un auteur post-apostolique (Clément, Ignace, la Didaché…), l’emploi d’un terme dont la naissance remonte au 2e siècle ou la mention d’une hérésie apparue de toute évidence après la période apostolique. Il ne faudrait qu’un seul mot pour trahir l’auteur d’un faux, une seule ignorance ou un petit oubli. Et pourtant, on est toujours à la recherche de ce mot, de ce « traître » révélateur ; tous ceux qu’on a présentés jusqu’à présent se sont révélés être de faux « traîtres » ou, du moins, des « traîtres » peu probants. En effet, si l’on avait découvert une preuve absolue d’inauthenticité, serait-il encore nécessaire d’aligner ces nombreux arguments stylistiques et théologiques destinés à impressionner par leur masse, mais qui, pris isolément, ne font pas le poids, comme l’avouent leurs protagonistes eux-mêmes ?
Prenons, par exemple, l’un des arguments essentiels invoqués contre l’authenticité : la différence de style. Peut-il être concluant ? En premier lieu, souvenons-nous que pour aucun des auteurs en question, le grec n’était la langue maternelle. Ils se servaient donc souvent, comme ils l’avouent eux-mêmes (1 Pierre 5.12), de secrétaires interprètes auxquels ils pouvaient laisser une assez grande liberté dans la formulation de leur pensée. Ces secrétaires pouvaient changer d’un écrit à l’autre, ce qui explique déjà une certaine variété dans l’usage des termes.
D’autre part, on a montré, ces dernières années, le caractère subjectif et aléatoire des critères appliqués jusqu’à présent en matière stylistique[15]. Généralement, on relève le nombre de mots rares différant d’un écrit à l’autre ; mais il ne faut pas sous-estimer l’influence du sujet traité, de l’arrière-plan historique et culturel, des expériences et acquisitions personnelles, sur le choix des mots. « La tendance générale fut d’étudier les mots rares porteurs de la qualité littéraire et du sens, mais d’ignorer les mots courants qui représentent nos habitudes personnelles ». (A.Q. Morton[16]) Or, on a démontré, en analysant scientifiquement la répétition des mots les plus usuels de la littérature grecque (le, et, mais, dans, lui-même, etc.), que chaque auteur avait son coefficient de fréquence personnel qui restait constant dans l’ensemble de ses écrits[17]. D’après l’analyse de la fréquence des six mots les plus courants de la langue grecque dans les deux épîtres de Pierre, par exemple, on n’a relevé aucune différence significative entre les deux écrits[18].
On invoque aussi pour 2 Pierre, par exemple, des arguments d’ordre théologique ou historique: disparité avec la pensée et la doctrine de 1 Pierre, hellénismes, relation littéraire avec l’épître de Jude, détails qui semblent exiger une date postérieure : la mention des écrits de Paul, les hérésies combattues et qui porteraient la marque d’une époque postérieure, le passage qui parle « des pères » au passé et qui indiquerait que la première génération chrétienne est dépassée… Examinés de plus près par des spécialistes des sciences bibliques, tous ces arguments se sont révélés fragiles et réfutables : les ressemblances de pensée et de style sont plus nombreuses que les disparités, les prétendus hellénismes ont été découverts chez beaucoup d’auteurs du 1er siècle comme expressions courantes, la relation littéraire avec Jude n’exclut pas l’authenticité. D’autre part, aucun des détails cités plus haut n’exige une date postérieure à la mort de l’apôtre: la mention des écrits de Paul n’a rien d’anormal, Pierre devait les connaître et, d’ailleurs, il n’y a, dans l’épître, aucune allusion à un « recueil » de lettres, les hérésies combattues sont bien celles du milieu du 1er siècle, le passage relatif aux « pères » est peut-être une citation, « les pères » sont, comme partout ailleurs dans le Nouveau Testament et la littérature patristique, les patriarches de l’ancienne alliance. ”
Problèmes insolubles
Par contre, l’hypothèse pseudépigraphique soulève des problèmes historiques, psychologiques et spirituels insolubles auxquels on n’a sans doute pas prêté suffisamment attention. On a beau nous affirmer que l’auteur était de bonne foi, qu’il a simplement « emprunté le nom du grand apôtre pour donner plus d’autorité à son écrit et intervenir plus efficacement contre les faux docteurs » (J. Chaine, p. 30), mais que son procédé ne trompait personne… Passe encore qu’il ait placé son œuvre sous un célèbre patronyme, mais comment justifier les allusions personnelles par lesquelles il manifeste nettement l’intention de se faire prendre pour Pierre ? La littérature pseudépigraphique n’offre aucun parallèle d’une telle épître contenant des indices personnels. Comment expliquer psychologiquement un passage tel que : « Ce n’est pas, en effet, en suivant des fables habilement conçues que nous vous avons fait connaître la puissance et l’avènement du Seigneur Jésus-Christ, mais c’est comme ayant vu sa majesté de nos propres yeux… nous avons entendu cette voix venant du ciel lorsque nous étions avec lui sur la sainte montagne » (1 :16-18) ? Ne serait-ce pas le comble de l’impudence que d’introduire ce mensonge par une affirmation solennelle de la vérité de ses dires ?
Lorsqu’on écrit : « Je sais que je la quitterai subitement (la vie), ainsi que notre Seigneur me l’a fait connaître » (1 :14), peut-on prétendre n’avoir voulu tromper personne ? On a remarqué que les pseudépigraphes ont plutôt évité les allusions personnelles. D’autre part, pourquoi l’auteur adopterait-il cette forme archaïque : Syméon Pierre, trouvée une seule fois dans le Nouveau Testament. Actes 15.14 et nulle part dans la littérature post-apostolique, pourquoi ne s’en serait-il pas tenu à l’adresse de 1 Pierre ? Pourquoi, dans l’ensemble des souvenirs personnels de Pierre, avoir choisi l’épisode de la transfiguration qui ne joue guère de rôle dans la prédication apostolique ? Pourquoi avoir changé la tradition synoptique (omission de Moïse et d’Elie, de « écoutez-le », changement dans l’ordre des mots…), ce qui risquait de rendre son allusion suspecte ? Enfin : pourquoi, au fond, aurait-il écrit cette lettre en la signant d’un pseudonyme ? Généralement, les hérétiques utilisaient le nom d’un apôtre pour propager, sous couvert de l’autorité apostolique, des vues qui n’auraient pas été acceptées venant de leur véritable auteur. Quelles vues trouvons-nous dans cet écrit ? Rien qui ne se trouve déjà ailleurs dans les écrits apostoliques. Si l’auteur voulait mettre les chrétiens orthodoxes en garde contre les hérétiques, qu’il caractérise au chapitre 2, pourquoi ne pas s’être contenté de citer des extraits de Colossiens et 1 Corinthiens ? « En tant qu’écrit pseudépigraphique, cette lettre n’a pas de raison d’être satisfaisante » (Green op. cit. page 37). « Aucun avocat de l’origine pseudonyme de 2 Pierre n’a été capable de rendre compte de manière entièrement satisfaisante du motif de l’auteur » (Guthrie p. 169). Comme l’a montré Bigg, ce serait un faux sans objet,
sans les marques ordinaires des faux, sans ressemblance avec aucun faux connu. D’autre part, « il est presque inconcevable qu’un faussaire, écrivant contre de faux docteurs, écrivant dans l’intérêt de la vérité, ait ainsi délibérément assumé un nom et une expérience auxquels il n’aurait pas droit » (Lumby).
L’admission d’un tel écrit pseudonyme dans le canon des Saintes Ecritures poserait, en outre, des problèmes aussi ardus : comment s’expliquer que l’ensemble des Pères témoins de la constitution des écrits inspirés ait pu se laisser leurrer par un faux, alors que leur vigilance était alertée par toute une floraison de littérature pseudo-pétrinienne et par les doutes au sujet de l’épître ? Comment comprendre, au surplus, que le Saint-Esprit inspire un menteur et fasse admettre son œuvre dans le recueil des Saintes Ecritures ? « Que voilà un singulier Saint-Esprit qui permet à ses porte-parole de pareilles tromperies. De surcroît, quelle injustice dans ce Saint-Esprit, qui foudroie un Ananias et une Saphira pour une question d’hypocrisie sur le plan passager de l’argent, et qui tolère, dans le cadre d’un message révélateur de l’éternelle vérité, des mensonges aussi flagrants ; qui mieux est, les couvre de son autorité, et cela dans un contexte où il est surtout question de vérité et d’avertissement contre les trompeurs ! » (Maurice Ray).
Comparés à ces difficultés, les points d’interrogation de la thèse traditionnelle sont minimes et même si « on ne peut démontrer péremptoirement que Pierre était l’auteur de la lettre », comme « il reste à démontrer qu’il ne l’était pas » et comme « il n’y a rien dans cette épître que Pierre n’aurait pu écrire », le croyant choisit de faire confiance au texte tel qu’il se présente à nous, aux chrétiens des premiers siècles qui y ont reconnu un écrit de l’apôtre Pierre, et au Saint-Esprit qui les a conduits dans leur sélection des livres inspirés.
[1] Voix du silence, p. 370.
[2] A. Meyer : Religiose Pseudepigraphie als ethisch-psychologisches Problem (Zeitschrift für Neutest. Wissensch. Berlin, 1936), p. 266.
[3] Introd. an N.T. (Mulhouse 1965), p. 258.
[4] Dictionary of the Bible (Grant-Rowley, Edinburgh 1963).
[5] La 2e épitre de Pierre (Cerf, Paris 1969), p. 9.
[6] Interprétera Bible (Abington Press, New York) Vol. XII, p. 166. Et pourtant Barnett nie l’authenticité de 2 Pierre !
[7] Kurt Aland: » The problem of anonymity and pseudonymity in the Christian Lit. of the first Centuries” in The authorship and integrity of the N.T. (SPCK London 1965).
[8] F. Torm : Die Psychologie der Pseudonymitat Im Hlnblick auf die Litteratur des Chrlstentums (Gütersloh 1932). Arnold Meyer: Religiôse Pseudepigraphie als ethisch-psychologisches Problem. (Zeitschrift fur neutest. Wlssensch. Berlin 1936, p. 262-279). J. Sint : Pseudonymltat Im Altertum (Universitâtsverlag Wagner, Innsbruck 1960).
[9] Op. Cit., p. 19.
[10] Op. Cit., p. 157.
[11] D. Guthrie: The development of the idea of canonical pseuaepigrapha in NT criticism in” The authorship and Integrity of the NT (SPCK London 1965, p. 38).
[12] Cité par Moorehead: The International Standard Bible Encyclop. IV, 2356.
[13] J. S. Candlish cité par Guthrie (op. clt., p. 32). Voir aussi : Lettres pour notre temps, pp. 330-333.
[14] Op. cit., p. 32 : D. Guthrie cite aussi la conclusion de R.D. Shaw : « Si nous sommes en présence d’un mensonge conscient comme nous croyons que ce serait le cas il faut nous demander : pouvons-nous imaginer, sous la dispensation chrétienne, l’Esprit de vérité et de sainteté utilisant un tel écrivain comme instrument de sa révélation ? Si nous sommes exhortés à éprouver les esprits pour savoir s’ils sont de Dieu, pouvons-nous leur appliquer un meilleur critère ? » (R.D. Schaw : The Pauline Epistles (1913), pp. 477-487).
[15] « Jusque très récemment toutes les tentatives de déterminer l’authenticité d’une œuvre d’après le style étaient personnelles et subjectives ». A.Q. Morton: » The authorship of the Pauline Corpus » in The NT In historical and contemporary perspective (Ox ford 1965), p. 210.
[16] “Statistical Analysis and NT Problems” in The authorship and integrity ot the N.T., p. 45.
[17] Les études, faites à l’aide de l’ordinateur, ont porté sur toutes les œuvres d’Isocrate, d’Hérodote, de Thucydide, Strabon, Xénophon, Plutarque, Aristote, Platon et Démosthène. Elles ont démontré une constance remarquable dans l’usage de ces petits mots pour un auteur donné, mais une grande variabilité d’un auteur à l’autre. Cette constance relève de nos habitudes mentales, de la constitution même de notre esprit. « Les recherches médicales ont montré qu’une habitude commune est littéralement imprimée sur le cerveau humain. Or, dès qu’une habitude s’est établie, le cerveau se décharge de sa fonction de contrôle conscient, comme pour la marche ou la respiration ». (A.O. Morton: The authorship…, p. 210). D’un auteur à l’autre, la fréquence peut varier du simple au quadruple. Par exemple, dans les écrits d’Hérodote, 54 % des phrases ne contiennent aucun kai (et), 6 % seulement en contiennent trois et plus. Dans les œuvres de Plutarque, Il n’y a que 23% de phrases sans kai, mais 28 % des phrases en contiennent trois et plus.
[18] Voir les détails dans l’introduction à 2 Pierre.
[19] Pour la réfutation détaillée voir M.
GREEN: 2 Peter reconsidered (Tyndale Press, London 1968), 2 Peter and Jude (Tyndale, London 1970, pp. 13-35). D. Guthrie: Introd.
to the N.T. (Tyndale, London 1962, pp. 137- 171). E. Harrison: Introd. to the N.T. (Eerdmans Grand Rapids 1965, pp. 390-400) et l’introduction à 2 Pierre dans Messages pour notre temps à paraître en 1974.
Ichthus N°17 – Août/Sept 1973– Pages 2 à 7
PEUT-ON IMAGINER DES FAUSSAIRES INSPIRÉS ?
Par Alfred KUEN