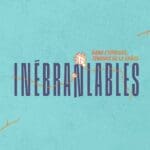Première partie de l’article : L’accord des Évangiles et la résurrection (1)
1) Le sort de Judas
En marge de l’histoire de la passion et de son issue glorieuse, deux évangélistes nous renseignent sur le sort de Judas.
La confrontation de leurs rapports parallèles, fait surgir l’apparence d’une contradiction ; c’est de nouveau l’occasion pour plusieurs critiques de rejeter ou de relâcher l’autorité des textes.
Les trente deniers
Matthieu, dans son Évangile (27:3-10,) et Luc, dans le livre des Actes (1:18-19), proposent deux versions sensiblement différentes. Selon Matthieu, Judas, saisi de remords s’est défait de l’argent de sa trahison ; il l’a jeté dans le Temple et s’en est allé se pendre. Selon Luc, Judas s’est acquis un champ avec l’argent du crime, et il est mort d’une chute (ainsi comprennent les traductions courantes) et d’un éclatement abdominal.
Les deux traditions se rejoignent sur un point : le champ acheté avec les deniers que les autorités avaient versés à Judas a reçu le nom de «champ du sang ».
Pouvons-nous admettre et comprendre ensemble des données à première vue si discordantes ?
Sur l’achat du champ, la réconciliation se fait sans trop de peine. Si les autorités du Temple opèrent la transaction, comme le dit Matthieu, n’est-ce pas au nom de Judas ? Aux yeux des prêtres, les trente deniers lui appartiennent toujours. Ils refusent d’annuler le versement qu’ils ont fait. Judas voudrait se débarrasser du sale argent, mais il lui colle après ! En un sens, le champ acheté avec son argent sera son champ — même si les prêtres, de force, décident de sa destination.
Par leur intermédiaire, c’est encore Judas l’acquéreur. Pierre, que cite Luc, a donc bien pu dire, dans son très bref résumé (Actes 1:18) que Judas avait acquis le champ. Nous n’avons pas deux versions opposées, mais une version détaillée et une version télescopée ou condensée des mêmes faits.
La mort de Judas
Mais comment Judas est-il mort ? De pendaison ou d’une chute ? Saint-Augustin supposait que la corde de Judas s’était cassée… et le criminologiste Edmond Locard, intrigué par le cas de Judas, arrivait à une conclusion du même genre. Cette hypothèse « harmonisatrice » est du type le plus indigeste aux critiques. Il est intéressant de noter qu’elle n’est pas l’expédient ridicule qu’ils pourraient penser : en effet, il est arrivé plus d’une fois que des tentatives de suicide échouent de cette façon (on trouve plusieurs exemples parmi les cas décrits par G. Deshaies, Psychologie du suicide, P.U.F., pp. 64, 114, 279).
Nous pensons, cependant, qu’il vaut mieux s’orienter dans une autre direction. La traduction des mots d’Actes 1:18 sur lesquels reposent la thèse de la mort par chute, prènès genomenos, est une traduction discutée. Les versions communes rendent ces mots : « étant tombé », « s’étant précipité », mais le sens n’est pas certain. Le grand savant libéral Harnack, que nul ne soupçonnera d’avoir cherché l’harmonisation à tout prix, tenait pour la traduction : « ayant gonflé ». Moffatt, Goodspeed, étaient du même avis que Harnack. Ce sont des noms de poids.
Si on adopte la seconde traduction, « ayant gonflé », le renseignement du livre des Actes complète celui de Matthieu. Il s’agit d’un horrible détail sur les suites de la pendaison, sur la fin ignominieuse du cadavre de Judas exposé au soleil de Jérusalem. Détail bien propre à frapper l’imagination populaire, à rappeler que le champ acquis avec l’argent de Judas était le prix du sang, et à signaler la malédiction divine que Pierre veut mettre en relief !
2) « Ne me touche pas »
Pour finir sur une note plus agréable, nous ajouterons un bref commentaire sur un détail du IVe Évangile, dans son récit de Pâques. Il s’agit du fameux Noli me tangere, « Ne me touche pas », de Jésus à Marie-Madeleine, lorsqu’elle le reconnaît dans le jardin (Jn. 20:17). Nous l’avons déjà relevé dans notre précédente étude.
L’interdiction a surpris quelques interprètes, comparée avec l’invitation faite plus loin à Thomas (Jn. 20:27). Elle a provoqué des suggestions fantaisistes : le corps tout neuf de Jésus aurait été trop « frais », trop sensible ; Jésus serait remonté au ciel dans une première ascension entre ce moment et la présentation à Thomas.
Plus sobrement, des spécialistes remarquent que le temps employé, avec la négation, implique le sens : cesse de me toucher. Marie s’était sans doute jetée aux pieds de Jésus et les étreignaient passionnément. Jésus l’envoie vers les disciples, et surtout ajoute une raison qui nous paraît donner la clé du problème. Jésus dit : « Je ne suis pas encore remonté vers le Père ». C’est comme s’il avertissait Marie : ce n’est pas encore le temps de ma présence corporelle définitive avec vous, ce n’est pas encore le « retour » que je vous ai promis et qui permettra que « là où je suis, vous y soyez aussi » (Jn. 14:3). « Ne me retiens pas » (traduction de la Bible de Jérusalem), car mon retour de résurrection n’est qu’une étape de ma glorification par le Père, et n’est qu’un gage de mon retour final — tel nous paraît le sens de la parole dans son contexte. Ainsi, la résurrection passée tourne nos yeux vers l’avenir de la promesse. Ne me retiens — je viens bientôt.
Sur le même sujet : On ne meurt qu’une fois … sauf Judas ?
Ichtus N°13 – Mai 1971 – Pages 27 et 28
Cet article est la suite de : L’accord des Évangiles et la résurrection (1)