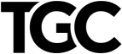Paul Ricœur est actuellement le penseur le plus connu du protestantisme français. Dans le monde, son prestige grandit. Dans les Églises, beaucoup ont entendu prononcer son nom, mais peu encore l’ont lu. Dans quel sens son influence croissante joue-t-elle ? Henri Blocher avait analysé la démythologisation selon Ricœur pour la conférence de Lausanne sur l’évangélisation (1967 – voir le livre «Les Trois amis»). Il rend compte aujourd’hui du dernier ouvrage de Ricœur. La pensée de Ricœur intéresse d’abord les philosophes et les théologiens ; mais l’impact qu’elle a sur la vie des Églises devrait pousser d’autres lecteurs d’ICHTHUS à faire l’effort d’une initiation.
La charge de doyen à Nanterre n’a guère laissé au professeur Paul Ricœur le loisir de penser et d’écrire. Aussi ne nous a-t-il pas encore donné la suite promise de sa Philosophie de la Volonté. Maître à penser d’un nombre croissant d’intellectuels, non seulement protestants mais aussi catholiques, il a fait patienter son public en présentant, il y a un peu plus d’un an, un recueil de travaux publiés dans la dernière décennie 1.
Hormis, peut-être, ses deux ripostes au structuralisme parues dans la revue Esprit (1963 et 67), et la préface à Bultmann (Jésus), la plupart des textes réunis n’avaient pu toucher qu’un public très restreint ; plusieurs étaient même inédits en français. L’ouvrage contient huit contributions aux Congrès internationaux de philosophie de Rome, dont Ricœur semble régulièrement un « grand ténor », et des chapitres de difficultés diverses.
Le titre de l’ensemble évoque la situation présente, et difficile, de la culture occidentale et de la foi chrétienne : Le conflit des interprétations. S’affrontent aujourd’hui deux sortes d’herméneutiques. Les premières, celles du soupçon, manient les armes de la psychanalyse et de la linguistique pour prolonger Marx et Nietzsche dans leur critique de la conscience et de la religion : elles réduisent le sens conscient au mécanisme inconscient, et la foi à l’illusion. Les secondes, au contraire, croient que l’être se livre dans l’apparaître, pourvu qu’on regarde bien, elles se fient au « phénomène » méthodiquement perçu : elles sont phénoménologiques. Elles s’inspirent de la « phénoménologie de l’Esprit » suivant Hegel (et tirent le sens des créations culturelles de l’humanité en devenir) ; ou de la phénoménologie de la Religion (et misent sur la révélation du Sacré dans les symboles) ; ou de la phénoménologie existentielle le et mystique de Heidegger (et recueillent la lumière de l’être dans la naissance poétique du langage). Ricœur préfère et pratique les secondes — il maintient même fermement le point de départ cartésien, « Je pense, (donc) je suis » mais il s’efforce d’intégrer les premières, les herméneutiques du soupçon. Dans le livre que nous considérons, il commence par un dialogue, captateur, avec ses adversaires, et poursuit par l’exposé de ses propres interprétations.
 Malgré la diversité qui marque toujours un recueil, le livre possède une forte unité : grâce au thème central, certes, et surtout grâce au style de Ricœur, à sa séduction rare. Encore un peu, et nous succomberions à ses charmes ; Ricœur semble toujours pouvoir dire exactement ce qu’il veut, et sa maîtrise, souvent, atteint à la beauté. Ainsi, pour résumer sa conception de la « réflexion concrète », selon laquelle le « Je pense, (donc) je suis » de Descartes, tout en restant valide, ne livre qu’une certitude vide parce que le sujet ne se voit pas tel qu’il est, Ricœur trouve la formule de « Cogito blessé » (173). En deux mots, il a situé son herméneutique : fidélité à la tradition réflexive (Cogito, « Je pense »), recours à une méthode indirecte, une interprétation, qui dépossède le moi de sa prétention à se connaître vraiment (Cogito blessé). Pour décrire le dernier avatar du fantasme œdipien devenu symbole chrétien, il parle plus loin du « père qui meurt de miséricorde » (482). Ici encore, quelques mots suffisent pour unir le thème de la mort de Dieu et sa signification selon Ricœur. Nous soupçonnons que l’extrême bonheur de l’expression, l’art magistral de la présentation, persuadent parfois quand il ne faudrait pas…
Malgré la diversité qui marque toujours un recueil, le livre possède une forte unité : grâce au thème central, certes, et surtout grâce au style de Ricœur, à sa séduction rare. Encore un peu, et nous succomberions à ses charmes ; Ricœur semble toujours pouvoir dire exactement ce qu’il veut, et sa maîtrise, souvent, atteint à la beauté. Ainsi, pour résumer sa conception de la « réflexion concrète », selon laquelle le « Je pense, (donc) je suis » de Descartes, tout en restant valide, ne livre qu’une certitude vide parce que le sujet ne se voit pas tel qu’il est, Ricœur trouve la formule de « Cogito blessé » (173). En deux mots, il a situé son herméneutique : fidélité à la tradition réflexive (Cogito, « Je pense »), recours à une méthode indirecte, une interprétation, qui dépossède le moi de sa prétention à se connaître vraiment (Cogito blessé). Pour décrire le dernier avatar du fantasme œdipien devenu symbole chrétien, il parle plus loin du « père qui meurt de miséricorde » (482). Ici encore, quelques mots suffisent pour unir le thème de la mort de Dieu et sa signification selon Ricœur. Nous soupçonnons que l’extrême bonheur de l’expression, l’art magistral de la présentation, persuadent parfois quand il ne faudrait pas…
Mentionnons encore un trait de méthode, qui frappe. Très souvent, Ricœur propose de suivre une voie longue, une route indirecte, de faire un détour (au moins sept fois dans ce livre). C’est une façon caractéristique de son intelligence, qui est d’abord souplesse, et qui combine la délicatesse des distinctions et l’ampleur des architectures. C’est aussi, très profondément, tout son message : il faut faire un détour, pour tout englober.
Ainsi Ricœur fait-il dans la première partie. Il y relève le double « défi de la sémiologie », c’est-à-dire de la science des signes. D’un côté, la linguistique moderne, avec le structuralisme qui s’en inspire, s’attaque à la philosophie du sujet ; elle croit montrer qu’au lieu de dire « Je parle », il faut dire « ça parle en moi. » D’autre part, la psychanalyse freudienne, qui déchiffre les signes que sont les symptômes, elle aussi fait parler le « ça. »
Prolongeant son gros Essai sur Freud de 1965, Ricœur intègre le freudisme comme un détour nécessaire dans l’approbation de soi. La psychanalyse se leurre si elle croit détruire le sujet ; elle le présuppose, au contraire : elle travaille dans le langage, elle s’intéresse aux effets de sens — or il n’y a de sens que pour un sujet — et l’inconscient n’est réalité que diagnostiquée (260, 107 ss). Seulement, la conscience doit passer par l’humiliation freudienne. Elle doit reconnaître qu’elle s’ignore elle-même, et que ce sont les rêves, les lapsus, l’incontrôlé, qui donnent la clé de ses secrets. Elle doit consentir au détour : « Elle se trouve en se perdant ; elle se trouve, instruite et clarifiée, en se perdant, narcissique. » (153) « Il faut perdre le moi pour trouver le Je » (24). Ricœur aime répéter le mot de Freud: « Où ça était, Je dois advenir », un Je enrichi de lui-même par l’épreuve, Cogito blessé et, comme Jacob, béni dans sa blessure.
De la même manière, Ricœur intègre l’autre inconscient, celui du système de la langue glorifié par les structuralistes (247). C’est une étape qu’il ne faut pas sauter, comme Merleau-Ponty l’a fait (249), mais à laquelle il faut encore moins s’arrêter. Ricœur, avec beaucoup de force, s’appuie sur la phénoménologie et sur les dernières acquisitions de la linguistique (Benvéniste, Chomsky) pour montrer que la sémiologie est subordonnée à la sémantique (pas de signe sans signification), que le sens appartient à la parole et non à la langue, et qu’ainsi la structure ne peut remplacer le sujet (248-257 et 80-97). Ricœur pourrait parfois pousser son avantage plus loin : contester davantage que le monde des signes, comme tel, soit fermé sur lui-même ; 2 mais il exploite bien la distinction fondamentale de la linguistique moderne, celle de la parole (discours, message) et de la langue (organe, code). Il triomphe ainsi brillamment de Lévi-Strauss. Hélas ! il nous semble qu’il tombe lui-même ensuite dans la confusion entre langue et parole lorsqu’il donne au langage, et non plus à la parole (la parole qui juge, qui commande et qui promet), le pouvoir de révéler l’être 3. Le sens dernier de l’existence, le sens des sens, Ricœur ne veut pas croire qu’un discours le lui apporte, qui exigerait décision ; il cherche à s’assimiler les symboles, médiateurs de l’être. C’est à nos yeux la grande erreur d’aiguillage de l’herméneutique ricœurienne. Ravi par le thème heideggerien de la poésie primordiale, « la langue parle », Ricœur célèbre finalement « l’ouverture, ou mieux, l’aperture, du langage » (96-97).
La tactique du détour comme l’effacement du propre de la parole correspondent à l’orientation de plus en plus marquée de la pensée ricœurienne. Cette pensée incline, en effet, de plus en plus au monisme et, comme telle, tente de tout réconcilier, de tout récapituler, de médiatiser toutes les oppositions. Bien que Ricœur se lave plusieurs fois les mains de tout éclectisme, on ne trouve plus rien de la passion biblique de l’antithèse, Bien ou Mal, Vérité ou Mensonge.
C’est ce qui apparaît dans la seconde moitié du livre, tandis que Ricœur poursuit le travail herméneutique sur les symboles commencé dans La symbolique du mal, et esquisse sa philosophie de la religion. Ricœur s’entretient avec les plus grands : Spinoza, Kant, Hegel, surtout. Kierkegaard intervient parfois, et Nietzsche, pour sa critique qu’il faut assumer. Husserl est rarement évoqué, et Heidegger, souvent. Les sympathies de Ricœur se précisent : il faut accepter la critique du soupçon, et admettre la destruction des « arrière-mondes », selon l’expression méprisante de Nietzsche pour le surnaturel (149). Le Dieu traditionnel est mort, le Dieu moral au-dessus du monde (436 s) ; il faut se réjouir, avec Hegel déjà, de la mort de la « transcendance séparée », du « Dieu là-haut » (482). On ne voit guère, observerons-nous, comment une transcendance non séparée se distingue de la pure immanence, mais un trait protège Ricœur d’un immanentisme total. A la suite de Kant, il rattache la religion à la question « Qu’ai-je le droit d’espérer ?» ; la religion vise l’accomplissement (le Christ est figure de la Fin), la totalisation, que Ricœur, contrairement à Hegel, juge autre que toute histoire et, par conséquent, objet d’espérance (327 s, 414 s). Ce thème, qui est ancien chez lui (sans doute un héritage de Gabriel Marcel), permet à Ricœur d’intégrer à son tour la « théologie de l’espérance » de J. Moltmann ! Néanmoins, le Dieu qui vient ne se distingue pas très radicalement de l’être du monde, puisqu’il faut comprendre, nous dit Ricœur, « l’identité profonde du Toi suprême [de Kierkegaard] et du Deus sive natura » de Spinoza (347). Cette dernière référence, faite en toute lucidité, en dit long.
Une autre référence revient sans cesse sous la plume de Ricœur :
Job. La méditation du livre de Job a dû compter beaucoup dans l’évolution de Ricœur. Il y voit le retour du tragique dans la théologie monothéiste et morale d’Israël (le mythe tragique est le mythe du Dieu méchant ; il mêle le mal à l’être). Le monothéisme moral enseigne que Dieu est lumière ; la souffrance de Job paraît le démentir, et Ricœur pose la question : « Peut-être faut-il, en effet, enténébrer aussi le divin que la vision éthique a réduit à la fonction moralisante du Juge ? » (305). Il fait dire à Job, et c’est l’essence de la réconciliation : « J’aime le tout, tel qu’il est » (346). Là encore, le choix de l’expression, qui n’est pas biblique, bien sûr, est significatif. Ricœur n’hésite pas à conclure : « Le livre de Job et les Fragments d’Héraclite disent une seule et même chose » (455), et cette chose est le message de Heidegger, le salut, l’habitation paisible du Tout, par la poésie.
Les conséquences sont claires dans les deux chapitres les plus attristants du livre : « Démythiser l’accusation » et « L’interprétation du mythe de la peine. » Dans le premier, Ricœur rejette la transcendance de l’impératif, il démythise l’idée de commandement divin : « Je ne projetterai pas au ciel la Valeur, l’idole de la valeur » (337) ; l’éthique n’est fondée que sur le désir humain d’exister. L’obligation ne se rattache plus à une Volonté de Dieu au-dessus de moi, mais à la volonté d’être au-dedans de moi. Nous pensons que Ricœur s’aveugle sur la différence qualitative absolue qui sépare ce qui est de ce qui doit être. Mais il n’a plus le Dieu qu’il lui faudrait pour l’admettre ; tout se tient. Alors Ricœur imagine et appelle de ses vœux « le prédicateur qui prononcerait seulement un mot de libération, mais jamais un mot d’interdiction et de condamnation » (438). Il nous semble qu’Israël a connu cette sorte de prophètes, et que les vrais ont dit certaines choses sur eux…
Puis Ricœur s’attaque au « mythe de la peine », la loi de la rétribution, qui institue châtiment pour crime. Cette loi est, dans la Bible, au cœur de la compréhension de la croix : « Il a porté nos péchés sur le bois » ; « le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui » ; « il a été fait malédiction pour nous ».
Tout en reconnaissant que la « théologie pénale paraît indissociable du christianisme, du moins en première lecture » (352), Ricœur prétend déconstruire ce mythe d’apparence logique. Il commence par définir, d’une façon foncièrement étrangère à la Bible, la loi de la rétribution : comme une équivalence entre un mal physique et un mal moral (349). Ainsi comprise, elle est absurde ! Mais l’Écriture pense tout autrement : si « le salaire du péché, c’est la mort », il ne s’agit pas d’équivalence ; on doit comprendre que tout homme choisit inéluctablement la mort en se détournant de Dieu, la source de vie ; la punition est à la fois suite naturelle (moisson inévitable) et sanction infligée(car l’enchaînement appartient à l’ordre spirituel). Puis Ricœur suit Hegel, dans une démonstration fort glissante… pour montrer que la notion de peine n’est admissible qu’au niveau de l’État (sans signification morale ni religieuse). Il a bien de la peine, enfin, à l’éliminer du texte de Paul, de l’exposé biblique si rigoureux de la justification et de son fondement. Il multiplie les coups de pouce. Il oppose le don et la dimension juridique, que justement la Bible unit. Il tombe dans une rhétorique embarrassée : si on maintient le sens apparent, « ne reste-t-on pas prisonnier des mots, des images, et si j’ose dire, de la mise en scène ? » (367). Ce traitement de Paul, à qui est attribuée une logique paradoxale de la surabondance, est la partie la plus sophistique de l’ouvrage, indigne d’un Ricœur. Ce détour est pourtant indispensable à l’itinéraire.
Le croyant trouve aussi, certes, de quoi nourrir et stimuler sa pensée ; les pointes empoisonnées sont enguirlandées des plus belles fleurs de l’intelligence et du langage ; Ricœur nous aide souvent à démasquer les erreurs de notre temps. Le danger n’en est que plus grand. Parlons franchement : le professeur Paul Ricœur nous paraît aujourd’hui le plus riche, le plus profond, le plus rigoureux, des maîtres de la « nouvelle théologie » en France et dans le monde ; il serait très triste qu’il soit le plus efficace — pour la séduction du peuple de Dieu.
1 Le conflit des interprétations, essais d’herméneutique, (Paris : éd. du Seuil, 1969), 506 pages.
2 Étienne Gilson est plus hardi dans son ouvrage Linguistique et Philosophie, (Paris : J. Vrin, 1969), pp. 30-61 et 263-282 surtout.
3 Ce glissement s’amorce dans de petites confusions de l’étude linguistique. Pp. 61-64, Ricœur identifie la régulation mutuelle des signes dans le système ou la structure (langue ?), et l’organisation des symboles dans le discours de l’Histoire du Salut (parole ?]. Pp. 71-72, il fait correspondre au « rapport syntagmatique » de Saussure, « qui enchaîne (dans le discours) des signes opposés dans une relation in praesentia, » un procès métonymique ; or la métonymie n’enchaîne pas in praesentia, mais sélectionne in absentia.
Revue Ichthus : N° 10 Février 1971