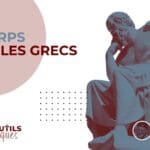Il vous est sans doute déjà arrivé d’en croiser : elles sont belles comme des princesses, et, peu à peu, elles se mettent à dépérir, sans que l’on comprenne pourquoi. Je parle de certaines jeunes filles, et de l’anorexie. Ce mal concerne environ 1,5 % de la population féminine, de 15 à 35 ans, et il touche moins les hommes.
 Pour aborder ce sujet douloureux, j’utiliserai le roman de Delphine de Vigan Jours sans faim, publié en 2001. Son écriture prend efficacement en charge la réalité de cette maladie, qui en constitue le sujet principal.
Pour aborder ce sujet douloureux, j’utiliserai le roman de Delphine de Vigan Jours sans faim, publié en 2001. Son écriture prend efficacement en charge la réalité de cette maladie, qui en constitue le sujet principal.
L’héroïne s’appelle Laure. Elle a accepté le traitement médical proposé à l’hôpital, et on l’accompagne jusqu’à ce qu’elle en sorte. Ce n’est pas un récit d’aventure, mais un parcours intérieur, au cours duquel la mémoire ramène souvent le passé. Il est aussi jalonné de rencontres avec les autres : malades, médecins, ou anciens amis, et parents.
Confrontons-nous donc à cette énigme.
Exister à travers la maladie
Comprendre l’anorexie c’est, d’abord, entrer dans un autre état, du corps, et de l’esprit. Le roman nous en donne la possibilité.
La mutation du corps s’opère presque indépendamment de soi :« Cela s’était fait progressivement. Pour en arriver là. Sans qu’elle s’en rende vraiment compte. Sans qu’elle puisse aller contre. » Les signes physiques sont nombreux, et divers : « Oui, elle avait les yeux démesurément agrandis, cerclés de noir, les bras comme des allumettes, la peau tirée à ne plus pouvoir sourire. Oui, c’est vrai, elle n’entendait plus, et pouvait à peine parler. Elle titubait, s’étalait dans la rue, elle ne pouvait même plus plier les jambes. Oui, elle pelait de froid à en crever et perdait ses cheveux par poignées. »
L’individu, qui souffre d’anorexie, est pris entre des sentiments contradictoires. D’une part, celui d’une hyper-puissance sur soi : « Elle se souvient de ce sentiment de puissance, qui repoussait toujours plus loin les limites du jeûne et de la souffrance. » Et, à l’inverse, un sentiment de dépossession de soi : « Elle s’accroche à cette maladie comme à la seule façon d’exister. Elle n’a pas d’autre identité, elle défend les vestiges de sa maigreur comme les derniers signes de sa présence. »
On est lié par cette maladie, qui atteint la volonté : Elle ne veut pas guérir parce qu’elle ne sait pas comment exister autrement qu’à travers cette maladie qui l’a choisie. »
La relation à autrui, bien sûr, est modifiée : « Elle se souvient du regard des gens, de la peur dans leurs yeux (…) Ils disent, on ne savait pas comment t’aborder, te parler, tu étais inaccessible.
L’anorexie nous confronte donc à un étrange processus de métamorphose.
Pourquoi ?
Il existe des maladies qui sont sans pourquoi. Elles adviennent et s’imposent, avec leur lot de souffrances.
Il existe des maladies qui sont sans pourquoi. Elles adviennent et s’imposent, avec leur lot de souffrances. Dans le cas de l’anorexie, la question du pourquoi se pose, dans la mesure où elle ne s’impose pas sans le consentement de la volonté du malade qui, selon les termes employés par la romancière : « s’accroche à cette maladie ».
Cet article ne repose pas sur des données scientifiques, mais sur un roman. Toutefois, cette fiction, documentée, offre des éléments de compréhension. Ils sont disséminés au fil de l’œuvre. Et ils ont tous rapport avec la famille.
La mère d’abord. Elle a été « internée quand Laure avait 13 ans ». L’obsession du suicide l’a sans cesse habitée : « Quand Laure était enfant, sa mère voulait mourir. » Elle a elle-même vécu un véritable calvaire : « Imagine, Laure, ce que j’ai vécu, moi, internée à 33 ans, séparée de mes deux filles. Imagine ce que cela représente pour une femme de se retrouver chez les fous, de perdre d’un seul coup son boulot, son appartement, ses enfants. Imagine la solitude, l’enfermement. » D’une certaine manière, l’anorexie de la fille reproduit le traumatisme maternel.
Du côté paternel, la situation n’est pas plus simple : « Elle raconte la violence de son père. La violence des mots. Des nuits entières avec (sa sœur), autour de la table. A compter les miettes pendant qu’il les insulte sans même sans rendre compte, salopes, putes, merdeuses. (…) Toute la nuit, il les abreuve de paroles (…), toute cette haine qu’il vomit, la haine de leur mère, la haine de sa famille à lui, ses frères et sœurs avec lesquels il a rompu, des mots comme des ordures. » Si la mère est reconnue comme malade mentale, lui ne l’est pas moins, et enfermé, aussi, dans son mal : « Il souffre d’un mal étrange, un mal qui le ronge aussi. Il détruit tout, les attaches, les sentiments. »
Les deux parents sont qualifiés de « toxiques » par la romancière. Et l’on apprend encore, au fil de la narration, que : « Quand Laure avait 10 ans, le frère de sa mère est mort. Il s’est tiré une balle dans la tête. (…) Un peu plus tard, le cousin de sa mère aussi. »
Comment s’étonner, à moins d’être doté d’une grande capacité de résilience, qu’un individu, soumis dès l’enfance à de telles pressions, trouve difficilement le chemin de la vie ?
Ce mal étrange
J’ai été attentif, dans ma lecture, aux termes utilisés par la romancière pour nommer cet état d’anorexie.
Il est difficile à nommer, tout comme il est difficile d’en parler : « Elle est l’instrument de quelque chose qui la dépasse, elle ne sait pas en parler. » Ces termes, vagues, disent tout de même fort bien la dépossession de soi. Dans l’anorexie, l’individu devient une victime de ce qui le dépasse.
La romancière dit encore : « C’était quelque chose en dehors d’elle ». Donc : quelque chose hors de soi qui, précisément, saisit le soi, et le vide de lui-même, de sa force vitale : « Une énergie silencieuse qui l’aveuglait et régissait ses journées. » Ce n’est plus l’être qui se dirige lui-même, par sa volonté.
Les métaphores sont toujours révélatrices : « Étouffer ce monstre en elle qui l’engloutit. » On est ramené aux cauchemars de l’enfance : dévoration, engloutissement. Et, pour finir, il est question d’« un crime silencieux perpétré contre soi. » Autrement dit, une forme de suicide.
Un remède à la souffrance ?
L’anorexie nous fait entrer dans un cercle vicieux : celui de la souffrance. Et je crois qu’il faut partir de là, c’est-à-dire de la reconnaissance de toutes les souffrances qui sont liées à cet état. Souffrances physiques, et souffrances psychiques. Il est terrible de constater que, dans l’anorexie, la souffrance subie conduit l’individu à se faire souffrir. C’est pourquoi je parlais de cercle vicieux. Non seulement le malade est malade, mais il semble vouloir faire payer à son propre corps le prix de ses souffrances, comme s’il pouvait les expier, en se maintenant dans cet état : « Elle ne veut pas guérir parce qu’elle ne sait pas exister autrement qu’à travers cette maladie… »
Je songe au Christ qui, dans les Évangiles, demandait au malade, avant de le guérir : « Veux-tu être guéri ? » (Jean 5.6 )
Je reconnais, en l’anorexie, une vraie maladie, qui nécessite un traitement bienveillant, médical et psychologique. Mais je crois que notre être ne se réduit pas au corps et au psychisme. Il existe aussi, en nous, une part spirituelle, celle que l’on désignait autrefois par le terme, devenu désuet, de « l’âme ». Et celle-ci a aussi besoin de guérison.
La Bible ouvre un chemin de guérison avec un processus, désigné par le terme de « pardon ». Lorsque les souffrances ont été, dans une vie, intenses au point de mettre l’individu à saturation, elles sont comparables à un nœud. Ce nœud peut avoir été noué si fort qu’il semble impossible à dénouer. Or vivre noué est insupportable.
J’ai bien conscience de la difficulté qu’il peut y avoir à pardonner, quand les souffrances que l’on a subies ont atteint les limites du supportable. C’est bien pourquoi, alors, c’est le corps qui se met à parler, à dire ce que la personne n’est plus en mesure de formuler. Pourtant, je crois à la nécessité du processus de pardon.
Ce pardon, on le trouve en Christ, qui s’est chargé du poids de toutes nos souffrances, de toutes nos maladies : « Ce sont nos souffrances qu’il a portées, c’est de nos douleurs qu’il s’est chargé. » (Ésaïe 53.4) Parce que Christ « me » pardonne, « je » suis pardonné, libéré. Je n’ai plus à me faire payer à moi-même, dans mon corps ou dans mon esprit, le mal qu’on m’a fait. Parce que le Christ me pardonne, je suis en mesure de pardonner aussi, à autrui, cette fois, tout le mal qu’il m’a fait.
Ce chemin est celui d’une authentique renaissance à soi-même, en-Christ.
Pour aller plus loin :