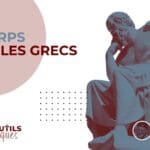1 – Le concept de « corps » dans la perspective grecque :
Partons d’une citation de Platon, rapportant, dans le Gorgias et le Cratyle cette parole de Socrate, dont il est le médiateur : « Le corps est le tombeau de l’âme ». Il apparaît, d’emblée, que le rapport des Grecs au corps est négatif. Pourquoi ?
Ce positionnement est directement lié au dualisme soutenu par Platon entre le monde intelligible et le monde sensible. Dans son discours sur la nature de l’âme, Socrate soutient qu’elle est constituée d’une partie intelligible, le noûs, l’intellect, et qu’elle est corrompue par le contact du corps avec le monde sensible. Et là, on retrouve la fameuse « théorie des Idées », montrant que l’approche du réel par le corps, donc par le sensible, ne donne qu’une illusion du réel. En effet, la vérité est pensée comme se trouvant au-delà de ce que le corps perçoit, dans le domaine des Idées (l’essence des choses). Le philosophe accède à ce domaine par l’esprit, et peut aussi le rendre accessible à ses semblables, s’ils acceptent de quitter le domaine de l’illusion, engendrée par le sensible, le corporel.
Je résume : pour les Grecs, le corps nous trompe. Il nous empêche d’atteindre la vérité.
Quel est le but principal de la philosophe pour Platon ? Conduire l’homme vers le Bien. Pour cela, elle doit permettre aux hommes de se détacher du corps. Il s’agit là d’une condition nécessaire pour accéder aux vérités éternelles, donc au Bien.
2 – Actualisation du concept :
A-t-on affaire, là, à une conception totalement dépassée et sans intérêt ?
J’ai souvent eu l’occasion de répéter l’importance de l’influence des Grecs sur la pensée européenne. S’il est un domaine où cela se vérifie, c’est bien celui-ci : le domaine du corps, du corporel. La dévalorisation du corps par rapport à l’esprit a eu une influence considérable. Ainsi, on a constamment valorisé : le « haut », le ciel des Idées, par rapport au « bas », domaine du vulgaire, de l’erreur, du mal. Ce à quoi il faut ajouter une mauvaise interprétation des Écritures transmise par l’Église, dans la mesure où le corps a été diabolisé, relié au péché, et au mal.
Chez les Grecs, le corps empêche l’accès à la vérité philosophique.
Dans les siècles passés de l’Église, on a aussi considéré que le corps empêchait l’accès à la vérité, et à la sainteté, c’est-à-dire à la mise à part, pour-Dieu.
A plusieurs reprises, dans l’histoire de la pensée européenne, des philosophes, comme Diderot, au Siècle des Lumières, tenteront une revalorisation du corps et des sens, Mais il faudra attendre la fin du 19e siècle, avec le philosophe allemand Nietzsche, pour que s’opère une véritable bascule. En affirmant : « Ma philosophie, le platonisme inversé », dans les « Notes posthumes » de son essai Naissance de la tragédie, il opère un renversement de la priorité donnée par Platon au monde intelligible et à l’esprit. Il engage la pensée européenne sur la voie inverse : désormais, le monde sensible doit avoir la priorité, dans l’approche du réel, donc le corps. Ce qui s’est vérifié, au 20e siècle, tant dans le monde de la pensée que dans celui de l’art, ou de la vie des gens.
3 – Dans une perspective biblique :
La question qui reste à poser est la suivante : la foi chrétienne implique-t-elle une diabolisation du corps, du corporel ?
A cette question, la révélation biblique apporte une réponse de l’ordre de l’évidence, avec un des fondements du christianisme, qui est : l’incarnation de Dieu en son Fils, Jésus-Christ. Il est écrit, le concernant : « Le Verbe s’est fait chair » (Jean 1:14), et aussi, qu’il est « devenu semblable aux hommes » (Philippiens 2:7). Cette réalité là est inacceptable pour les Grecs, parce qu’elle est même impensable.
Lorsque Paul, lors de son discours sur l’Aréopage grec d’Athènes, évoque la résurrection de Christ « d’entre les morts », la réactions de ses auditeurs est violente : « Lorsqu’ils entendirent parler de résurrection des morts, les uns se moquèrent, et les autres dirent : nous t’entendrons là-dessus une autre fois », ce qui pourrait se traduire par : « Cause toujours ! ». Si « le corps est le tombeau de l’âme », comme ils le pensaient, comment envisager la résurrection des corps ?
Non, la Bible ne diabolise pas le corps.
Autre domaine où le contresens a sévi : la sexualité. Il faut ne pas avoir ouvert le livre du « Cantique des cantiques » pour prétendre que le christianisme diabolise la chair. Ce livre de l’Ancien Testament contient des passages très sensuels, dans l’évocation du corps, féminin ou masculin. On a voulu en spiritualiser totalement la signification, mais il évoque, aussi, l’union charnelle de l’aimé et sa bien-aimée. Le plaisir de la chair a été donné par Dieu aux hommes, dans le cadre qu’il a fixé : celui du mariage, pour leur bien et celui de l’humanité entière.
L’Église est mise en rapport avec un corps, dont le Christ est la tête. Preuve ultime que j’avancerai ici, afin de bien montrer qu’en réalité, dans le christianisme, loin d’être diabolisé, le corps est une réalité prise en compte, et de manière positive. Certes, il est soumis à une dégradation, par la maladie et la vieillesse, mais il n’empêche pas l’accession à la vérité et à la sainteté. Et il sera ressuscité, incorruptible : « Semé corruptible, on ressuscite incorruptible. » (1 Corinthiens 15 :42)