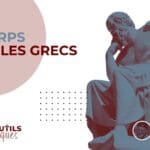Les zones sensibles d’une société sont multiples, et variées. Il est certain que la différence sexuelle en est une, dans la société qui est la nôtre.
Pour aborder ce thème, j’ai choisi un ouvrage, présenté comme un roman, mais qui est très fortement lié à la vie même de son auteur. Il s’agit de « En finir avec Eddy Bellegueule », premier roman d’Edouard Louis, paru en 2014, alors qu’il n’avait que 21 ans. Deux éléments s’entremêlent. D’une part, la description de son milieu d’origine, très populaire, dans le nord de la France. D’autre part, le parcours lié à son homosexualité, depuis l’enfance jusqu’à ce qu’il accède à la vie étudiante.
Un témoignage personnel peut sembler ne valoir que pour une seule personne, mais ce n’est pas le cas ici. La sincérité de l’auteur donne à son texte une valeur que l’on pourrait qualifier de « sociologique ». Edouard Louis, d’ailleurs, après l’Ecole normale supérieure de la rue d’Ulm, a poursuivi des études en sciences sociales, et rédigé un essai sur le sociologue Pierre Bourdieu.
Mettons-nous à son écoute.
Ne pas être comme les autres
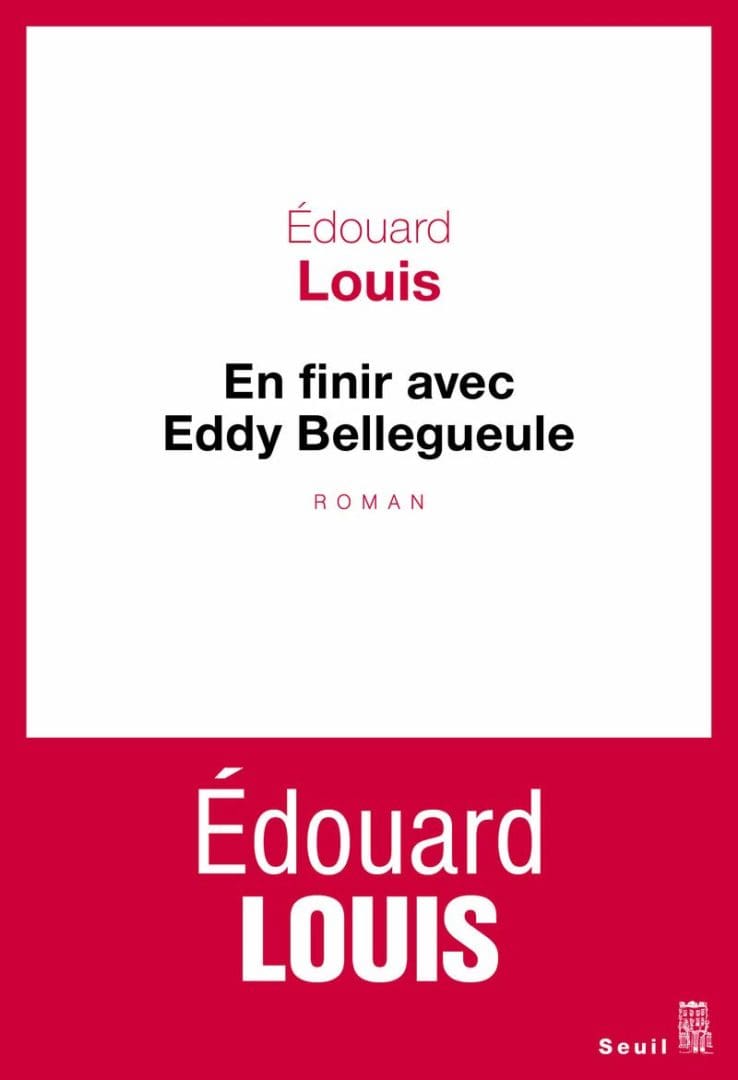 On attend d’un garçon un certain comportement, et ce phénomène est encore accru dans le milieu d’origine de l’auteur. Or, dès l’enfance, Eddy Bellegueule ne correspond pas aux attentes.
On attend d’un garçon un certain comportement, et ce phénomène est encore accru dans le milieu d’origine de l’auteur. Or, dès l’enfance, Eddy Bellegueule ne correspond pas aux attentes.
Dans la séquence narrative intitulée « Les manières », l’auteur écrit : « Très vite j’ai brisé les espoirs et les rêves de mon père. (…) Quand j’ai commencé à m’exprimer, à apprendre le langage, ma voix a spontanément pris des intonations féminines. Elle était plus aiguë que celle des autres garçons. Chaque fois que je prenais la parole mes mains s’agitaient frénétiquement, dans tous les sens, se tordaient, brassaient l’air. Mes parents appelaient ça des airs, ils me disaient Arrête tes airs. Ils s’interrogeaient Pourquoi Eddy il se comporte comme une gonzesse. » Il apparaît aux yeux des autres comme « efféminé », et ces autres ne comprennent pas qu’il ne s’agit pas d’un choix : « Pourquoi choisit-il de parler, de se comporter comme une fille alors qu’il est un garçon ? » Souffrance liée à l’incompréhension : « J’étais dominé, assujetti par ces manières ».
Bien sûr, la sensibilité de cet enfant est beaucoup plus grande. Elle se manifeste dans son rapport à l’école, qu’il aime, ce que ses parents ne comprennent pas : « Regarde les dessins animés, (… ) ça fait déstresser avant d’aller à l’école. Je sais pas pourquoi l’école ça te fait cet effet-là, ça sert à rien. » Ou bien encore, par exemple, dans ses goûts musicaux : « Mon grand frère, qui préférait, comme les durs, les chanteurs de rap ou la musique techno, se moquait T’en as pas marre d’écouter que de la musique de gonzesse ». Jugements continuels …
A l’aise avec les filles, il est rejeté par les garçons : « Si je les appelais les copains, ma bande, il était évident que c’était un fantasme que j’exprimais et que j’étais plutôt un élément isolé qui gravitait autour d’eux. Jamais je ne parvins à complètement m’intégrer aux cercles de garçons. Nombreuses étaient les soirées où ma présence était soigneusement évitée, les parties de football auxquelles on ne me proposait pas de participer. Ces choses dérisoires pour un adulte qui marquent un enfant pour longtemps. » Epreuve de « la mise à l’écart dont j’étais l’objet ».
Sur le plan sexuel, Eddy Bellegueule sait, très rapidement : « c’était la vue d’un corps d’homme qui me troublait ». Donc, « à cette période, l’idée d’être en réalité une fille dans un corps de garçon, comme on me l’avait toujours dit, me semblait de plus en plus réelle. J’étais progressivement devenu un inverti. »
L’auteur en vient même à évoquer : « Le crime n’est pas de faire, mais d’être. Et surtout d’avoir l’air. »
Lutter contre sa différence
Vouloir se débarrasser de ce qui nous fait souffrir est une réaction normale. Edouard Louis raconte ainsi comment il a cherché à combattre son homosexualité.
Tout d’abord, il s’agit de changer ses manières. Après avoir vu un reportage télévisé sur le combat contre l’obésité, dit-il, « j’imaginais des éducateurs qui m’auraient battu chaque fois que j’aurais laissé mon corps céder à ses dispositions féminines. Je rêvais d’entraînements pour la voix, la démarche, les façons de tenir le regard. Je m’appliquais à chercher, avec acharnement, de tels stages sur les ordinateurs du collège. » Comme il le formule, il s’agit bien de « devenir un autre ». Eddy Bellegueule se contraint alors, volontairement, à un programme de transformation de soi : « Surveiller mes gestes quand je parlais, apprendre à rendre ma voix plus grave, me consacrer à des activités exclusivement masculines. Jouer au football plus souvent, ne plus regarder les mêmes programmes à la télévision, ne plus écouter les mêmes disques. (…) Aujourd’hui je serai un dur. » Or, « devenir un garçon passait nécessairement par les filles. »
Avancé en âge, Eddy Bellegueule va tenter de prouver, tant à lui-même qu’aux autres, qu’il est un « vrai mec », par des tentatives d’amours féminines. Avec une certaine Laura, puis avec une autre fille, Sabrina. Il voudrait « en » sortir. De quoi ? Le vocabulaire employé est celui de la médecine : « J’étais enfin guéri. (…) En retrouvant mes parents j’ai espéré qu’ils pourraient percevoir ma transformation ( guéri, guéri ). Je me disais que peut-être (…) mon corps était soudainement devenu celui d’un dur, comme celui de mes frères. » Il est comme « aveuglé par cette impression de (s’) être arraché à un mal qui jusque-là (lui) avait semblé incurable. »
Aveuglement volontaire. Celui-ci ne peut durer qu’un temps, bref : « Après (…) mon corps n’a plus cessé de se rebeller contre moi, me rappelant à mon désir et anéantissant toutes mes ambitions d’être comme les autres, d’aimer les filles moi aussi. »
Réagir à la différence
Deux mots résument les réactions des autres autour de lui : violences et humiliations.
Les premiers à manifester cette violence sont les parents. La mère, est confrontée, par hasard, à l’évidence de l’homosexualité de son fils. Elle est sidérée. Elle rentre à la maison et informe le père : « Mon père était à côté d’elle, une expression semblable modelant ses traits. Il savait tout. Il s’est doucement approché de moi, et puis la gifle, puissante, son autre main qui saisit mon tee-shirt si fort qu’il se déchire, la deuxième gifle, la troisième, une autre et une autre, toujours sans parole. »
Il y a plusieurs formes de violences. La violence physique, bien sûr, mais aussi la violence verbale. Eddy Bellegueule la subit dès l’enfance : « C’est toi le pédé ? ». Douleur de l’insulte. « Les injures se succédaient avec les coups, et mon silence, toujours. » L’auteur donne une longue liste des termes lâchés. Il avoue : « On ne s’habitue jamais à l’injure. »
La violence physique se cumule avec la violence verbale. Avec, pour objectif premier : l’humiliation. Certaines scènes sont terribles, au collège notamment : « Ils m’ont d’abord bousculé des doigts, sans trop de brutalité, toujours en riant, toujours le crachat sur mon visage, puis de plus en plus fort, jusqu’à claquer ma tête contre le mur du couloir. Je ne disais rien. (…) Je me souviens : les coups dans le ventre, la douleur provoquée par le choc entre ma tête et le mur de briques. C’est un élément auquel on ne pense pas, la douleur, le corps souffrant tout à coup, blessé, meurtri. On pense – devant ce type de scène, je veux dire : avec un regard extérieur – à l’humiliation, à l’incompréhension, à la peur, mais on ne pense pas à la douleur. »
Violences. Humiliations. Douleur.
Réagir à la souffrance
Existe-il des souffrances qui « méritent » notre compassion, et d’autres pas ?
Appuyer « là où ça fait mal » est mon objectif.
Une question : existe-il des souffrances qui « méritent » notre compassion, et d’autres pas ?
Autre question, que le chrétien devrait se poser sans cesse : qu’est-ce que Jésus aurait fait à ma place ? Jésus a-t-il choisi ceux envers lesquels il a fait preuve de compassion ? On le voit croiser bien des malheureux, sur son chemin terrestre : des aveugles, des malades, ou bien des voleurs, des traîtres, des adultères, tous ces « gens de mauvaise vie ». Comment a-t-il réagi ? Par la compassion. Pourquoi ? Par amour, uniquement par amour. L’amour du Père pour les hommes, qui l’a poussé à envoyer le Fils, pour porter leurs souffrances.
Toute souffrance appelle la compassion, l’écoute, et comme Jésus le proposait souvent à ceux qu’ils rencontraient, un cheminement, patient, à côté de l’autre, sur les voies de l’espérance, d’une consolation, ou d’un changement de vie.
Pour aller plus loin :
- Dieu est-il homophobe ?
- Pourquoi nous ne devrions pas utiliser l’expression « orientation sexuelle » ?
- De l’homosexualité à l’Évangile : l’histoire fascinante de Becket Cook
- 12 affirmations sur la sexualité humaine
- Pourquoi l’idéologie transgenre a triomphé ?