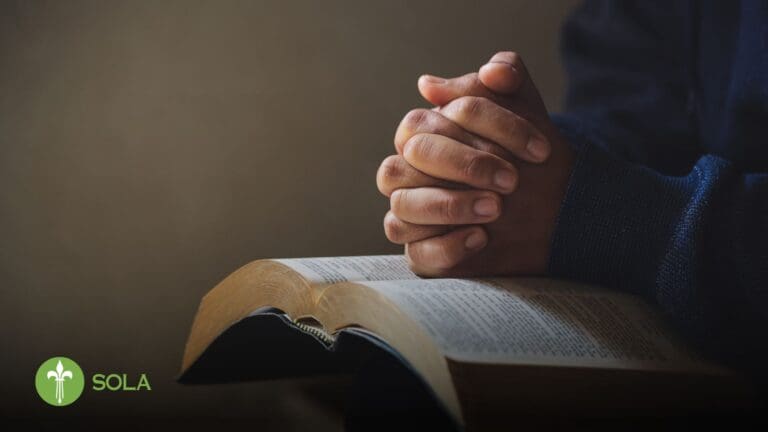La première question du Catéchisme est probablement la plus connue. Elle en constitue peut-être la seule partie que la plupart des chrétiens (même les réformés) entendent. Toutefois, si vous ne devez en entendre qu’une seule, je pense que cette première partie est tout indiquée.
La seule question, dans un catéchisme, qui est aussi connue que celle-ci est la première question du Petit Catéchisme de Westminster : « Quel est le but principal de la vie de l’homme ? De glorifier Dieu et de trouver en lui son bonheur éternel. » J’ai entendu le Heidelberg critiqué parce qu’il commençait par l’homme (quelle est mon unique assurance) au lieu de commencer par la gloire de Dieu comme le Westminster. Mais si l’on veut chipoter, le Westminster peut être critiqué parce qu’il débute avec ce que l’on doit faire plutôt que par ce que le Christ a fait pour nous, comme le Heidelberg.
En vérité, les deux catéchismes commencent à des endroits appropriés. Le Heidelberg commence par la grâce, le Westminster commence par la gloire. Il serait difficile de penser à deux meilleurs termes pour décrire le thème de la révélation biblique.
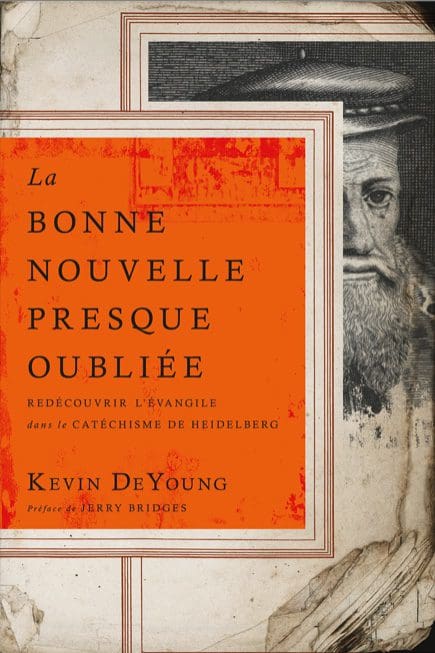
La Bonne Nouvelle presque oubliée : redécouvrir l’Évangile dans le Catéchisme de Heidelberg
Kevin DeYoung
La Bonne Nouvelle presque oubliée : redécouvrir l’Évangile dans le Catéchisme de Heidelberg
Kevin DeYoung
Dans une culture de la nouveauté, DeYoung nous invite à redécouvrir le catéchisme de Heidelberg dans un commentaire qui déborde d’applications pour notre vie chrétienne. Dans un style clair et agréable, il nous présente la théologie vivante du catéchisme, qui ne cesse de nous émerveiller devant le Dieu de l’Écriture. »
– YANNICK IMBERT, professeur d’apologétique, Faculté Jean Calvin
La première question du Heidelberg est vraiment saisissante en raison du mot « unique ». Si elle demandait « qu’est-ce qui te réconforte ? », la question serait affable, mais décevante. Le sommeil me réconforte, tout comme les cookies aux pépites de chocolat, un bon livre et la bande originale du film La mission. Mais lorsque le Catéchisme demande quelle est ton unique assurance, ou réconfort, il s’intéresse à quelque chose de plus profond. « Réconfort » traduit le mot allemand trost, qui traduit lui-même le mot consolatio dans la première version officielle latine[1]. Trost est lié au mot anglais « trust » et revêt la signification fondamentale de « certitude » ou « protection ». Le Heidelberg demande : « Quel est ton réconfort dans la vie ? Quelle est ta seule véritable assurance ? »
La première question du Heidelberg ne définit pas uniquement le thème de tout le Catéchisme (voir les questions et réponses 2, 52, 53, 57, 58), il pose aussi la question la plus importante à laquelle nous serons confrontés. Qu’est-ce qui vous permet de supporter la vie et de faire face à la mort sans peur ? Est-ce parce que vous lisez la Bible tous les jours ? Que vous allez à l’église tous les dimanches ? Que vous donnez aux pauvres ? Que vous avez une épargne retraite bien confortable ? Que vous n’avez commis aucun péché grave dans votre vie ?
On vit dans un monde où l’on s’attend à trouver notre réconfort dans les possessions, l’orgueil, le pouvoir et la situation professionnelle. Mais le Catéchisme nous enseigne que notre seul et vrai réconfort vient du fait que l’on ne s’appartient même pas à soi-même. Quelle idée contre-culturelle et contre-intuitive ! On peut supporter la souffrance et les déceptions dans la vie et faire face à la mort et à la vie à venir sans peur du jugement, non en raison de ce que l’on a fait, ou de ce que l’on possède, ou de qui l’on est, mais en raison de ce que l’on ne possède pas, à savoir nous-mêmes.
L’importance que le Heidelberg accorde à notre appartenance au Christ vient probablement de Jean Calvin. Certaines personnes ont l’impression que Jean Calvin était un dogmaticien rigide et aride, alors qu’en réalité son cœur était profondément tourné vers Dieu. Écoutez le battement passionné du cœur de Calvin dans ce passage, dont on entend l’écho dans le Catéchisme de Heidelberg : « Nous ne nous appartenons pas ; que notre raison et notre volonté ne dominent pas dans nos réflexions et nos décisions. Nous ne nous appartenons pas ; n’ayons pas pour objectif ce qui nous plaît selon la chair. Nous ne nous appartenons pas ; oublions-nous nous-mêmes autant que possible, ainsi que tout ce qui nous entoure. Au contraire, nous sommes au Seigneur ; que sa volonté et sa sagesse dirigent nos actions. Nous sommes au Seigneur ; que tous les aspects de notre vie soient orientés vers lui comme étant notre unique objectif[2]. »
La question 1 du Catéchisme façonne toute notre existence. La première chose qu’il nous faut savoir en tant que chrétien est que l’on appartient à Jésus et non à soi-même.
Pourtant, cela n’a pas beaucoup d’intérêt de tout savoir sur le réconfort et la joie si l’on ignore ce qui est nécessaire pour vivre et mourir dans ce réconfort et cette joie. Appartenir à Jésus et non à soi-même signifie être conscient de trois choses : la culpabilité, la grâce et la reconnaissance. Le reste du Catéchisme suit ces trois grandes lignes.
Tout d’abord, on comprend notre péché. Puis on comprend le salut. Enfin, on comprend de quelle manière on est sanctifiés pour servir.
Ces trois éléments sont indispensables. Si l’on n’est pas conscients de notre péché – qui confère un réel sentiment de culpabilité –, on aura trop confiance en nos capacités à faire le bien et à rendre le monde meilleur. On ignorera notre problème le plus fondamental, qui n’est pas le manque d’éducation, ni le manque d’occasions, ni le manque de ressources, mais le péché et la misère qui l’accompagne. Mais si l’on ne sait pas de quelle manière on est libérés de ce péché et de cette misère – c’est-à-dire par la grâce de Dieu –, on tentera de se réfugier dans la futilité ou l’on abandonnera dans le désespoir. De plus, si l’on ne sait pas comment remercier Dieu, en montrant de la reconnaissance pour une telle délivrance, on vivra dans une bulle, centrés sur nous-mêmes et nous prenant pour la mesure de tout, et ce n’est pas pour cela que Dieu nous a sauvés de notre péché et de notre misère. Si les chrétiens s’attachaient à ces « trois éléments », et pas seulement à un ou deux, on éviterait pas mal de mauvaise théologie et d’idées nuisibles.
Comprenez bien les principes sous-jacents de ces deux premières questions : on est appelés à vivre et à mourir dans la joie de ce réconfort. Le fait que si peu de chrétiens le comprennent montre à la fois à quel point la vie peut être difficile et à quel point on médite peu sur ce que signifie appartenir au Christ. Le réconfort ne signifie pas que le Christ nous débarrasse de toutes les mauvaises choses qui nous arrivent dans la vie. Le réconfort, comme le dit Ursinus, « est un certain raisonnement par lequel nous opposons à un certain mal un certain bien, et par la considération de ce bien nous amoindrissons la douleur et nous tolérons patiemment ce mal[3] ». En d’autres termes, le réconfort nous offre une plus grande joie pour éclipser les souffrances présentes et à venir.
L’idée de vivre et mourir dans le réconfort nous fait penser à un fauteuil inclinable avec massage dorsal et de la nourriture à volonté (sans les kilos, bien entendu). Or, le Catéchisme offre un autre genre de réconfort, plus profond, plus grand, plus riche et plus doux. On trouve ce réconfort en reconnaissant notre péché au lieu de l’excuser, en plaçant notre confiance en un Autre plutôt qu’en nous-mêmes et en vivant pour remercier plutôt que pour être remerciés.
[1] N. D. T. : La version française du Catéchisme utilise le mot « assurance » pour l’original allemand trost.
[2] Jean Calvin, Institution de la religion chrétienne, III, vii, 1, Excelsis/Kerygma, Charols/ Aix-en-Provence, 2009, p. 624.
[3] Commentaire de Heidelberg, trad. Étienne Omnès, < http://parlafoi.fr/2020/02/21/ quest-ce-que-le-reconfort-q1-heidelberg/ > (page consultée le 18 mars 2020).