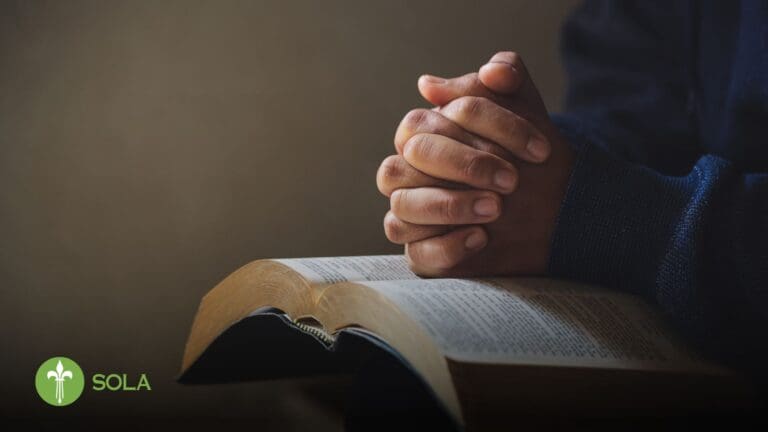L’adjectif systématique vient du mot grec formé avec syn, « ensemble », et histanai, « ériger », ayant le sens de « rassembler » ou « systématiser ». Comme nous l’avons rappelé plus haut, le mot théologie vient du grec theologia, « une parole concernant dieu », une théologie. Étymologiquement, la théologie systématique désigne une collection ordonnée de paroles sur Dieu ou une théologie organisée d’une certaine manière. Notez la réaction de Spurgeon à ceux qui combattent une théologie abordée de façon systématique :
La théologie systématique est à la Bible ce que la science est à la nature. Supposer que toutes les autres œuvres de Dieu sont ordonnées et systématiques, et que plus l’œuvre est grandiose, plus le système est parfait, et imaginer que la plus sublime de toutes ses œuvres, qui révèle toutes ses perfections dans leur transcendance, n’obéirait à aucun plan ou système est totalement absurde[1].
La théologie systématique répond à la question : qu’est-ce que le canon complet de l’Écriture enseigne sur tel thème ou tel sujet ? Par exemple, qu’est-ce que, de la Genèse à l’Apocalypse, la Bible enseigne sur la divinité de Jésus-Christ ? On pourrait donc définir fondamentalement la théologie systématique comme « l’exposition ordonnée des doctrines chrétiennes[2] ».
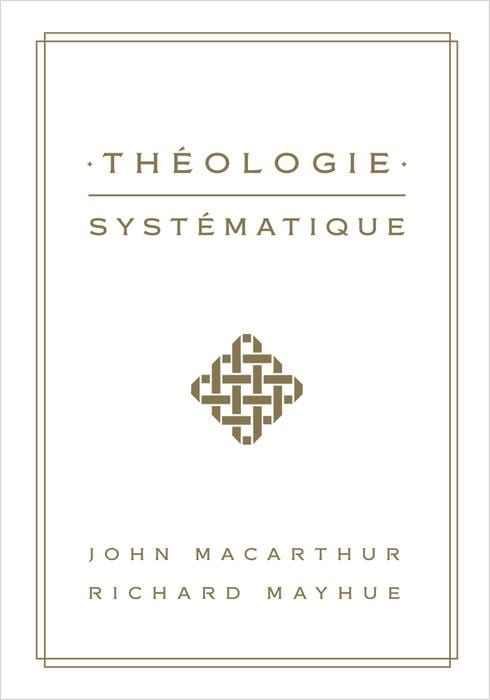
Théologie systématique
John F. MacArthur - Richard Mayhue
L’étude de la doctrine biblique ne devrait pas être réservée aux théologiens. Elle est importante pour tous les chrétiens puisqu’elle nous enseigne qui est Dieu et comment nous devrions vivre.
Ce survol des doctrines chrétiennes fondamentales (une systématisation de la théologie solide qui a soutenu pendant des décennies le ministère de prédication de John MacArthur) couvre des sujets tels que Dieu le père, Jésus-Christ, le Saint-Esprit, la Bible, le salut, etc.
Son contenu exhaustif, quoique rédigé pour le lecteur moyen (vocabulaire non technique, peu de notes de bas de page et une bibliographie pratique), représente pour les chrétiens le fondement solide de ce qu’ils croient et pourquoi.
Une théologie systématique doit faire preuve des qualités suivantes : (1) une intégrité herméneutique, (2) une cohérence doctrinale, (3) une pertinence éthique, (4) une capacité d’expliquer la vision du monde et (5) une continuité traditionnelle. Là où ces vertus sont présentes et agissantes, elles rendent possible une bonne systématisation qui est très appréciable pour le commentateur. En examinant attentivement chaque détail du texte qu’il se prépare à exposer, la théologie systématique lui permet de contempler le tableau théologique complet – un tableau qui tient compte non seulement des conclusions étudiées et tirées de l’histoire de l’Église, mais également du caractère progressif de la révélation qui culmine dans la révélation complète de Dieu[3]. (Pour un survol chronologique de la progression de la révélation, voir l’appendice.)
La définition qu’on pourrait donner de la théologie systématique tiendrait compte des observations suivantes de John Murray :
Lorsque nous pesons correctement la proposition que les Écritures constituent le dépôt de la révélation spéciale, qu’elles sont les oracles de Dieu, qu’en elles Dieu vient à notre rencontre et s’adresse à nous, nous révèle son incompréhensible majesté, nous ordonne de connaître et d’accomplir sa volonté, nous dévoile le mystère de son conseil et déroule les desseins de sa grâce, alors, de toutes les sciences et disciplines, la théologie systématique paraît la plus noble, non une pensée froide et impassible, mais une réflexion qui suscite une adoration émerveillée et exige l’exercice le plus acharné de toutes nos facultés. C’est la plus noble de toutes les études parce que son champ d’application s’étend à tout le conseil de Dieu et qu’elle s’efforce, comme nulle autre discipline, de mettre en valeur les richesses de la révélation de Dieu de la manière la plus ordonnée et la plus universelle, conformément à sa méthode et à sa fonction particulières. Tous les autres secteurs de la discipline théologique mettent leurs découvertes au service de la théologie systématique, ce qui apporte toute la richesse du savoir tiré de ces disciplines dans l’intérêt de la systématisation plus inclusive qu’elle entreprend[4].
La théologie systématique cherche à exposer de manière complète et thématique les doctrines bibliques centrées sur les personnes du Dieu trinitaire, leurs projets, et leurs plans concernant le monde et l’humanité. Elle commence par informer l’intellect (savoir et comprendre). Puis l’intellect façonne ce que nous croyons et aimons dans notre cœur. Notre volonté désire ce que nous aimons et repousse ce que nous haïssons. Enfin, nos actions s’accordent avec ce que nous désirons le plus. L’esprit façonne les affections qui, à leur tour, déterminent la volonté, laquelle oriente les actions. La théologie n’a pas atteint son but aussi longtemps qu’elle n’a pas réchauffé le cœur (affections) et contraint la volition (le vouloir) à agir en obéissant à son contenu[5].
[1] Charles Spurgeon, cité dans Iain H. Murray, The Forgotten Spurgeon, Londres, Banner of Truth, 1973, p. 9.
[2] James I. Garrett, Systematic Theology: Biblical, Historical, and Evangelical, Grand Rapids, Mich., Eerdmans, 1990, vol. 1, p. 8.
[3] Cette idée est celle de notre collègue Trevor Craigen, professeur de théologie à la retraite, Master’s Seminary.
[4]John Murray, « Systematic Theology », dans The Collected Writings of John Murray, Edimbourg, Banner of Truth, 1982, vol. 4, p. 4.
[5] William Ames fait remarquer que la théologie devait déboucher sur l’eupraxia, « la bonne pratique ». The Marrow of Theology [1629], traduit et édité en anglais par John Dykstra Eusden, réimpr., Grand Rapids, Mich., Baker, 1997, p. 78.