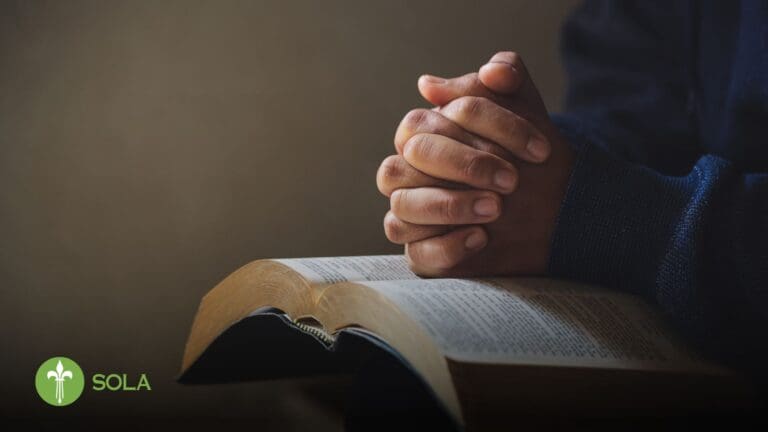La GPA, gestation pour autrui, technique de procréation qui nécessite le recours à des mères porteuses[1], est régulièrement citée dans l’actualité. Les pressions existent pour une reconnaissance de cette technique par l’état français, même si ce n’est pas pour l’instant à l’ordre du jour[2]. Cet article donne quelques pistes de réflexion pour les chrétiens, avec des données bibliques, tout en leur fournissant aussi des arguments non-bibliques, pour défendre un point de vue respectueux des personnes avec des arguments que les personnes non-chrétiennes peuvent aussi recevoir.
Les lois de Dieu sont bonnes en elles-mêmes et universellement valables, car elles répondent aux besoins profonds des individus et de la société et cherchent le bonheur de tous. Le chrétien n’a rien à craindre de la vérité : en s’appuyant sur elle, il peut exposer à la lumière les mythes et les contre-vérités de la société et établir le bien-fondé de ses propres principes par des arguments rationnels. Stott donne, par exemple, des arguments anthropologiques, sociologiques et psychologiques en faveur de l’éthique sexuelle chrétienne. »[3]
Des pratiques contestables
Nous nous proposons de citer quelques arguments qui révèlent les dangers de la généralisation de ces pratiques.
1) La femme considérée comme un moyen de production dans le cadre de la GPA
Sylviane Agacinski[4], féministe convaincue, s’élève contre ces pratiques et montre à quel point l’envers du décor est sordide. Elle déplore le fait que certaines femmes deviennent des « outils vivants »[5] puisqu’elles ne sont que des moyens pour faire des enfants en portant l’enfant d’une autre femme.
2) La femme, esclave moderne dans le cadre de la GPA
La gestation pour autrui est une désignation curieuse. Elle reprend le vocabulaire animalier (ce qui n’est pas valorisant pour la femme) et passe sous silence qu’il ne s’agit pas « simplement » de gestation, mais bien d’une grossesse à part entière, accouchement compris !
De plus, la « mère porteuse » voit toute sa vie contrôlée pendant plusieurs mois. C’est ainsi qu’aux Etats-Unis, les mères porteuses doivent s’engager à respecter tout un protocole qui doit favoriser le bon déroulement de la grossesse afin que l’enfant puisse être « livré » en bonne santé. Ce protocole restreint drastiquement leur liberté dans les domaines suivants : alimentation, sexualité (pendant le premier trimestre au moins), hygiène, activités (tous les loisirs ne sont pas possibles)…
Agacinski souligne ainsi que la mère porteuse est reléguée au rang d’un instrument, servant « d’instrument de procréation comme un four sert à cuire le pain »[6] puisque l’ensemble de sa vie, y compris ce qu’il y a de plus personnel et intime, est aliéné. La mère porteuse dispose ainsi parfois d’une liberté plus restreinte que celle des esclaves des siècles passés puisque toute son intimité est sous contrôle !
3) Des questions juridiques épineuses
Muriel Fabre-Magnan[7] montre que les aspects juridiques de la GPA ne sont pas anodins. Voici quelques questions qu’elle soulève :
- Comment gérer les déchirements entre couples payeurs et mères porteuses qui voudraient finalement garder l’enfant ?
- Que se passe-t-il si l’enfant naît avec un handicap ? La mère porteuse sera-t-elle responsable ? Son indemnité sera-t-elle diminuée ?
- Que se passe-t-il si le couple se déchire pendant la grossesse et que plus personne ne veut l’enfant ? Ou si les deux le veulent ?
- Que se passe-t-il si l’enfant ne naît pas en bonne santé ? S’il subit un dommage pendant la grossesse ? S’il y a fausse couche ou si l’enfant meurt pendant la grossesse ou l’accouchement ? Et si la mère porteuse transmet une maladie ou une infection ? Faut-il réduire les indemnités qui lui sont versées ? La mère porteuse pourrait-elle être poursuivie en justice ?
- Mêmes questions concernant la mère porteuse : que se passe-t-il si elle subit des dommages (mort, ou dégâts irréversibles, césarienne, épisiotomie…) ?
Alors que le temps de travail est limité et qu’il existe un droit à la vie privée, on retrouve encore une fois des conditions qui s’approchent de celles de l’esclavage puisque pratiquement toute la vie d’une personne est contrôlée par une autre, et ce 24 heures sur 24, 7 jours par semaine pendant plusieurs mois !
Puisqu’aucune législation n’est compatible avec de telles exigences, la GPA est traitée comme un don. Il n’y a donc pas de salaire, mais une somme versée comme indemnisation… Toutefois, dans les faits, il s’agit bien d’une vente. L’enfant est fabriqué pour être remis à d’autres. Bien sûr, juridiquement, on ne peut parler de vente depuis l’abolition de l’esclavage. Mais une vente étant « une convention par laquelle l’un s’oblige à livrer une chose et l’autre à la payer »[8], on retrouve bien cette idée dans la GPA. L’enfant est la contrepartie du prix payé par les parents d’intention.
4) L’enfant : un produit fabriqué
Dans ce qui précède, il apparaît que l’enfant à naître n’est considéré que comme un produit que l’on fabrique et qui peut s’acheter et se vendre. De plus, les parents effacent en général toute relation entre les enfants et les donneurs. L’enfant est alors privé de lignée génétique, sans son consentement[9] et se trouve dépossédé de son droit à connaître ses origines.
Alors qu’il a fallu des décennies pour souligner que l’enfant est une personne et montrer l’importance de la vie intra-utérine, la pression financière des grands laboratoires et des personnes favorables à la GPA ont relégué l’enfant à une chose. Il se fabrique et s’achète au mépris de toute dignité humaine.
Quelques considérations éthiques
Le texte de Genèse 1-2 nous rappelle que l’être humain est créé distinct du reste de la création. S’il est créé le sixième jour, comme les animaux terrestres, il est le seul à porter l’image de Dieu, ce qui lui donne une dignité intrinsèque[10]. L’être humain est créé homme et femme (Gn 1,27-28), l’homme et la femme possédant ainsi une égale dignité mais étant différents l’un de l’autre.
En s’élevant contre une prétendue injustice pour les « couples » homosexuels qui ne peuvent avoir d’enfants, les partisans de la GPA (et même de la PMA dans certains cas) confondent différences naturelles biologiques et ce qui relève réellement de l’injustice[11]. Dans sa rébellion et sa volonté de toute-puissance, l’être humain semble vouloir fixer de nouvelles règles concernant la procréation et la parentalité, avec tous les risques que cela comporte.
Il y a plus de 2’700 ans, le prophète Amos dénonçait les pratiques des plus riches qui vendaient le pauvre « pour une bouchée de pain » (Am 2,6, version Semeur 2000). Aujourd’hui, on vend des vies : les enfants mais aussi les mères porteuses souvent pauvres et qui sont de plus en plus délocalisées pour des raisons de coût. Agacinski souligne qu’une mère porteuse indienne est indemnisée huit fois moins qu’une mère porteuse américaine[12], d’où la congélation des embryons et la délocalisation de la production !
Les désirs (légitimes et compréhensibles) de certaines personnes d’avoir des enfants ne peuvent conduire à priver des êtres humains de leur droit le plus élémentaire à la dignité. Il faut donc rappeler que « le ventre d’une femme n’est pas un coffre à louer pendant neuf mois »[13]. Il n’est pas concevable que, sous la pression économique, des êtres humains soient encouragés à se dépouiller de leur liberté personnelle et de leur dignité.
« Malheur à vous qui nommez le mal bien et le bien mal… » (Es 5,20, version Semeur 2000). Coupé de Dieu, l’être humain ne sait plus distinguer le bien du mal et il érige ses propres normes. On en arrive à croire que tout ce qui est faisable doit nécessairement être fait.
Par exemple, Agacinski rappelle que l’excision est possible, et même pratiquée dans certaines cultures, mais est (heureusement) interdite en France[14]. Les pro-GPA arguent du fait que si la GPA est possible à l’étranger, cela doit aussi l’être en France pour ne pas réserver la possibilité d’en « bénéficier » aux plus riches. Pourtant, personne ne serait prêt à appliquer ce principe à l’excision. La pratique dans un autre pays ne peut et ne doit pas être la norme. Elle ne doit pas non plus court-circuiter la réflexion éthique.
Pour conclure
Ces réflexions partielles sur un sujet complexe aident à développer des arguments pour mettre en garde contre certaines dérives. Les chrétiens peuvent s’appuyer sur des éléments bibliques pour contrer de telles pratiques. Ils peuvent aussi montrer la pertinence des principes bibliques dans notre société, même pour des sujets aussi pointus que la procréation assistée.
Les promoteurs de la GPA se cachent derrière des expressions comme « justice sociale », « égalité » (des droits), « don » (de gamètes, de son utérus) pour cacher un sordide trafic d’êtres humains les plus vulnérables (les femmes, les enfants) au profit d’une minorité riche et bien-pensante. S’opposer à ces mensonges n’est pas faire preuve de ringardise, c’est défendre l’inaliénable dignité de tout être humain créé en image de Dieu.
[1] Site : https://fr.wikipedia.org/wiki/Gestation_pour_autrui, consulté le 7 novembre 2017.
[2]Site : http://www.huffingtonpost.fr/sylvie-mennesson/2-priorites-en-faveur-de-la-gpa-pour-mettre-fin-a-la-discriminat_a_23044717/, consulté le 7 novembre 2017.
[3] André POWNALL, « Action sociale et vision du monde », Fac Réflexion 14, octobre 1989, p. 15-16.
[4] Sylviane AGACINSKI, « Corps en miettes », Flammarion, 2013 (20091).
[5] Ibid., p. 18.
[6] Ibid, p. 95.
[7] Muriel FABRE-MAGNAN, « La gestation pour autrui », Fayard, 2013. Ce petit ouvrage est très accessible, même pour les non-juristes, l’auteur de ces lignes peut en témoigner. Il est recommandé pour une première approche des imbroglios juridiques qui entourent la GPA et montre l’hypocrisie des promoteurs de cette technique.
[8] Article 1582 du Code civil, www.legifrance.gouv.fr, consulté le 7 novembre 2017.
[9] AGACINSKI, op., cit., p. 111, souligne le paradoxe d’une loi française qui peut obliger un homme à reconnaître la paternité d’un enfant si un test génétique le prouve, tandis que l’anonymat règne dans le cas de procréation assistée.
[10] Ce que reconnaît le préambule de la Déclaration universelle des droits de l’homme de 1948.
[11] La question de l’homosexualité n’est pas traitée ici.
[12] AGACINSKI, op. cit., p. 59-60.
[13] Citation de AGACINSKI, op. cit., p. 104.
[14] AGASINSKI, op. cit., p. 78.