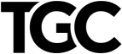Sur ma table de travail, un livre de poche, collection « folio ». Petit format : une centaine de pages. La valeur ne tient pas au nombre de pages… Sur la couverture, la photographie d’une femme, assise au sol, le dos contre le mur, la tête en arrière, l’air absent. Reproduction de l’affiche du film, tiré par l’auteur, de son roman : La femme gauchère. Peter Handke a publié cet ouvrage, en allemand, en 1976.
Peter Handke est né en 1942, en Autriche. Il est à la foi, romancier, dramaturge, scénariste et réalisateur. Je le lis depuis longtemps, et l’ai toujours perçu comme un très grand écrivain, tant sur le plan de la langue qu’au niveau de la vision qu’il transmet, de l’Homme et du monde. Je n’ai donc pas été étonné lorsque l’on a appris qu’il recevait (enfin !) le Prix Nobel de Littérature, en 2019.

Pourquoi avoir choisi La femme gauchère, plutôt qu’une autre œuvre ? J’avoue que ce livre m’a hanté, au point d’y revenir, pour la profondeur de ce que l’on y pressent, mais aussi, pour sa part de mystère. Avec cet écrivain, malgré la limpidité de la langue, la compréhension n’est pas immédiate. Il interroge, et toute lecture ne peut se donner que comme « une » lecture, une approche, subjective, discutable, du sens de l’œuvre, qu’elle n’épuise pas.
Je proposerai donc deux parcours de lecture possibles. Et chaque fois, je porterai ce qui vient de Peter Handke à la lumière de la Bible, c’est-à-dire que je m’autoriserai à sortir, après m’y être plongé, du cadre de la pensée de l’auteur.
Présentation : «Sans raison», sous le coup d’une illumination qu’elle n’expliquera pas, la femme de ce récit demande à son mari de s’en aller, de la laisser seule avec son fils de huit ans. La voici, désormais, «libre», bien que le mot, trop grand, trop précis, ne soit pas prononcé, ni pensé peut-être. Avec la simplicité déroutante que nous lui connaissons, Peter Handke impose puissamment à l’enchaînement des faits et gestes insignifiants de la vie quotidienne une dimension universelle et tragique.
Savoir ce que l’on veut !
Si le Mouvement de Libération des Femmes est moins actif, dans l’espace public, aujourd’hui, la revendication féministe était plus prégnante à l’époque de l’écriture de l’ouvrage et, à ce niveau, avec cet ouvrage, Peter Handke est bien « dans l’air du temps ».
L’héroïne, Marianne, est mariée à Bruno. Ils ont la trentaine, un petit garçon, et lui possède une bonne situation. Au moment où commence le récit, elle ne travaille pas, mais elle reprendra son activité de traductrice.
Est-ce un couple qui ne s’entend pas ? Non : pas de manière évidente. Toutefois, l’époux a une façon de se comporter qui doit attirer l’attention. Au début du roman, il revient de voyage d’affaires, et se sent si heureux qu’il ose déclarer au garçon du restaurant, où ils mangent ensemble : « Vous savez, ma femme et moi voudrions coucher ensemble tout de suite. » Comment faut-il entendre ce « ma femme et moi » ? Est-il certain qu’elle le veuille aussi ? Elle n’a même pas été consultée. Certes, on ne constate pas de violence physique, mais la violence morale est également une forme de violence. Et elle semble bien être la cause d’un acte, essentiel pour la suite du roman, que l’héroïne va commettre : celui de se séparer de son mari.
« La femme : « J’ai eu tout à coup l’illumination (…) que tu t’en allais d’auprès de moi, que tu me laissais seule. Oui, c’est ça, Bruno, va-t’en. Laisse-moi seule. » Le personnage semble plus obéir à une impulsion qu’à une réflexion, longuement mûrie. Néanmoins, la décision est posée, et le couple se sépare.
Posons à nouveau la question du pourquoi. Peter Handke fournit des clefs de compréhension, mais disséminées, au fil du texte. Au lecteur de les saisir. Il déclare, à la fin du récit, tandis que le personnage se regarde dans un miroir : « Et plus personne ne t’humilieras jamais. » Il est donc bien question d’un rapport de domination. Le récit montre une femme qui ose reprendre son indépendance.
Le projet de Handke ne consiste pas à contester l’institution sociale et religieuse du mariage. Le sens est à chercher au-delà, à un niveau plus philosophique. Nous nous arrêterons sur cette question de l’humiliation, parce qu’elle est essentielle. Handke n’est pas caricatural. Cette violence, qui s’exerce sur elle, Marianne la trouve logée en elle-même également. En effet, elle aime profondément son enfant, mais on constate qu’elle peut être capable de gestes incontrôlés, et violents, à son égard. Par exemple : « Tout à coup, de toutes ses forces, elle lança la brosse contre lui mais atteignit seulement un verre qui se cassa. Elle s’avança poings serrés contre l’enfant qui ne faisait que regarder. » Que veut dire l’auteur ? Que nul n’est à l’abri de la manifestation du mal en lui.
Ne lit-on pas, dans l’Évangile, « Hypocrite, ôte premièrement la poutre de ton œil, et alors, tu verras comment ôter la paille de l’œil de ton frère. » ( Matthieu 7 : 5 ) Soyons lucides, capables de discerner le mal en nous-mêmes, avant de le voir en autrui…
Violence morale du mari sur sa femme. Violence physique de la mère sur son enfant. La violence est ainsi donnée comme sous-jacente aux rapports humains les plus intimes. D’ailleurs, une fois encore, ce qui pourrait apparaître comme un détail, dans l’ouvrage, vient nous éclairer. Il s’agit d’un mot, étranger, placé par Handke, dans la bouche de la femme : « La femme dit : « Dans le livre que je suis justement en train de traduire, se trouve une citation de Baudelaire : la seule action politique qu’il comprenait, c’était la révolte. Et moi j’ai pensé soudain : la seule action politique que moi je comprenne, c’est l’amok. » Qu’est-ce que « l’amok » ? Le grand écrivain, également autrichien, Stefan Zweig (1881-1942), avait choisi ce titre pour l’un de ses récits. Le mot renvoie à la Malaisie, et il désigne une forme de folie meurtrière, dont un individu peut être pris, soudain. Bien sûr, ce n’est pas le cas de ce personnage, Marianne. Le récit de Handke n’est pas violent. Il a même la douceur de la petite musique de la vie quotidienne. Mais, sous-entend Handke, au plus profond de nous-mêmes peuvent se loger des aspirations, des idées inquiétantes. C’est le cas de Marianne : elle ne comprend, en politique, que l’action violente. Soit : si l’on veut que quelque chose change, il faut être violent. Et Marianne l’est, de par la décision qu’elle prend.
Peut-être Handke rejoint-il là, aussi, une étrange parole de l’Évangile : « Ce sont les violents qui s’emparent du Royaume de Dieu. » Parole dure à entendre ? Ne pourrait-on l’interpréter comme ceci : le Royaume, il faut le vouloir, de tout son être ! Dans le livre de l’Apocalypse, on lit : Parce que tu es tiède et que tu n’es ni froid ni bouillant, je vais te vomir de ma bouche. » (3 : 16 ) « Violence » peut aussi être entendu au sens de : la détermination. Être fortement déterminé. « Savoir ce que l’on veut », comme on le formule familièrement. C’est le cas de ce personnage. Marianne sait ce qu’elle veut, ou, au moins, ce qu’elle ne veut pas ! Et vous ?
Posséder ce que l’on veut ?
Demandons-nous encore : le personnage de Marianne sait-il vraiment ce qu’il veut ? De nombreuses œuvres romanesques sont construites sur la base d’une quête, menée par le héros, fermement décidé à obtenir l’objet de sa recherche. Ce n’est pas le cas dans La femme gauchère. Marianne est plutôt un personnage qui se laisse porter par le cours des événements. La décision de se séparer de Bruno n’est pas donnée, nous l’avons vu, comme mûrement réfléchie. Elle lui dit : « J’ai eu tout à coup l’illumination (…) Laisse-moi seule. » Pour autant, la notion de quête ne disparaît pas. Quelle est la nature de cette quête et quels en sont les indices, au fil de l’œuvre : voilà à quoi nous répondrons à présent.
Juste après avoir pris la décision de la séparation, Marianne est emplie d’une joie soudaine, qui fait irruption en elle : « Il retourna vers l’hôtel et elle sortit du parc. Dans la longue allée qui menait au lotissement, elle fit un entrechat et se mit soudain à courir. Chez elle, elle ouvrit les rideaux, alluma le tourne-disque et fit mine de danser avant même que la musique ne commence. » Cette joie apparaît comme le signe, physique, d’une libération, mais, à la fin du même paragraphe, Handke suggère que, dans son âme elle-même, quelque chose de nouveau fait irruption : « Elle alla au miroir dans le couloir et dit : « Jésus – Jésus – Jésus ! » Pourquoi le nom de Jésus ? Le romancier n’explicite pas. Mais le nom de Jésus est bien prononcé, et trois fois, ce qui n’est pas un hasard, le chiffre « trois » renvoyant, bien évidemment à la Trinité. On pourrait penser que cela n’a aucune importance, et que l’héroïne prononce ce nom machinalement. Certes. Néanmoins, cette trame chrétienne va être filée, dans le roman.
D’autres personnages entourent Marianne, et notamment son amie, Franziska. Après la rupture, elle lui demande : « Et que vas-tu faire, maintenant, seule ? » La femme : « Rester assise dans la chambre et ne plus savoir que faire. »Comment ne pas songer aux Pensées du philosophe français du dix-septième siècle, Pascal, et notamment à celle-ci : « Tout le malheur des hommes vient de ne savoir pas demeurer en repos, dans une chambre. » Dans la perspective pascalienne, il s’agit de fuir ce qu’il appelle « le divertissement », afin de se confronter à la pensée de la mort. La solitude est un thème-clef de ce roman. La même Franziska demande à son amie : « Au fait, est-ce que tu as vu hier à la télévision le reportage sur les personnes seules ? » La femme : « Je ne me souviens que du moment où l’interviewer a dit à quelqu’un : « Racontez donc une histoire de solitude ! » On trouve là un procédé, nommé, en littérature : la mise en abyme du récit, dans le récit. Effectivement, cette « histoire de solitude »pourrait bien être celle que le narrateur est en train de nous raconter.
Même si c’est presque malgré elle, Marianne a bel et bien choisi la solitude, ce qui fait d’elle un être à part, dans cette société de consommation, évoquée autour d’elle, par Handke. Ce choix fait d’elle un être à part, dont la trajectoire est singulière. Son mari ne la comprend absolument pas, et il rapporte ainsi les propos de Franziska : « Tu sais ce qu’elle dit de toi ? – Que tu es une mystique pour toi seule. Oui, c’est ça, tu es une mystique, une mystique, beuuah ! Nom de Dieu, tu es malade. J »ai dit à Franziska que quelques électrochocs te ramèneraient à la raison. » Toutefois, Bruno est remis en question par la démarche de sa femme. Ils se revoient parfois, et il lui dit, lors d’une de ces rencontres : « Parfois je crois que tu fais seulement une expérience avec moi, ce qui arrive est destiné à me mettre à l’épreuve. Cette pensée me rassure un peu. » Après une pause : « Hier, à un moment donné, j’ai pensé que ce serait fort aimable, tout de même, s’il existait un Dieu. » On voit bien que, par le biais de ce décalage dans le quotidien, le spirituel fait irruption.
Le récit se poursuit, composé de séquences, séparées par un blanc. Vient un court paragraphe, dont on ne sait pas s’il correspond à l’évocation de la réalité, ou bien s’il est de l’ordre de la vision, poétique : « Elle marchait en plein jour sur une route droite dans un paysage gelé, plat, sans arbres. Elle continuait toujours tout droit. Elle marchait encore ainsi lorsque l’obscurité vint. » Une femme suit donc « son » chemin, sans dévier. Mais notons – hélas – qu’elle ne va pas vers la lumière… Cherche-t-elle le bonheur ? « La femme : « Non, je n’aimerais pas être heureuse, tout au plus apaisée. » »
Quant au dernier indice que l’on peut relever, sur ce parcours, il est lié à une étrange expérience, racontée par la femme : « Il y a bien des années j’ai vu les tableaux d’un peintre américain, quatorze de suite qui devaient représenter les stations du calvaire de Jésus-Christ – tu sais quand il sue le sang sur le mont des Oliviers, quand il est flagellé, etc. Mais ces tableaux n’étaient faits que de surfaces noires et blanches, un fond blanc que traversaient en long et en large des bandes noires. L’avant-dernière station, Jésus est détaché de la croix, était presque entièrement noire et la station après, la dernière, entièrement blanche. Et voici l’étrange : je suis passée lentement devant cette suite de tableaux et arrivée devant le dernier tableau, tout blanc, j’y ai vu, par-dessus, quelques instants durant, vibrer celui qui était presque noir et puis je n’y ai plus vu que le blanc. » L’expérience est d’ordre pictural, mais elle concerne aussi le rapport à la foi. Il est question d’une superposition d’images : le noir vient se superposer sur le blanc. Mais rien n’a de réalité finalement, ni le noir, ni le blanc. Il s’agit d’une illusion d’optique. On saisit bien le message sous-jacent : les réalités spirituelles ne sont que de l’ordre de l’illusion. L’héroïne semble n’avoir eu qu’un vague pressentiment de la vie spirituelle. D’ailleurs, le roman ne s’achève pas sur l’aboutissement, lumineux, de la quête. Au contraire. Une citation de Goethe (1749 – 1832), tirée des Affinités électives conclut le roman. La voici : « Ainsi continuaient-ils tous ensemble, chacun à sa façon, la vie quotidienne, avec et sans réflexion ; tout semble suivre son cours habituel comme dans des cas extrêmes où tout est remis en jeu : on continue à vivre encore comme si de rien n’était. »
Continuer à vivre…
Résumons : une femme prend la décision d’emprunter, selon la terminologie du philosophe Gilles Deleuze (1925–1995), « une ligne de fuite ». La rupture avec son époux, le retour à la solitude, deviennent une expérience existentielle, mal comprise par son entourage. Pourquoi se comporte-t-elle ainsi ? Elle n’en possède pas, elle-même, une conscience claire. Elle obéit à une sorte de nécessité intérieure.
Le romancier suggère que faire un écart, par rapport à son quotidien, peut être un bon moyen d’introduire le spirituel, dans sa vie. Toutefois, cette œuvre n’est pas une œuvre chrétienne, et le trajet du personnage ne débouche pas sur la lumière, la lumière de la vie. Marianne n’a fait que pressentir la lumière…
Une quête spirituelle, même si elle est inconsciente de son objet, peut déboucher sur la lumière de la vérité : « Cherchez, et vous trouverez » (Matthieu 7 :7) dit le Christ. Le romancier Peter Handke a préféré, lui, faire de la marche de son héroïne, un chemin vers l’obscurité : « Elle marchait encore ainsi lorsque l’obscurité vint. »
« Je suis la lumière du monde, dit Jésus, celui qui me suit ne marchera point dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » ( Jean 8 : 12 )