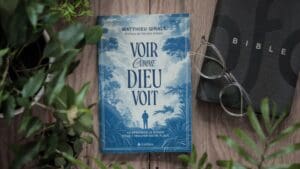De temps en temps, Kevin DeYoung essaie de publier des articles courts comme celui-ci, qui constituent une brève introduction à un sujet de théologie systématique. L’objectif est la clarté. L’approche est la concision. L’idée qui la conduit est de présenter de grands concepts théologiques dans un format d’environ 500 mots (parfois 1000).
La doctrine de l’impeccabilité affirme que le Christ n’était pas seulement sans péché, mais qu’il était incapable de pécher (non posse peccare). En tant que Fils de Dieu incarné, le Christ a été confronté à des tentations réelles, mais ces tentations n’ont pas surgi dans le Christ en raison de désirs pécheurs. Le Christ n’était pas seulement capable de surmonter la tentation, il était incapable d’être vaincu par elle. (Shedd, Dogmatic Theology, 659).
L’impeccabilité de Christ a été largement affirmée au cours de l’histoire de l’Église et elle a été défendue par la plupart des grands systématiciens réformés. Toutefois, dans les 150 dernières années, de nombreux théologiens ont rejeté l’idée que Christ était incapable de pécher, argumentant au contraire que la peccabilité était nécessaire pour que les tentations de Christ soient authentiques et pour que Christ puisse sympathiser avec son peuple. De façon surprenante, même le redoutable Charles Hodge (1797–1878) rejetait l’impeccabilité (Hodge, Systematic Theology, 2:457), ce qui peut être une des raisons pour lesquelles son contemporain W. G. T. Shedd (1820–1894) a fourni une défense spécialement vigoureuse de cette doctrine dans sa Dogmatic Theology.
Pour défendre l’impeccabilité de Christ, Shedd établit trois grands points.
Premièrement, l’impeccabilité de Christ peut être déduite de l’Écriture.
Si Jésus-Christ est le même hier, aujourd’hui et éternellement (Héb. 13:8), il doit être immuable dans sa sainteté. Une sainteté qui pourrait changer serait incohérente avec la toute-puissance de Christ et irréconciliable avec le fait que Christ est l’auteur et le consommateur de notre foi (Héb. 12:2). Christ n’est pas comme le premier Adam en ce qu’il est la source de toute sainteté et que de lui ne peuvent provenir rien d’autre que la vie et la lumière. Si Christ était susceptible de pécher, sa sainteté serait, par définition, ouverte au changement — son obéissance ouverte à la défaillance — même si Christ se révélait, à la fin, fidèle. Un Christ qui pourrait pécher serait un Sauveur auquel on ne peut faire confiance qu’a posteriori.
Deuxièmement, l’impeccabilité de Christ est liée à la constitution de sa personne.
Certes, Christ était doté par l’Esprit d’une grâce extraordinaire, mais Christ n’était pas seulement fortifié pour résister à la tentation, la présence du Logos divin rendait infailliblement certaine la résistance du Christ. Nous ne devons pas penser que les deux natures du Christ opéraient indépendamment l’une de l’autre, comme s’il s’agissait de parties rivales ou de deux sources de connaissance et d’action voilées l’une à l’autre. De même, nous ne devons pas concevoir les deux volontés du Christ comme antagonistes. La volonté finie obéissait invariablement et parfaitement à la volonté infinie, de sorte que le Christ n’a jamais fait l’expérience de la convoitise de la chair contre l’esprit, ni de la convoitise de l’esprit contre la chair (Gal. 5:17).
Mais qu’en est-il de la douleur, de la faim, du chagrin, de la faiblesse et de la mort de Christ ? Comment ces choses sont-elles possibles pour l’homme-Dieu ? Si nous concluons que le Christ est impeccable [sans péché], devons-nous également en conclure que le Christ était incapable de souffrir ? Certainement pas. Shedd fait la distinction entre « tous les défauts et limites innocents du fini » et « les défauts et limites coupables » de l’homme pécheur. Le Fils de Dieu incarné était sujet aux faiblesses qui proviennent d’un corps humain, mais sans les défauts moraux – ou la possibilité de défaut moral – qui proviennent d’une nature humaine.
Au cœur de ce second point se trouve la conviction venant du symbole de Chalcédoine selon laquelle quoi que fît Christ, il le fit comme une personne théanthropique indivisée. En conséquence, Shedd affirme que la capacité de pécher pour Christ doit être mesurée en accord avec « sa très puissante nature ». De même qu’un fil de fer peut être plié, mais qu’une fois soudé à une barre de fer, il devient inébranlable, de même l’homme-Dieu Jésus-Christ est rendu impeccable par l’union des natures humaine et divine (Théologie dogmatique, 660-61). En d’autres termes, alors que le Christ possédait une nature humaine peccable, il était une personne théanthropique impeccable.
Troisièmement, l’impeccabilité est cohérente avec la tentation.
Une des raisons qui a fait assumer une nature humaine par le Logos est que, de ce fait, le Logos pouvait être tenté comme un homme et soit ainsi capable de sympathiser avec les hommes (Héb. 2:14-18). Si nous grandissons l’impeccabilité de Christ de façon telle qu’elle écarte la possibilité pour lui d’être tenté, nous ne sommes plus en accord avec l’Écriture.
Et pourtant, nous ne devons pas absolument assimiler nos tentations aux tentations du Christ. Le même nom grec traduit par « épreuves » (peirasmois) dans Jacques 1.2 est rendu sous forme de verbe par « tenté » (peirazetai) dans Jacques 1.14. Certaines tentations viennent de l’extérieur comme des épreuves et des souffrances – celles que Christ a constamment endurées. Mais il y a aussi des tentations qui viennent de l’intérieur, sous forme de désirs de péché – celles que Christ n’a jamais connues. Lorsque Hébreux 4.15 dit que Christ a été tenté à tous égards comme nous, mais sans pécher, nous devons comprendre la préposition « sans » (choris) comme s’étendant à la fois au résultat des tentations (contrairement à nous, Christ n’a pas péché) et à la nature des tentations (contrairement aux nôtres, les tentations de Christ n’étaient pas pécheresses). En d’autres termes, nous sommes tentés par le monde, la chair et le diable, alors que le Christ n’a jamais été tenté par la chair. Ou, comme l’a dit John Owen, le Christ a affronté la partie souffrante de la tentation ; nous affrontons aussi la partie pécheresse.
L’incapacité du Christ à pécher ne rend pas ses tentations moins authentiques. L’armée qui ne peut être vaincue peut toujours être attaquée (Dogmatic Theology, 662). En fait, les tentations du Christ étaient plus intenses que les nôtres parce qu’il n’y a jamais cédé. Nos tentations vont et viennent, tantôt nous y résistons, tantôt nous y succombons. Mais le Christ n’a jamais cédé et, de ce fait, l’expérience de la tentation n’a fait que croître tout au long de sa vie. En cela, le Christ est capable de compatir avec nous dans notre expérience humaine de la tentation, même si, en tant qu’homme-Dieu, il était incapable de céder à ces tentations.