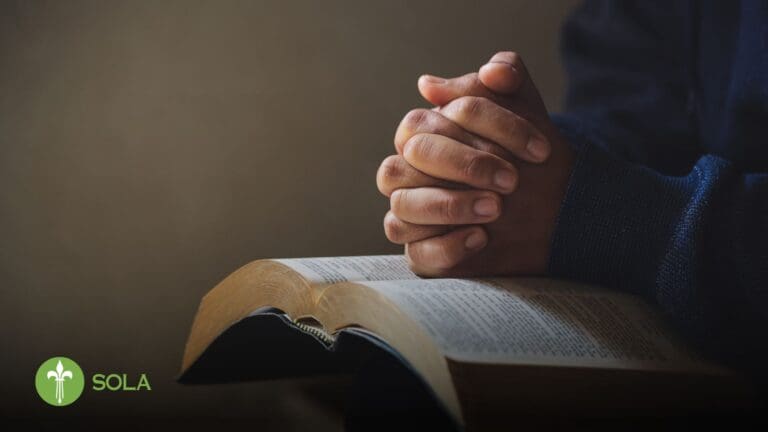Introduction
Mon fils Wesley (10 ans) était assis sur une chaise à côté de moi . . . mais pas juste à côté. On venait de vivre un moment de tension, lui et moi, sur le terrain de basket à proximité de la maison de papi et mamie. J’avais essayé de lui donner quelques conseils (le basket était, quand même, MON SPORT quand j’étais plus jeune !), mais Wesley ne voulait pas de mes conseils. Il voulait se débrouiller tout seul. Ma réaction face à son refus de m’écouter, une réaction ni patiente ni douce, a provoqué le moment de silence qu’on était en train de vivre, assis à côté l’un de l’autre . . . mais pas juste à côté.
Après quelques minutes, Wesley, un peu hésitant et timide, a pris la parole : « Papa, parfois quand j’ai des émotions en moi, je n’arrive pas à parler. C’est comme si un chien commence à aboyer dans ma tête, et il fait peur au hibou de sagesse. Et j’ai besoin du hibou pour savoir quoi dire. Mais il se cache quand le chien lui fait peur. »
Époustouflé, ma voix tremblant un peu, je lui ai demandé, « Où, mon fils, as-tu entendu parler du chien et du hibou ? »
Avec plus de courage maintenant, Wesley m’a répondu, « Ma maîtresse nous en a parlé cette semaine quand on a traité les émotions. »
Le parent réfléchi (un rappel)
Dans un article précédent (que je vous encourage à lire ICI avant d’aller plus loin avec celui-ci), j’ai évoqué la notion du « parent réfléchi » en lien avec l’enseignement de l’apôtre Paul en Tite chapitre 2. Ce chapitre biblique vise la famille chrétienne en encourageant tous les membres de la famille à résister à la tendance naturelle à se laisser glisser dans un fonctionnement en mode « auto-pilote » dans le contexte de la maison. Une parentalité irréfléchie sera dominée par un ensemble d’influences intérieures et extérieures, que l’on en soit conscient ou pas, qui ne seront pas forcément porteuses de bons fruits dans la vie de notre enfant.
Le texte de Tite 2 nous présente la grâce de Dieu, « source de salut pour tous les êtres humains » (v11), comme un enseignant, un professeur qui nous apprend à renoncer aux mauvaises influences et tendances de notre passé (v12a), et « à vivre dans le temps présent conformément à la sagesse, la justice et la piété » (v12b) ; et ceci dans l’attente du retour imminent de « notre grand Dieu et Sauveur Jésus-Christ » (v13).
Un des objectifs de cet enseignement, selon Paul, c’est d’honorer pleinement (S21) ou de rendre attrayant (Semeur) l’Évangile aux yeux des membres de notre famille et de notre entourage (v10b). Selon Paul, c’est la grâce de Dieu qui nous apprendra à être des parents réfléchis à l’égard de notre passé, de notre présent, et de notre futur afin que Christ et sa « doctrine » soient glorifiés par ce qui se passe dans nos maisons.
Le Père des lumières
Avec le fondement posé par Paul en Tite 2 en tête, j’aimerais orienter nos regards vers un autre passage biblique écrit par un autre écrivain apostolique : Jacques, le frère de Jésus. Mon objectif dans ce deuxième article de la série sera de méditer l’influence de la grâce de Dieu sur notre comportement présent dans le contexte familial, et notamment dans des situations de tension relationnelle.
Comme Paul, Jacques enracine ses conseils éthiques dans les vérités puissantes de l’évangile. Il décrit de manière imagée en 1.13-15 la pente glissante de la tentation qui commence avec un désir naturel (c’est-à-dire issu de notre nature déchue) et qui, encouragée par notre volonté humaine, donne naissance au péché (tout ce qui nous sépare de Dieu et de son bon plan pour nos vies). Quel est le fruit du péché dans notre âme et dans nos relations ? La mort. Voilà un des messages bibliques les plus anciens et les plus incontestables : le péché déchire et détruit l’être humain et les relations humaines.
Mais Jacques ne s’arrête pas là. En 1.16-18, il nous prêche la bonne nouvelle de la grâce :
Ne vous y trompez pas, mes frères et sœurs bien-aimés : tout bienfait et tout don parfait viennent d’en haut ; ils descendent du Père des lumières, en qui il n’y a ni changement ni l’ombre d’une variation. Conformément à sa volonté, il nous a donné la vie par la parole de vérité afin que nous soyons en quelque sorte les premières de ses créatures.
La dernière phrase du verset 18 suggère que l’œuvre de la grâce de Dieu dans nos vies (tout bienfait et tout don parfait) a comme objectif de nous distinguer d’une certaine manière des autres créatures, nous les bénéficiaires de sa grande générosité en Christ. Alors que Jacques ne le dit pas aussi explicitement que Paul en Tite, une de ses préoccupations ici est clairement avec le message annoncé par notre comportement, une forme de « justification horizontale » qui montre ou qui rend visible (2.18-19) aux yeux de ceux qui nous entourent (y compris les membres de nos familles) une foi authentique dans la seule parole « qui peut sauver notre âme » (1.21).
Effectivement, notre Dieu est le Père « des lumières », celui qui donne vie à des enfants qui brillent ! (cf. Mt 5.14-16 ; 2 Cor 4.6 ; Eph 5.8 ; 1 Thess 5.5) Mais quelle forme prend notre lumière en tant que parents ? De quelle manière est-ce que ma foi en Christ est « justifiée » ou rendue explicite d’une manière vérifiable dans ma maison et au sein de mon entourage ? Selon Jacques (et Jésus !), ce seront les œuvres que la grâce de Dieu produira dans ma vie qui feront briller ma lumière et qui « justifieront » ma foi en Christ aux yeux de mes proches.
Prompt à écouter
Dans le premier article de cette série, j’ai parlé brièvement de mon combat avec la colère dans ma maison. Plutôt que de faire briller la lumière de Christ au sein de ma famille, mon comportement malsain en situation de tension relationnelle jetait une ombre sur certains moments que l’on passait ensemble et remettait en question l’efficacité de l’œuvre de la grâce dans ma vie.
Alors que la pensée de Jacques à ce sujet ne se limite certainement pas au contexte familial, les conseils qui suivent immédiatement son annonce explicite de l’évangile en 1.16-18 ont énormément de valeur pour ceux qui ont du mal à honorer le Seigneur en situation de friction relationnelle. Voici les conseils (1.19-20) :
Ainsi donc, mes frères et sœurs bien-aimés, que chacun soit prompt à écouter, lent à parler, lent à se mettre en colère, car la colère de l’homme n’accomplit pas la justice de Dieu.
Pendant des années, ma femme a prié pour moi en s’appuyant sur ces versets afin que, par la grâce de Dieu, j’apprenne à « accomplir la justice de Dieu » au sein de notre famille ; et ceci particulièrement dans les moments « chauds ». Aujourd’hui, toute ma famille témoigne de l’exaucement de ces prières précises dans ma vie. J’aimerais partager avec vous quelques clés de mon apprentissage aux pieds de « professeur Grâce » en lien avec ces conseils de Jacques, qui commencent ainsi : Que chacun soit prompt à écouter.
La grâce de Dieu m’apprend à écouter avant de parler, le contraire de ce que je fais naturellement dans les situations de tension relationnelle.
Voici une première clé : la grâce de Dieu m’apprend à écouter avant de parler, le contraire de ce que je fais naturellement dans les situations de tension relationnelle. Et attention ! Parler n’est pas simplement quelque chose qu’on fait avec nos bouches. Je suis capable de faire des discours pleins d’accusations et d’autojustifications sans prononcer un seul mot à l’oral. Quand la « chaleur » monte dans une situation de friction familiale, une voix commence à parler dans ma tête. Et les premiers mots qui me viennent à l’esprit ne sont jamais « empreints de douceur et de sagesse » (cf. Jc 3.13). Si je donne expression verbale au discours malsain qui se lance dans ma tête, ce qui sortira ressemblera au « venin mortel » ou à « l’eau amère » dont il est question en Jacques 3.7-12.
Si je veux, par contre, sous l’influence de la grâce, « accomplir la justice de Dieu » aux yeux des membres de ma famille en situation de conflit, il me faut « une sagesse d’en haut » qui « est tout d’abord pure, ensuite porteuse de paix, douce, conciliante, pleine de compassion et de bons fruits, sans parti pris et sans hypocrisie » (Jc 3.17). Mission impossible ? Oui, pour un homme pécheur comme moi qui n’arrive pas, par ses propres moyens, à « dompter » sa langue (cf. Jc 3.2-6), que ce soit celle qui est dans sa bouche ou celle qui est dans sa tête.
Lent à parler
Le problème pour des personnes comme moi, c’est que notre réaction émotionnelle face à la friction relationnelle provoque de manière quasi instantanée ce discours malsain intérieur. Pour certains d’entre nous qui réfléchissons à haute voix, le lien avec la bouche se fait automatiquement et rapidement. Pour d’autres, le discours intérieur s’exprimera sans mots, avec un langage corporel. Mais dans les deux cas, la réaction est souvent rapide.
Ce qui est important à savoir, c’est que ces réactions rapides, qu’elles soient verbales ou corporelles, sont « irréfléchies ». Elles sont le fruit d’un fonctionnement en mode « pilote automatique », sous l’influence de nos désirs naturels qui mènent au péché (1.15). Jacques associe ce genre de réaction à une « sagesse » qui ne vient pas d’en haut, mais qui est plutôt « terrestre, purement humaine, démoniaque » (3.15 . . . selon 2.18, même les démons croient en Dieu et tremblent devant lui, une affirmation qui devrait nous faire trembler à chaque fois qu’on se laisse dominer par une « sagesse » qui ne vient pas d’en haut). Dans le vocabulaire de mon fils, Wesley, il s’agit de la « sagesse » aboyante et instinctive du chien agité plutôt que la sagesse douce et réfléchie du hibou calme et posé.
Une deuxième clé de 1.19-20, alors, concerne l’allure de notre réponse : la grâce de Dieu m’apprend à me ralentir. Encore une fois, c’est le contraire de ce que je fais naturellement en situation de tension relationnelle. Dans mon expérience, le fait d’être lent à se mettre en colère s’associe intimement au fait d’être lent à parler. Et la meilleure stratégie de ralentissement que j’ai trouvée, c’est d’apprendre à être prompt à écouter !
Une stratégie de ralentissement : trois formes d’écoute
Avec ce fondement biblique en tête, j’aimerais partager avec vous une stratégie de ralentissement qui implique trois formes d’écoute : l’écoute de mon émotion, l’écoute du Seigneur, et l’écoute de l’autre.
Peut-être vous trouvez surprenant le fait que la liste ne commence pas avec l’écoute du Seigneur. Et s’il était question d’une hiérarchie d’importance, je serais entièrement d’accord avec vous. Mais cette liste reflète mon expérience sur le plan chronologique quand une situation de tension relationnelle provoque en moi une réaction émotionnelle. Alors que j’aimerais dire que mes premières pensées dans une telle situation m’orientent vers Dieu et m’encouragent à faire appelle à lui, en réalité, ce n’est que très rarement ce qui se passe dans ma tête.
L’écoute de mon émotion
Le point de départ dans mon apprentissage d’une sagesse d’en haut pour une gestion « juste » et porteuse de paix des situations de friction familiale était la découverte de ma capacité d’interroger mon émotion. C’était dans le contexte d’un cours de Counseling Biblique avec Matthieu Caron que j’ai fait connaissance d’un certain nombre de questions qui m’aident à entrer en dialogue avec mon émotion : un dialogue dont un des objectifs est de me ralentir dans mes réactions malsaines, dans mon fonctionnement en mode « pilote automatique ».
Voici deux premières questions : « Qui es-tu ? » et « Qu’est-ce que tu veux me dire ? ». Le défi initial sera de déterminer l’identité et le message de mon émotion. Une diversité de listes et de « roues des émotions » nous expose à un vocabulaire et des définitions qui nous aident à mettre des mots sur notre ressenti. Si je réalise, par exemple que je suis irrité ou énervé (deux expressions de la colère), aujourd’hui je sais que la manifestation d’une forme de colère veut dire que je ne suis pas d’accord avec quelque chose que je viens de vivre : que ce soit un propos, un comportement, une attitude, ou une situation. Comme un voyant qui s’allume sur le tableau de bord de ma voiture, les diverses formes de colère m’avertissent à différents niveaux du fait qu’il y a un désaccord qui provoque des tensions avec mon interlocuteur, que ce soit une personne ou un groupe.
Le problème avec l’écoute de mon émotion, par contre, c’est que mon émotion n’a pas toujours raison ! Souvent il lui manque des informations essentielles qui changeraient sa perspective
Le problème avec l’écoute de mon émotion, par contre, c’est que mon émotion n’a pas toujours raison ! Souvent il lui manque des informations essentielles qui changeraient sa perspective sur la situation et/ou sur mon interlocuteur. Et même quand mon émotion a raison dans son analyse de la situation, les solutions qu’elle me propose (« Venge-toi ! » par exemple) ne sont pas toujours faisables d’un point de vue humain, ou préférables d’un point de vue biblique.
Néanmoins, le simple fait d’interroger mon émotion ainsi dans une situation de chaleur relationnelle m’aide à me ralentir afin que je ne réagisse pas de manière irréfléchie, dominé par un fonctionnement malsain en mode « pilote automatique ».
L’écoute du Seigneur
Avec un peu de recul grâce au dialogue avec mon émotion, je suis mieux situé pour tourner les yeux vers le Seigneur (comme j’aurais dû faire depuis le début !). Mon écoute du Seigneur peut commencer avec une prière simple : Seigneur, aide-moi à voir cette situation et cette personne avec tes yeux. Donne-moi ta sagesse pour pas que je me laisse dominer par ma propre « sagesse » (qui a tendance à faire des dégâts dans mes relations les plus précieuses). Remplis-moi de ton Esprit et de ton amour pour mon interlocuteur. Amen.
Comme je fais avec mon émotion, je peux poser des questions au Seigneur : Que dit ta parole au sujet de cette situation ? Quel passage biblique puis-je méditer en ce moment pour me calmer et pour me mettre à ton écoute ? Que ferait ton Fils Jésus à ma place ? Quelle réponse te rendra gloire et transmettra une grâce à mon interlocuteur et peut-être aussi à d’autres spectateurs de cet échange ?
Parfois l’écoute du Seigneur inclura l’écoute d’un autre membre de son Corps : un frère ou une sœur qu’on invite à nous accompagner dans notre réflexion et à nous soutenir dans la prière ; une prédication ou enseignement biblique ; un article, un livre, un podcast.
Mais un élément clé de cette deuxième écoute sera la remise en question de la première : est-ce que le message que transmet mon émotion est vrai ? Est-ce qu’il est entièrement vrai ou juste partiellement vrai ? Alors que j’ai peur, est-ce que je suis vraiment en danger selon les Écritures ? Si je suis en colère, est-ce que le désaccord est une question de justice (une colère justifiée face à une injustice), ou plutôt de préférence personnelle (une colère associée à mon opinion, mon égoïsme, mon orgueil) ?
L’écoute de l’autre
Après avoir écouté mon émotion, et puis évalué mon émotion et les messages qu’elle me communique à la lumière de la Parole de Dieu et avec l’aide de son Esprit (et peut-être un membre de son Église), je trouve que je suis toujours mieux équipé pour me mettre à l’écoute de l’autre sans tomber dans les pièges de l’accusation, de l’autojustification, ou du règlement de comptes. Je reconnais plus facilement le fait qu’il me manque des informations essentielles pour mieux comprendre sa situation, sa perspective, ses intentions, son message. Je pose des questions et je demande des clarifications avec un amour qui ne commence pas par « soupçonner le mal », mais qui ouvre grande ouverte la porte à la possibilité que la tension est une conséquence de l’incompréhension et même de l’ignorance.
J’ai besoin du hibou
La grâce de Dieu qui se révèle en Jésus-Christ et qui est rendue explicite et accessible pour nous dans les Écritures est d’accord avec mon fils Wesley : j’ai besoin du hibou sage pour savoir quoi dire dans les situations de friction familiale. Parfois, la manifestation agressive de mon émotion me coupe l’accès à une sagesse qui vient d’en haut, la sagesse que donne le Père des lumières à ceux qui la lui demandent (Jc 1.5), la sagesse qui est porteuse de paix (Jc 3.17), et qui accomplit la justice de Dieu (Jc 1.20). Que la grâce de Dieu nous apprenne, alors, à être prompts à écouter, lents à parler, lents à nous mettre en colère. Qu’il nous délivre dans nos rapports familiaux d’un fonctionnement en mode « pilote automatique » afin que la doctrine de Dieu notre Sauveur soit pleinement honorée (Tite 2.10) et rendue attrayante aux yeux de nos enfants et aux yeux de tous ceux qui observent l’œuvre de sa grâce au sein de nos maisons.