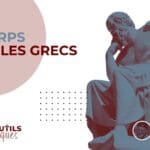Mais qui est donc cet écrivain ?
Erri de Luca est, selon moi, le plus grand écrivain italien contemporain. Je m’attends à ce qu’il reçoive le Prix Nobel de Littérature dans les années qui viennent, compte-tenu de la valeur littéraire de son œuvre, mais pas seulement : celle-ci se caractérise aussi par sa profonde humanité. Il faut dire que l’homme a un parcours singulier.
Il est né à Naples, en 1950. Jusqu’en 1995, sa vie est celle d’un ouvrier : un manœuvre, qui travaille dur. D’autre part, il milite dans le mouvement activiste d’extrême-gauche, « Lotta Continua ». Il ne vient que peu à peu à l’écriture. Son œuvre est rapidement primée. Il reçoit en 2002, par exemple, le Prix Femina étranger, en France, pour son roman Montedidio, ou bien le Prix européen de littérature, en 2013. Sa vie devient celle d’un écrivain, mais il demeure très engagé dans la politique de son pays, et il lui est même arrivé de se faire emprisonner. Ceci dit immédiatement que l’on a affaire, avec Erri de Luca, à un homme, qui a cherché à se réaliser, pleinement, dans son humanité, par le travail, manuel, physique, les rencontres, ou les combats, menés au nom de ses idées.
Il écrit surtout des romans, plutôt courts, poétiques, profonds. Il publie régulièrement et l’oeuvre devient conséquente : une bonne vingtaine d’ouvrages. A côté des romans, Erri de Luca est aussi un très grand lecteur de Bible. Pour la lire dans le texte, il a appris l’hébreu ! D’où plusieurs ouvrages de commentaires personnels. Il se laisse interpeller par les Ecritures et propose de véritables méditations, bien que n’étant pas croyant, ce qu’il dit clairement. Non croyant, il est toutefois incroyablement perméable aux Ecritures : style et message. On voit donc se dessiner les contours d’une œuvre très singulière, poétique, et philosophique. Il n’est pas difficile à lire, car on aura bien compris qu’un homme comme lui ne saurait écrire pour une élite, mais il émane de ses textes une vraie profondeur, qui me rappelle, personnellement, ce que Camus a apporté, en son temps. Ils sont « frères », dans le sens qu’ils ont, chacun, de la beauté du monde, et de la valeur de l’homme.
Le choix d’un ouvrage
 Acide, Arc-en-ciel, est le troisième livre publié par cet auteur, en 1992. Le titre est beau, mais étrange, n’est-ce pas ? L’explication est donnée dans le roman même, un passage où le narrateur parle de son père : « Aceto, arcobaleno : c’est par ces mots que commençait l’ordre alphabétique de son petit dictionnaire d’anglais et de français qu’il tentait de nous enseigner, à ma sœur et à moi. » La traductrice ajoute la note suivante : « Titre original du livre : vinaigre, arc-en-ciel. » Ce titre repose sur une opposition entre, d’une part, la valeur négative de l’acidité, sensation gustative désagréable, et, d’autre part, la beauté et la symbolique positive de l’arc-en-ciel, symbole, dans la Bible, de la réconciliation entre Dieu et l’humanité, après le déluge. La tonalité générale du roman est, d’emblée, bien annoncée par ce titre, mystérieux. Erri de Luca va parler de l’homme, en bien, et en mal, parce qu’une vie d’homme est toujours une manière de se frayer un chemin, singulier, entre le Bien, et le Mal.
Acide, Arc-en-ciel, est le troisième livre publié par cet auteur, en 1992. Le titre est beau, mais étrange, n’est-ce pas ? L’explication est donnée dans le roman même, un passage où le narrateur parle de son père : « Aceto, arcobaleno : c’est par ces mots que commençait l’ordre alphabétique de son petit dictionnaire d’anglais et de français qu’il tentait de nous enseigner, à ma sœur et à moi. » La traductrice ajoute la note suivante : « Titre original du livre : vinaigre, arc-en-ciel. » Ce titre repose sur une opposition entre, d’une part, la valeur négative de l’acidité, sensation gustative désagréable, et, d’autre part, la beauté et la symbolique positive de l’arc-en-ciel, symbole, dans la Bible, de la réconciliation entre Dieu et l’humanité, après le déluge. La tonalité générale du roman est, d’emblée, bien annoncée par ce titre, mystérieux. Erri de Luca va parler de l’homme, en bien, et en mal, parce qu’une vie d’homme est toujours une manière de se frayer un chemin, singulier, entre le Bien, et le Mal.
Une œuvre littéraire est, avant tout, une certaine forme. Celle de ce petit livre ( 150 pages ) n’est pas commune. Le continu de la narration est assuré par un narrateur, qui dit « je », et n’est pas l’auteur, même s’il lui ressemble beaucoup. Celui-ci est un homme qui vit seul, dans une maison de pierres, isolée. Il n’est plus en très bonne santé. Il reçoit successivement la visite de trois bons amis : un ancien ouvrier militant ; un prêtre missionnaire, et celui qui se nomme lui-même « courtisan », une espèce de dilettante. La parole de chaque visiteur se mêle à celle du narrateur. On a donc trois parties, séparées par une page de blanc.
-L’ouvrage propose une réflexion sur la vie, la destinée humaine, la réalisation de soi, sous trois formes, donc : l’engagement politique, religieux ou le laisser-aller, au gré des circonstances. Trois regards sur la vie, donc. Trois façons de parvenir à l’être-homme.
Se réaliser par l’action politique
Nous ne connaissons pas le nom des amis : pour la narrateur qui les reçoit, successivement, point n’est besoin de les nommer. Ils sont ses amis. Il connaît leur vie. Il nous offre d’ailleurs, immédiatement, une traversée de celle de l’ouvrier : « Tu as été ouvrier en usine, manœuvre dans le bâtiment, porteur. Tu as loué ton corps à l’heure. Au temps de tes premières visites tu me rendais compte de ces heures de travail commencées avant l’aube dans le tapage des usines qui travaillent en continu. » Force est de constater que l’on est très proche de la trame de vie de l’auteur lui-même, ce que vient encore confirmer le militantisme politique : « Tu parlais de rues remplies d’une foule mécontente. Tu en faisais partie, tu l’appelais politique, mais ce mot me gênait. (…) C’était bien autre chose l’action convulsive dont tu me parlais et qui contenait, à t’entendre, une part d’un monde futur. » D’emblée, la validité de ce choix est relativisée. Il faut dire que l’ouvrier a été mené jusqu’à tuer : « Je ne suis qu’un corps qui en a tué d’autres… » avoue-t-il. « Quand je vis dans les rues les coups, les affrontements, j’étais déjà prêt. Dans la première pierre que je lançai était déjà inscrit l’acte de tuer et d’être tué. La politique fut pour moi l’organisation d’une colère. »
Or, on l’aura compris, Erri de Luca place très haut la vie humaine, et il souligne la confrontation du personnage à sa conscience, en lui faisant exprimer ceci : « Je ressens profondément le nom d’assassin, mais pas parce qu’au cours de ma vie il y eut des minutes qui m’ont défini tel. Je suis assassin parce que sous la vie, sous l’écorce d’un être humain, il y a un œil secret. Moi, j’ai été vu par cet œil et mis à nu. » On relèvera l’emploi de la généralisation, dans ce passage, où il est bien question de l’ « être humain ». Comment ne pas songer au premier meurtre raconté par la Bible : celui de Abel par Caïn qui, maudit, doit fuir sur la face de la terre, fuir cet œil de la conscience, qui, dans « La Conscience », le fameux poème de Victor Hugo, le poursuit jusque dans la tombe : « L’oeil était dans la tombe et regardait Caïn. » La perspective adoptée par Erri de Luca, pour parler de la condition humaine, est grave, métaphysique.
Le Christ apparaît, d’ailleurs, dans cette première partie, lorsque l’ouvrier raconte sa confrontation, marquante, au tableau Les Noces de Cana, peint par Véronèse. Il évoque le Christ de manière puissante : « L’homme au centre (…) déploie pour la première fois l’énergie bouleversante qui préside aux miracles. Il le fait pour mener la fête à son terme. Son regard est déjà absorbé par un autre dîner au cours duquel il prononcera un adieu. C’est un homme à ses dernières Pâques. Pour ce moment de concentration de l’énergie, le peintre fait sentir le silence qui se fige comme le sang répandu dans le monde. » Erri de Luca, dans un raccourci saisissant, relie l’ouvrier, et le Christ, par le sang : le sang de l’homme, répandu par l’homme, et le sang du Christ, versé par les hommes, et pour le salut des hommes – ce que l’auteur n’exprime pas.
Il n’est pas question de « conversion », dans ce premier épisode, à la fin duquel l’ouvrier avoue : « Je ne sens pas la foi en moi, mais j’ai admiré les vies des hommes qui ont tenu les promesses faites dans leur jeunesse. » Et la partie s’achève sur encore un autre portrait d’homme : « A cette époque je parlais avec un jésuite qui montait dire la messe le dimanche (…) Nous faisions de longues promenades (…) Je l’écoutais parler (…) dans sa voix douce passait une certitude invulnérable (…) Personne d »autre ne m’a parlé de ces choses-là. Aujourd’hui je pense que ce temps fut celui d’un amour offert ; et je pense l’avoir reçu. » L’ouvrier n’a donc pas reçu l’amour de Christ, mais celui du prêtre, attentif à lui, oui : « Je l’écoutais parler, il se reposait de temps en temps dans un sourire, les yeux fermés. Je lui racontais mes histoires d’ouvrier. »
La puissance de Erri de Luca réside dans cette capacité à approcher la réalité humaine avec une sensibilité, et aussi, une justesse, très particulières. Il ne fait pas œuvre de foi, mais plus que d’autres écrivains, il parvient à révéler le cœur de l’homme. On voit ici combien l’homme peut être assoiffé de justice et de vérité, combien il est capable de s’élancer, de toute sa force vitale, dans le combat de la vie, et combien il peut, au final, être déçu, meurtri, et encore assoiffé de reconnaissance et d’amour.
C’est un homme épuisé par sa vie que nous a montré là Erri de Luca, et je donne encore les presque derniers mots de la partie, ceux du narrateur, inquiet pour son ami : « Comment feras-tu pour vivre maintenant que tu es fatigué, comment feras-tu pour mourir ? C’est une question que je te posai avec insistance pour te retenir une dernière fois. » Au fond, n’avons-nous pas là les deux questions fondamentales auxquelles se confronte le romancier : comment faire pour vivre ? Et, comment faire pour mourir ?
La vocation religieuse
Dès le début de la séquence narrative suivante, on voit le narrateur se retourner sur un autre ami du passé : « Je suis sur un banc d’école. Tu viens regarder derrière mon dos et tu me montres du doigt une erreur. Alors je me retourne et je te vois, mais tu n’es plus un enfant, tu es un homme âgé, rentré d’Afrique, tel que tu étais à l’arrêt du car où nous nous sommes quittés la dernière fois. Entre ces deux points il y eut notre amitié… » Passé et présent se mêlent, et l’on perçoit toujours ce lien fort d’humanité, chez Erri de Luca, entre les êtres. Il nous offre une autre traversée d’une vie, ayant, cette fois, une orientation spirituelle.
L’appel du prêtre est mis en rapport avec celui de Nathanaël par Jésus : « Avant que Philippe ne t’appelât, je t’ai vu quand tu étais sous le figuier. (…) Comme si j’étais moi-même Nathanaël, je me sentis regardé de très loin. (…) moi je crois non parce que je vois, mais parce que j’ai été vu. Un œil se trouve derrière d’antiques paroles et attend celui qui soulèvera sa paupière. » Frappante, n’est-ce pas, cette récurrence du motif de l’oeil ? Un œil divin, qui voit, travaille la conscience, ou appelle. Mais qui, toujours, somme l’homme d’être là !
L’ami du narrateur a répondu à cet appel : « Là-bas je devins Père Natana, qui dans la langue swahili veut dire rester en adhésion, demeurer fidèle. » Il est habité par un authentique souci d’évangélisation, de chacun : « Tu m’avais apporté une Bible en cadeau. » Le narrateur ne partage pas sa foi : « Je n’ai jamais été croyant… » ; toutefois, il aime la relation de son ami prêtre avec Dieu, et admire son chemin de dénuement : « Ma vocation à servir m’entraînait bien au-delà des désirs, des intérêts personnels. Se dépouiller de soi, telle a été ma conception de la liberté. »
Erri de Luca a créé un personnage admirable : « Dans notre espace réduit, un grabat, un seau pour se laver, on arrive à mépriser le confort. Dispersés à la périphérie du monde, on se sent au centre de sa propre vie. Puis, un jour de grande fatigue et de faible résultat, on ôte ses vêtements imprégnés de notre sel, de l’odeur que seule une épouse pardonne et au lieu de baisser les yeux, un frisson de fierté parcourt notre échine. Notre épine dorsale se redresse, notre cage thoracique se dilate, on respire à fond, on est devenu homme de Dieu. » On a donc vraiment, jusque là, le sentiment d’une vie accomplie, pleinement. Et pourtant …
Le personnage de l’ami prêtre, à la fin de sa vie, est pris de doute, quant à la pérennité de son travail, parce que les autochtones ont du mal à poursuivre, de manière autonome, l’oeuvre amorcée. Alors, il se raccroche à une certitude : « La charité, c’est de ça que je parle, ne se mesure pas à un résultat, car elle ne trouve son exaucement dans aucune fin. A quoi sert-elle ? A rien, mais c’est bien là pour moi sa valeur. Quand on s’interroge sur sa propre existence, qu’on se perd dans le vertige d’un gaspillage insensé, quand même ce qui fut considéré comme bon apparaît vain, alors la charité offerte devient l’unique geste de sympathie entre un homme et le reste de son univers. Elle ne sert à rien, sur elle on ne peut fonder une ville, pas même une église, mais un homme oui. » Magnifique passage, qui fait tellement écho au chapitre 13 de la première épître de Paul aux Corinthiens : une exhortation à l’amour-charité, qui s’achève ainsi : « Maintenant donc ces trois choses demeurent : la foi, l’espérance, l’amour ; mais la plus grande, c’est l’amour. »
Erri de Luca, au travers de l’esquisse de cette humble vie offerte, suggère que l’amour donné justifie amplement une vie. Oui, le salut est acquis par la grâce de Dieu seule, manifestée en Jésus-Christ, mort pour les hommes pécheurs, mais la chose la plus grande, celle qui demeure pour l’éternité, c’est bien l’amour.
Le « courtisan »
La troisième partie, la plus courte, est enfin consacrée au dernier ami, désigné dans le texte même comme le « courtisan ». Il n’est pas le plus intéressant. Erri de Luca propose le portrait d’un être séduisant, voire séducteur, qui sait plaire à tous : « tu attirais la curiosité, l’affection et l’amitié. » Le narrateur va même plus loin : « tu étais le préféré ». Il existe effectivement de ces êtres à qui tout semble avoir été donné… En sont-ils plus heureux pour autant ?
Ce type de personnes a tendance à se disperser, surtout dans les amours. Alors qu’il est avec une jeune fille courtisée, il lui dit : « On se sent au centre de l’univers. » Oui, mais il peut devenir dangereux de se percevoir comme le centre du monde. On est auto-centré, et pourtant dispersé. Ce fut le cas de cet ami, car très vite : « après le lycée, commença ta vie de pèlerin dans les chambres d’amis et de connaissances, chaque fois que l’occasion se présentait. » Le dilettante est aussi un opportuniste. Au lieu de conduire sa vie, en fonction d’un projet, réfléchi, il se laisse aller, au gré des circonstances.
La voie prise par cet homme est pervertie. Voici l’idéal qu’il exprime : Être pour l’autre une chose entièrement sienne, ornement de son intimité, privé de la liberté d’être différent. Devenir une chose à posséder… » Un être humain ne peut pas s’engager sur la voie d’un devenir-chose. Il ne peut aliéner sa liberté au profit du plaisir d’autrui. Cette voie est destructrice. Preuve en est que cet ami tourne mal : « Tu avais fait de la prison. Il s’agissait d’une erreur car, par la suite, tu fus acquitté. » Sa vie n’est plus une vie « normale » : elle est dévoyée. Mais aussi parce que cet individu ne s’était engagé dans aucune voie, consciente.
A la fin de la partie, Erri de Luca met en parallèle ce parcours de vie, raté, avec celui de voyageurs sur les mers : « Durant un siècle entier les hommes s’usèrent à explorer les océans de l’autre hémisphère. Ils scrutèrent chaque jour le profil de l’horizon, ridé seulement par les vagues. (…) Le monde vers lequel ils avaient appareillé n’était pas là, leur direction était fausse dès le départ. L’erreur tient souvent au premier pas … »
Retenons cette dernière phrase : « L’erreur tient souvent au premier pas … »
Conclusion
Au fond, ce que nous dit Erri de Luca, assez clairement, c’est qu’on « n’est pas » un homme digne de ce nom : on le devient.
On « n’est pas » un homme digne de ce nom : on le devient.
Comment ? Erri de Luca a fortement le sens de la valeur de l’engagement : qu’il soit politique, ou religieux. Il nous propose des modèles de vie, à imiter, ou pas. Ce type de littérature existait déjà, dans l’Antiquité, avec les « vies des hommes illustres ». Leur projet était moral : aider l’homme à bien conduire sa vie. Erri de Luca est un écrivain moderne, à succès, mais il a conservé quelque chose, en lui, d’un moraliste.
La notion de nécessité de choisir sa voie me semble pleinement en accord avec la Bible. Le Christ a rencontré beaucoup d’hommes sur les chemins. Très souvent, il les a confrontés à un choix, par la question : veux-tu me suivre ? Le jeune homme riche, par exemple, a rejeté son appel : « Viens et suis-moi. Mais lui s’assombrit à ces paroles et s’en alla tout triste, car il avait de grands biens. » (Marc 10 : 21-22) Pourtant, l’évangéliste nous rapporte que « Jésus, l’ayant regardé, l’aima. » (verset 20)
Cette proposition du Christ continue à résonner, aujourd’hui, pour chaque homme : « Viens et suis-moi. » A chacun d’engager sa responsabilité et de s’engager pour lui. De la réponse à cette proposition dépend la possibilité de vivre, et aussi, de mourir, en paix.