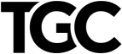Lire Camus
Camus est « un grand », non pas uniquement parce qu’on lui a décerné le Prix Nobel de littérature, en 1957, mais surtout, pour moi, pour les qualités humaines dont il a fait preuve, durant sa vie, comme dans son œuvre. Son sens de l’éthique, si puissant, s’est affirmé, d’une œuvre à l’autre. Il a constamment réagi contre l’oubli de l’Homme. Ainsi, se mettre à l’écoute de Camus n’est jamais vain, même si l’on n’est pas toujours d’accord avec lui.
Je commencerai par détruire quelques clichés. Lorsqu’on prononce le nom de Camus, aussitôt vient en tête le titre d’une de ses œuvres : le roman L’Etranger, sans doute parce qu’il est souvent étudié en lycée. On relie Camus à « l’Absurde », ce courant philosophique de l’après-guerre, dont il est le meilleur représentant. Meursault, le héros de L’Etranger, prend conscience de l’absurdité du monde, liée à la condition mortelle de l’être humain. On a tendance à privilégier le Camus, côté ombre, alors qu’il en est un autre, côté soleil – celui du sud, de la Méditerranée, l’Algérie, plus précisément, où il est né – qui vaut aussi la peine d’être découvert. Où ? Dans une série d’essais, parus sous le titre Noces. Camus a publié pour la première fois cet ouvrage alors qu’il avait environ vingt-cinq ans. Il s’agit d’une œuvre de jeunesse, mais elle contient déjà, en germe, les thèmes principaux de l’œuvre à venir.
J’ai choisi de partir de cet ouvrage-là pour aborder Camus. Plutôt que d’aligner des généralités, je voudrais proposer ma lecture d’un texte, extrait de Noces. Disons, d’emblée, que ce titre, magnifique, évoque l’union de l’Homme avec le monde, avec la vie. Bon titre, qui annonce parfaitement le contenu philosophique de l’ouvrage. Des quatre essais qui se succèdent, c’est le dernier qui fera l’objet de cette étude : « Le désert ». Mon projet ne consistera pas à lire ce texte en spécialiste de Camus. Mais je ne voudrais pas, non plus, déformer la pensée de Camus, en essayant de le ramener vers la foi chrétienne, ce qui est une tentation. En restant fidèle à Camus, je vais le lire, en chrétien. Est-ce déplacé ? Chaque auteur récompensé par le Nobel prononce un discours. À la fin du sien, Camus se réfère « à ce que je suis réellement, à mes limites, à mes dettes, comme à ma foi difficile ». Ces mots me touchent car on y perçoit bien l’honnêteté foncière de cet homme, sa modestie, et si je le lis bien, un aveu : celui de sa « foi difficile ». Vous voyez, sans doute aviez-vous conservé de lui ce cliché : Camus, celui qui pense que la religion est une béquille pour les faibles. Rien ne vaut une découverte personnelle, qui permet, la plupart du temps, de découvrir une autre vérité, sous les apparences, bien plus intéressante que ce que l’on aurait pu penser.
Je vous invite donc à me suivre dans la lecture de l’essai : « Le désert ». Ce sont des textes complexes, où Camus oscille, entre narration de souvenirs personnels, et réflexion philosophique. La langue de Camus est un pur enchantement. En voici une preuve. Le passage se situe à la fin de l’essai :
« À Florence, je montais tout en haut du jardin Boboli, jusqu’à une terrasse d’où l’on découvrait le Monte Oliveto et les hauteurs de la ville jusqu’à l’horizon. Sur chacune de ces collines, les oliviers étaient pâles comme de petites fumées et dans le brouillard léger qu’ils faisaient se détachaient les jets plus durs des cyprès, les plus proches verts et ceux du lointain noirs. Dans le ciel dont on voyait le bleu profond, de gros nuages mettaient des taches. Avec la fin de l’après-midi, tombait une lumière argentée où tout devenait silence… »
Comment le spirituel vient-il à l’œuvre de Camus ?
Je dirais, d’abord, par un certain mode de perception du réel. Camus nous livre un témoignage singulier, et profondément sincère – conformément à sa nature – de la manière dont il a été au monde, lui. À partir de là, il élargit le champ, et transmet des convictions sur la bonne manière de vivre, pour tous les Hommes.
J’aborderai l’essai en suivant le cours de la pensée de Camus, au fil de ses promenades méditatives, en Italie.
Ce que la peinture dit à Camus
Dès le premier paragraphe de l’essai, Camus se réfère à l’art des « grands maîtres toscans », qui consiste, d’après lui, à « témoigner trois fois, dans le silence, la flamme et l’immobilité. » Il citera le nom de trois peintres italiens majeurs : Cimabué, Giotto, et Piero della Francesca. Camus a l’art des formules, et il vaut la peine de s’arrêter sur les termes par lesquels il définit leur art. Tout d’abord, celui-ci est un témoignage. L’art authentique, pour Camus, témoigne du passage sur la terre d’un être vivant. « Le silence » sous-entend une position de retrait du monde ; une attitude concentrée, de réceptivité. « L’immobilité » complète, le silence, et l’on est bien forcé d’admettre que tant les dispositions intérieures que la position évoquée sont liées à la méditation, la prière. Camus relie, implicitement, peinture et spiritualité, même si, dans sa manière d’évoquer les œuvres elles-mêmes de ces peintres, il ne prend pas, d’abord, en compte, leur dimension religieuse. Et qu’en est-il de « la flamme » ? Elle évoque, chez moi, une chandelle, plus qu’un grand feu, à la lumière de laquelle on lit les saintes Écritures. On pourrait donc parler d’un devenir-flamme, pour Camus, de celui qui peint, méditativement.
Regardant ces tableaux, Camus est particulièrement attentif aux visages, ce qui nous vaut une belle réflexion concernant le regard que nous portons sur autrui : « Il faut beaucoup de temps pour reconnaître que les personnages de leurs tableaux, on les rencontre tous les jours dans les rues de Florence ou de Pise. Mais, aussi bien, nous ne savons plus voir les vrais visages de ceux qui nous entourent. Nous ne regardons plus nos contemporains, avides seulement de ce qui, en eux, sert notre orientation et règle notre conduite. » Camus bascule dans la critique sociale et dénonce le regard intéressé que nous portons sur autrui, qui nous empêche d’en voir la beauté, la vérité. Quelqu’un qui développe les qualités des peintres évoquées plus haut, est nécessairement quelqu’un de capable de prendre en compte l’humanité véritable de son prochain. Cela, ce n’est pas moi qui le dit, en chrétien, mais bien Camus : très grand humaniste, dans un sens tout à fait positif.
C’est que Camus est toujours, toujours, en quête de vérité. « Ce qui compte, c’est la vérité », déclare-t-il, juste après. « À cet égard, seuls les peintres peuvent apaiser notre faim ». Pourquoi ? Camus avance deux arguments. Tout d’abord, « c’est qu’ils travaillent dans cette matière magnifique et futile qui s’appelle le présent. » Ensuite : « Et le présent se figure toujours dans un geste. » Il y a là une singularité du regard de Camus. Au lieu de voir, dans les tableaux de ces maîtres toscans, une manière d’éterniser l’humain, il choisit d’y retrouver la présence de l’être, saisi au présent de sa vie, dans un geste. Camus, on le constate, réduit l’Homme au corps, à l’expressivité du corps, et la vie de l’Homme à l’instant présent. « Car le corps ignore l’espoir » : voici dévoilée la clef de voûte de l’édifice de pensée. Camus refuse l’espoir, plus précisément, la projection de l’Homme dans une vie éternelle dont il n’admet pas l’existence. Mais il est parfaitement lucide : « Cette grandeur de l’homme sans espoir, cet éternel présent, c’est cela précisément que des théologiens avisés ont appelé l’enfer. Et l’enfer, comme personne ne l’ignore, c’est aussi la chair qui souffre. C’est à cette chair que les Toscans s’arrêtent et non pas à son destin. (…) Et ce n’est pas dans les musées qu’il faut chercher des raisons d’espérer. »
Pour Camus, « l’immortalité de l’âme, il est vrai, préoccupe beaucoup de bons esprits. Mais c’est qu’ils refusent, avant d’en avoir épuisé la sève, la seule vérité qui leur soit donnée et qui est le corps. » Camus reproche, aux « bons esprits » religieux, de préférer l’âme, en rejetant la jouissance d’ordre corporel. Attention toutefois ! Chez Camus, « épuiser la sève de la vie » ne consiste pas à sombrer dans la débauche. Il a en tête une jouissance de ce qui est donné dans le monde : la beauté de la nature, des corps, de la vie ; l’amour. Camus ne se pose pas en « jouisseur », mais en « vivant », par le corps. Le corps est bon. Le monde est beau. Jouissons-en, maintenant. Voici son credo. Cette leçon, il la trouve dans les œuvres des peintres italiens, qui « ont élevé parmi les paysages toscans (…) la protestation lucide de l’homme jeté sur une terre dont la splendeur et la lumière lui parlent sans relâche d’un Dieu qui n’existe pas. »
Camus face au paysage
L’essai s’intitule : « Le désert ». Pourtant, dans cet essai-là, Camus est en Italie, en Toscane, plus précisément. Il évoque « la grandeur minérale d’un paysage », auquel il trouve « une résonance commune à la terre et à l’homme, par quoi l’homme comme la terre, se définit à mi-chemin entre la misère et l’amour. » Camus a une perception spirituelle de la réalité. La terre italienne, et l’homme, ont en commun d’être tiraillés entre deux polarités : d’une part, « la misère », et plus qu’à la misère matérielle, on songe, ici, à cette « misère de l’homme sans Dieu », dont parle Pascal, le philosophe chrétien du dix-septième siècle. Et d’autre part, « l’amour ». Amour humain, mais également, l’amour de la beauté éclatante de la terre. Ce paysage porte en lui une tension, qui le rend tragique. Oui, la terre italienne « est d’abord prodigue de sa poésie pour mieux cacher sa vérité ». Laquelle ? « Double vérité du corps et de l’instant, au spectacle de la beauté. » Vous le voyez, le texte est redondant. Camus en revient à ce qu’il disait à partir de la peinture italienne. « Des paysages si purs sont desséchants pour l’âme et leur beauté insupportable. Dans ces évangiles de pierre, de ciel et d’eau, il est dit que rien ne ressuscite. »
Camus face à la mort
La mort apparaît effectivement comme la grande hantise de Camus. Elle est présente chez lui, comme chez Pascal, mais, chez l’un et chez l’autre, on ne se prépare pas de la même manière à mourir …
Camus raconte comment il va, de lieu en lieu : « Je me souviens qu’à Florence, dans le cloître des morts, à la Santissima Annunziata, je fus transporté par quelque chose que j’ai pu prendre pour de la détresse et qui n’était que de la colère. Il pleuvait. Je lisais des inscriptions sur les dalles funéraires et sur les ex-voto. » Mais qu’est-ce qui met ainsi Camus en colère ? Sur ces inscriptions funéraires, il ne lit, lui, que des renoncements à vivre. « Tout en moi protestait contre une semblable résignation. « Il faut », disaient les inscriptions. Mais non, et ma révolte avait raison. » Le terme de « révolte » est essentiel : il deviendra un thème-clef de l’œuvre à venir. On parle souvent de Camus comme d’un philosophe de la révolte.
Quelle révolte ? Je me répète : Camus se révolte contre le renoncement à la jouissance de l’ici-bas, au nom de l’espoir en un au-delà, qu’il nie. Pour lui, il faut admettre qu’on meurt, et saisir pleinement la vie, tant qu’il en est temps, et comme il le fait : « Au coin de chaque église, ce dimanche-là, se dressaient des étalages de fleurs, grasses et brillantes, perlées d’eau (…). Dans ces fleurs comme dans ces femmes, il y avait une opulence généreuse et je ne voyais pas que désirer les unes différât beaucoup de convoiter les autres. Le même cœur pur y suffisait. » Camus parle de jouir, certes, mais avec un cœur pur.
Camus et la vie monastique
« J’avais passé ma matinée dans un couvent de franciscains, à Fiesole, plein de l’odeur des lauriers. J’étais resté de longs moments dans une petite cour gonflée de fleurs rouges, de soleil, d’abeilles jaunes et noires. Dans un coin, il y avait un arrosoir vert. Avant de venir, j’avais visité les cellules des moines, et vu les petites tables garnies d’une tête de mort. Maintenant, ce jardin témoignait de leurs inspirations. (…) Dans la vie de ces franciscains, enfermés entre des colonnes et des fleurs et celle des jeunes gens de la plage de Padovani à Alger qui passent toute l’année au soleil, je sentais une résonance commune. S’ils se dépouillent, c’est pour une plus grande vie (et non pour une autre vie ) ».
Camus établit une relation entre ce à quoi aspirent les moines franciscains et les jeunes algérois : avoir une vie plus grande. Oui, la foi chrétienne agrandit la vie, en la portant à une autre dimension, mais celle-ci est celle de l’éternité. Des moines franciscains ne peuvent avoir rejeté l’espérance d’une autre vie.
Conclusion
Le texte de Camus est magnifique, plein de poésie, et de profondeur. Si l’on peut partager bien des aspects de sa pensée, toutefois, en tant que chrétien, on se heurte clairement à deux obstacles.
Premièrement, le refus, martelé par Camus, de l’espérance d’une autre vie. Là, Camus est très clair : Le monde est beau, et hors de lui, point de salut. » À quoi l’on peut répliquer : oui, le monde créé par Dieu est effectivement très beau, mais il existe, pour l’Homme, selon la Bible, une possibilité de salut hors du monde. Parce que le Christ est venu pour réconcilier avec Dieu, par sa mort sur la croix, tout Homme que son péché sépare de Dieu. On peut refuser ce salut, comme Camus, il n’en reste pas moins offert gratuitement.
Deuxièmement, on peut reprocher à Camus de déformer la vérité du christianisme en un point : cette idée qu’être chrétien empêche de profiter de ce que Gide, autre grand écrivain du début du XXe siècle, appelait « les nourritures terrestres ». C’est faux. Dieu a offert la Création à l’Homme, pour qu’il en jouisse, tout en respectant ses commandements, qui sont saints, justes, et bons.
Camus se réfère, dans l’essai, aux moines franciscains. François d’Assise, fin douzième-début du treizième siècle, a ouvert la voie d’une relation à Dieu faite de dépouillement intérieur, mais aussi d’ouverture au monde. Son fameux « Cantique des créatures » est une extraordinaire louange adressée au Créateur, au travers de sa création : le soleil ; la lune ; les étoiles ; l’eau. Le dernier couplet évoque « notre sœur la mort corporelle », dans la perspective paisible de celui qui, réconcilié avec son Dieu, sait qu’il va vers « une autre vie ».