Paul WELLS, De la croix à l’Evangile de la croix, La dynamique biblique de la réconciliation (collection Théologie), tr. de l’anglais (Cross Words, 2006) par Laurence BENOIT, Charols, Excelsis, 2007, 294 p., 18€
Si le titre français de l’ouvrage de Paul Wells, De la croix à l’Evangile de la croix, n’est pas la traduction littérale du titre original (Cross Words), il résume magnifiquement bien à notre avis le message qui retentit tout au long des pages de ce livre : la croix est le centre de l’Evangile, le cœur de la foi chrétienne. Wells s’est efforcé de montrer, pas à pas, qu’un « évangile » qui mettrait la croix – avec son sens profond, ses raisons et ses conséquences – au second plan n’est pas Evangile du tout (p. 270). Il est en effet crucial que l’événement historique qui s’est produit il y a plus de 2000 ans (le Christ crucifié) reste, comme il l’a toujours été, le point central de la doctrine chrétienne, le « roc sur lequel l’Eglise est construite » (p. 8).
 Ces considérations au sujet de la croix ne font pourtant pas l’unanimité dans le rang des théologiens depuis plus d’un siècle. Et la plupart du temps, lorsque la croix est étudiée, c’est pour en démanteler le modèle d’interprétation classique – la « substitution pénale » – au profit d’autres, plus acceptables par l’homme moderne. C’est dire la pertinence de l’ouvrage de Wells pour le christianisme évangélique actuel, qui risque d’être sournoisement infiltré par ces interprétations récentes. La croix était un scandale pour le monde antique (Juifs et Grecs; cf. 1 Co 1) et l’est tout autant pour notre société postmoderne : l’idée que le Christ meure pour les péchés des hommes paraît inconcevable pour nos contemporains. Ce qui est principalement critiqué, c’est la logique de l’échange (Jésus a payé nos dettes, il est mort à notre place, il s’est livré pour satisfaire la justice divine, il a pris sur lui la punition que méritait le péché) ; les théologies modernes optent plutôt pour la logique de la gratuité (p. 30). Dieu, dit-on, aime inconditionnellement et n’a pas besoin d’un quelconque sacrifice pour pardonner le péché. Autrement dit, Dieu n’est qu’amour (et donc pas justice) ; les péchés des hommes n’exigent aucun châtiment divin.
Ces considérations au sujet de la croix ne font pourtant pas l’unanimité dans le rang des théologiens depuis plus d’un siècle. Et la plupart du temps, lorsque la croix est étudiée, c’est pour en démanteler le modèle d’interprétation classique – la « substitution pénale » – au profit d’autres, plus acceptables par l’homme moderne. C’est dire la pertinence de l’ouvrage de Wells pour le christianisme évangélique actuel, qui risque d’être sournoisement infiltré par ces interprétations récentes. La croix était un scandale pour le monde antique (Juifs et Grecs; cf. 1 Co 1) et l’est tout autant pour notre société postmoderne : l’idée que le Christ meure pour les péchés des hommes paraît inconcevable pour nos contemporains. Ce qui est principalement critiqué, c’est la logique de l’échange (Jésus a payé nos dettes, il est mort à notre place, il s’est livré pour satisfaire la justice divine, il a pris sur lui la punition que méritait le péché) ; les théologies modernes optent plutôt pour la logique de la gratuité (p. 30). Dieu, dit-on, aime inconditionnellement et n’a pas besoin d’un quelconque sacrifice pour pardonner le péché. Autrement dit, Dieu n’est qu’amour (et donc pas justice) ; les péchés des hommes n’exigent aucun châtiment divin.
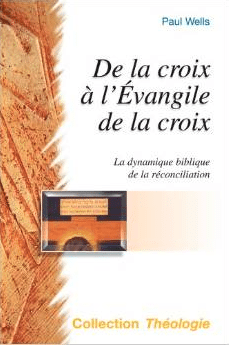
Le trait le plus appréciable de l’approche de Wells est sa fidélité aux Ecritures. Il ne craint ni de se faire des adversaires sur le plan académique, ni de ne pas attirer les foules, avides de sentimentalisme. Il a l’audace de remettre à l’honneur et de revisiter les doctrines bibliques essentielles et nécessaires à la compréhension de la croix, telles que la substitution, l’expiation, l’imputation, la justification, l’intercession, la rédemption, la satisfaction, la propitiation. Nous résumerons brièvement ici trois enseignements bibliques fondamentaux abordés par Wells, qui sont de moins en moins au goût du jour, même dans les milieux évangéliques.
Premièrement, le Dieu de l’Ancien Testament, souvent dépeint dans les Ecritures comme un Dieu courroucé contre le péché, n’est pas différent dans le Nouveau Testament. La croix de Christ en est la preuve : il a fallu rien de moins que la mort du propre Fils de Dieu pour que la colère de Dieu soit apaisée.
Dieu est en colère contre les pécheurs, et s’il ne punit pas directement l’homme qui pèche, c’est parce qu’il fait preuve de patience et de longanimité. L’être humain dans son entièreté a besoin d’être sauvé : « Le péché est singulier avant d’être pluriel », c’est-à-dire qu’il « n’est pas d’abord ce que nous faisons, mais ce que nous sommes » (p. 79).
Dieu est en colère contre l’homme non réconcilié avec Dieu parce que le péché, et non Dieu, est son maître. Et ce que le péché requiert, c’est la mort, parce qu’il est un affront contre Dieu, sa Seigneurie et sa Bonté. L’acceptation de ces réalités est indispensable pour comprendre la propitiation : le sacrifice de Christ a couvert nos péchés, et la colère de Dieu en a été apaisée.
Cela nous amène au second point souvent minimisé et parfois occulté dans nos assemblées, à savoir la nécessité d’un sacrifice pour le péché. Pourquoi Dieu ne pourrait-il pas simplement pardonner, sans punir le péché ? Parce que selon la révélation biblique, c’est le seul chemin qui mène à Dieu (on ne peut donc pas comprendre la notion de sacrifice si on refuse la révélation). Dieu a établi, dès le début (cf. Lévitique), que le sacrifice était le seul moyen de l’approcher (une traduction synonyme du mot hébreu pour sacrifice pourrait d’ailleurs être « approcheur »). Depuis la chute, la relation est brisée entre l’homme et Dieu ; il y a un gouffre qui sépare l’humanité de Dieu. Le but du sacrifice est d’effacer le péché et de restaurer la relation entre l’homme et Dieu. Wells rappelle aussi que c’est à Dieu que le sacrifice est offert, et que c’est donc pour lui qu’il fait une différence (p. 135). Le sacrifice de Christ est parfait et ultime. Il est suffisant pour effacer les péchés de ceux qui se confient en lui. Et, contrairement à ce que les détracteurs de la mort sacrificielle de Christ en disent, celle-ci est la plus grande preuve d’amour de Dieu faite aux hommes : « … [C]’est Dieu seul qui fait le sacrifice, qui pourvoit pour le péché, qui vient dans la personne du Fils, qui recouvre la culpabilité comme si elle n’avait jamais existé. La croix est l’auto-substitution de Dieu pour le péché » (p. 147).
Le salut par la grâce est le dernier point doctrinal que nous aborderons, parce qu’il est lui aussi mis à mal depuis un certain temps, souvent inconsciemment dans le milieu évangélique. « Les croyants ne sont pas sauvés par la foi – une idée fausse très répandue – mais par la grâce au moyen de la foi » (p. 253). N’entendons-nous pas souvent, pour décrire l’expérience du salut, des expressions telles que : « j’ai accepté Christ », « je me suis converti », « j’ai rencontré le Seigneur » ou « j’ai donné ma vie à Jésus » ? Le problème avec ces façons de considérer le salut, c’est qu’elles sont focalisées sur l’homme. Elles peuvent prêter à confusion et faire penser que celui qui est à l’origine du salut, c’est l’homme et non pas Dieu. Or, « ce n’est pas un changement de cœur qui sauve, ni la foi qui en elle-même et par elle-même nous obtient le salut et la paix avec Dieu. Christ lui-même est l’auteur du salut » (p. 215). Ce n’est pas nous qui devions « accepter Christ » : c’est Christ qui daigne nous accepter tels que nous sommes – de misérables pécheurs. Sans la grâce de Dieu, les hommes ne sont rien, ils courent droit vers la mort éternelle. C’est par la grâce inépuisable de Dieu et par le moyen de la foi que l’homme passe de la mort à la vie. La foi est un don, une grâce de Dieu : « la foi fait partie de la grâce et ne s’y ajoute pas » (p. 253).
En guise de conclusion, nous dirons que l’ouvrage de Paul Wells est en tout point recommandable. Plus qu’un outil de théologie systématique, il est également un exposé apologétique puissant : la substitution pénale, « fusillée » par les théologiens modernes, y est défendue magistralement.
L’ouvrage ne se lit pas d’une traite, il se déguste. Petit à petit, avec la concentration, la réflexion et la méditation qu’exigent la lecture de ces lignes, la richesse incroyable de l’Evangile se révèle. Bref, un large éventail d’enseignements bibliques solides et nourrissants : n’est-ce pas ce dont le peuple de Dieu a le plus besoin ?
Note éditoriale : cette recension a d’abord été publiée dans la revue de l’Institut Biblique Belge. Reproduction autorisée.




























