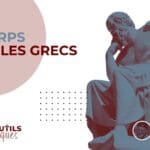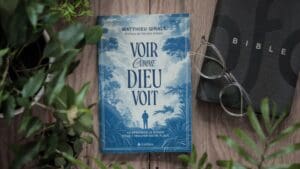1 – La manière dont Sartre pense le « corps »
Je commence par préciser que la pensée de Sartre (1905-1980) sur le sujet est bien éloignée du mode de perception de notre corps, que nous avons tous, dans la vie courante. Nous sommes bien, ici, en philosophie. Les réflexions de Sartre sur le sujet sont bien exprimées dans son ouvrage essentiel intitulé L’Être et le Néant, publié en 1943.
La question du corps, chez Sartre, est liée à une série d’oppositions, entre :
- moi et l’autre
- le corps et la conscience
- le sujet et l’objet
- l’intériorité et l’extériorité
L’articulation opérée par Sartre, entre ces divers éléments, est complexe.
Partons de l’opposition que Sartre opère entre le corps pour-soi, et le corps pour autrui.
- Le corps pour-soi, c’est-à-dire, la manière dont j’appréhende mon corps, n’a rien de corporel. C’est le corps vécu. Il est relié à mon intériorité. Il fait partie de moi. Et si je prends conscience de mon corps, de ma main, par exemple, c’est comme s’il s’agissait d’un instrument, extérieur à moi.
- Le corps pour-autrui est, à l’inverse, lié à la manière dont l’autre, cette fois, appréhende mon corps. Il lui apparaît comme un objet physique, une pure extériorité, dépourvue d’intériorité. Perception qui pourrait être mise en rapport avec celle du médecin, qui ne voit, dans le corps, qu’un ensemble de tissus et d’organes. Par conséquent, être sous le regard d’autrui est douloureux, dans la pensée de Sartre. J’ai le sentiment d’être objectivé par autrui, par le regard chosifiant qu’il porte sur moi. Toutefois, il faut préciser que Sartre ne confond pas la perception du corps de l’autre et celle d’un objet. Il écrit : « Ma perception du corps d’autrui est radicalement différente de ma perception des choses. » (1) Pourquoi ? Parce qu’autrui est un corps vivant, « une chair », et que le corps-objet serait, par conséquent, le corps mort.
Je terminerai avec cette autre citation de Sartre : le corps « a pour caractère particulier d’être essentiellement le connu par autrui : ce que je connais, c’est le corps des autres et l’essentiel de ce que je sais de mon corps vient de la façon dont les autres le voient. » (1)
2 – Mise en perspective de la pensée de Sartre
Première remarque : l’approche du corps proposée par Sartre, dans son système philosophique, est une étape, dans le rapport que nous avons avec autrui, mais cette étape est subie, car elle est négative. Une mise en relation est possible avec le philosophe allemand Hegel (1770-1831), dont Sartre reprend la dialectique du maître et de l’esclave. C’est une manière négative d’envisager la relation à autrui comme rapport de rivalité, de soumission de l’un à l’autre (2) En effet, chez Sartre, le regard d’autrui rend mal à l’aise, il donne le sentiment de ne plus être soi, le soi de la conscience de soi, mais comme un objet que l’autre regarderait.
Deuxième remarque : il est intéressant d’opérer maintenant une opposition, cette fois, entre Sartre et le philosophe Lévinas (1906-1995), qui est son contemporain. A l’inverse de Sartre, Lévinas propose une pensée positive du corps de l’autre. Dans son système à lui, le corps est tout entier « visage ». Ce « visage »-là n’est pas la face humaine. Il s’agit d’un concept philosophique lui étant propre, et désignant le fait que, lorsque l’autre apparaît à mon regard, il m’envoie immédiatement le message suivant : « Ne me tue pas ! » Lévinas évoque un être-messie pour-autrui. Il veut dire par là : être bienfaisant envers autrui.(3)
Donc, dans un cas, celui de Sartre, en regardant le corps de l’autre, je ne vois qu’une enveloppe extérieure, dont je ne perçois pas l’intériorité, tandis que, dans l’autre, chez Lévinas, je n’entends que le cri de son être intérieur, au-delà de son apparence corporelle.
3 – La Bible en écho
Mon corps sous le regard de l’autre…
Dans ses analyses, Sartre valorise ces situations où, sous ce regard, on éprouve de la honte. En écho, comment ne pas songer à Adam et Eve, après la Chute, dans le livre de la Genèse? Rendus honteux par leur désobéissance, ils cherchent à se cacher de Dieu et couvrent la nudité de leur corps : «Ils se firent des ceintures avec des feuilles de figuier cousues ensemble ». Dans ce vêtement, on peut voir, par anticipation, une annonce de l’œuvre du Christ. L’apôtre Paul écrit : « Revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ. » (Romains 13:14), ce qui signifie : croyez que, par sa mort, votre péché est pardonné, recouvert.
Une conscience purifiée donne à la fois une autre conscience de soi et de l’autre. Il n’est écrit nulle part, dans la Bible, que l’homme doit avoir honte de son corps. Mais nulle part aussi qu’il puisse être impudique. Le rapport à mon corps doit être un rapport sain : « Le corps n’est pas pour la débauche. Il est pour le Seigneur, et le Seigneur est pour le corps. » (1 Corinthiens 6:13)
Quant à mon rapport au corps de l’autre, dans une perspective biblique, il n’est même pas concevable de le penser sur le mode de son objectivation. L’autre n’est jamais « objet » à mes yeux. Le rapport sain de l’homme à son prochain est un rapport fondé, d’une part, sur une identité de nature : être créature de Dieu, et d’autre part sur l’imitation du rapport de Dieu à ses créatures, qui est un rapport d’amour, un sentiment peu exalté par Sartre…
(1) L’Être et le Néant
(2) Cf dans la série : « L’autre », la séquence « Dominer ou servir »
(3) Cf dans la série : « L’autre », la séquence : « Le visage de l’autre »