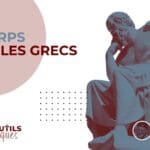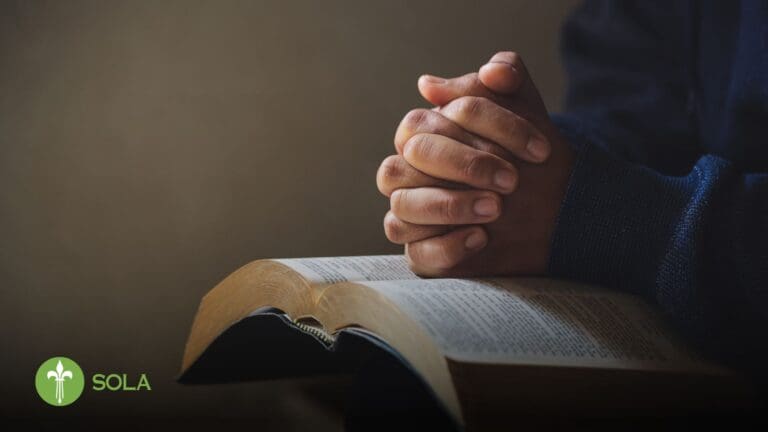Le thème de l’autre
La relation à autrui est un thème majeur de la philosophie.
La Bible révèle que l’homme a été créé par Dieu pour entrer en relation avec Dieu et avec son prochain. D’ailleurs, la relation est dans la nature même de Dieu, du fait de la Trinité. L’amour circule entre le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Mais, du côté des hommes, on est bien forcé d’admettre qu’instaurer une bonne relation avec autrui ne coule pas de source.
Dans cette série de quatre séquence, j’ai choisi deux exemples pour montrer que la relation à l’autre a parfois été pensée de manière négative :
- Par Hegel (1770-1831), philosophe allemand majeur, dans la tradition de pensée européenne, et dont « la dialectique du maître et de l’esclave » reste un fondement.
- Par Sartre (1905-1980), qui fait écho à Hegel, dans sa manière de penser le regard de l’autre sur moi, qui m’objective, c’est-à-dire ne me voyant pas tel que moi je crois être. Le regard d’autrui devient alors si insupportable que le personnage de Garcin, dans la pièce Huis-Clos, en vient à prononcer cette fameuse petite phrase : « L’enfer c’est les autres. »
Ces deux séquences sont suivies de deux autres qui, elles, envisagent le rapport à l’autre sur un mode positif, cette fois. Je les ai consacrés à :
- Lévinas (1905-1980), dont la pensée est centrée sur l’éthique. Le concept de « visage », qu’il a créé, est central chez lui et il mérite d’être découvert.
- Derrida (1930-2004), enfin, a ouvert des voies nouvelles à la philosophie. Son concept d’« hospitalité inconditionnelle » remet en question nos manières de nous comporter à l’égard de celui qui nous est tout à fait étranger, que ce soit au niveau individuel ou collectif.
Ces quatre séquences entrent donc en écho les unes avec les autres.
La dialectique du maître et du serviteur
Hegel (1770-1831) est un philosophe allemand parmi les plus importants de la tradition philosophique européenne. Sa manière de concevoir le rapport à autrui est négative, et tragique. Il l’exprime dans des pages fameuses de son ouvrage Phénoménologie de l’esprit, publié en 1807.
A la base de la relation, Hegel pose une instabilité, un déséquilibre, qui génèrent le conflit. Il considère que cette conflictualité est constitutive de la condition humaine. Il ne s’agit pas, pour lui, d’une opposition qui aurait lieu à l’intérieur de soi, entre deux tendances. Non. Le conflit, pour Hegel, est entre les deux consciences de soi de deux individus distincts, qui entrent en opposition. Hegel évoque alors ce qu’il nomme : « la dialectique du maître et du serviteur ». Le terme de « dialectique » contient, en lui, les notions de tension, d’opposition entre deux éléments. Je n’envisagerai pas, ici, tous les aspects de cette dialectique, chez Hegel, mais arrêtons-nous sur les termes de « maître » et « serviteur ».
Évoquer la relation interpersonnelle sur le mode des rapports maître-valet, c’est poser, dès le départ, une inégalité, celle du dominant sur le dominé. Par voie de conséquence, c’est aussi une manière de nier l’identité entre l’un et l’autre. Ces considérations philosophiques ne reposent pas sur des données sociales, politiques. Hegel parle bien, sur le plan moral, de la condition humaine en général. Chez lui, donc, le rapport de soumission de l’un à l’autre est premier et il génère le conflit.
Le maître considère le serviteur comme une chose, à son service. Il refuse de voir en lui son semblable. Le serviteur, lui, vit dans la peur du maître qui le domine.
2 – Efficacité de la manière de penser de Hegel
De la proposition faite par Hegel, avec « la dialectique du maître et du serviteur », et si l’on passe du plan philosophique au plan politique, il résulte que ce qui fonde le rapport social entre les êtres humains n’est pas la paix mais, au contraire, la guerre.
Bien sûr Hegel a pensé, dans son système philosophique, la possibilité, pour le serviteur, d’acquérir la reconnaissance de soi et, pour la société, la nécessité du Droit. Toutefois, dans cette partie, je veux seulement considérer, de manière générale, les conséquences d’un mode de pensée inégalitaire.
L’inégalité peut être envisagée de multiples manières :
- Inégalité physique ( le droit du plus fort, tel que l’a pensé Darwin )
- Inégalité raciale ( théories racistes définissant la supériorité des uns sur les autres )
- Inégalité culturelle ( prétention d’une culture à s’imposer comme supérieure aux autres ; ce fut le cas de l’Europe, comme cela apparaît dans le colonialisme )
- Inégalité religieuse ( lorsqu’une religion veut imposer sa domination : phénomène souvent lié à la confusion entre les plans spirituel et temporel, politique )
L’article 1er de « la Déclaration des Droits de l’homme et du citoyen » institue l’égalité entre les êtres humains. Une société régie par le Progrès devrait, dans le domaine de la justice, avoir avancé sur la voie de l’égalité. Force est de constater que la guerre, et les inégalités, sont loin d’avoir été éradiquées de notre monde.
3 – Perspective biblique
La conflictualité apparaît très tôt dans la Bible, puisque, dès le chapitre 4 de la Genèse, Caïn tue son frère Abel. Alors, « l’Éternel dit à Caïn : Où est ton frère Abel ? Il répondit : Je ne sais pas ; suis-je le gardien de mon frère, moi ? » (4:9) Le rapport de domination va, ici, jusqu’à la mise à mort.
Dès le Lévitique, Dieu ordonne : « Tu aimeras ton prochain comme toi-même. » (19:18)
Jésus reprend ce commandement : « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C’est le premier commandement. Et voici le second qui lui est semblable : Tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes. » (Matt. 22:37-40) Cette loi, Jésus va la mettre dans les cœurs, et c’est pourquoi il affirme : « Vous avez entendu qu’il a été dit aux anciens : Tu ne commettras pas de meurtre, celui qui commet un meurtre sera passible du jugement. Mais moi je vois dis : Quiconque se met en colère contre son frère sera passible du jugement. Celui qui dira à son frère : Raca ! Sera justiciable du sanhédrin. Celui qui lui dira : Insensé ! Sera passible de la géhenne du feu. » (Matt ; 5:21-22)
Très clairement, c’est l’amour qui est placé en premier dans la Bible. L’autre doit être considéré comme un proche, un égal, un frère. Et quant au rapport de domination, Jésus le renverse avec autorité : « Quiconque veut être le plus grand parmi vous sera votre serviteur. » (Matt. 20:26) Pourquoi ? Parce que « le serviteur n’est pas plus grand que son seigneur » (Jn 13;10) et que « le Fils de l’homme est venu, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour beaucoup. » (Matt ; 20:28)
L’esprit de domination mène à la mort mais l’esprit de service mène à la vie.
Pour aller plus loin :
La dialectique du maître et de l’esclave (Hegel) :
- une vidéo (4 minutes) : https://www.dailymotion.com/video/x178cea
- un article (wikipédia) : https://fr.wikipedia.org/wiki/Dialectique_du_ma%C3%AEtre_et_de_l%27esclave