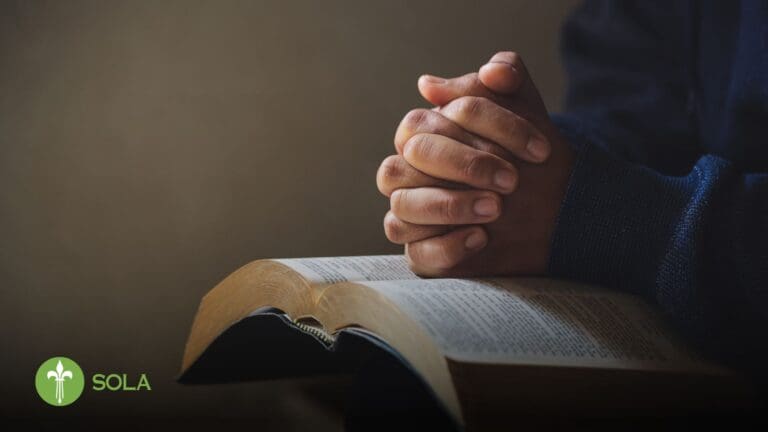Les débats éthiques et sociaux actuels posent de manière aiguë la question de la place des chrétiens dans l’espace public. Il suffit d’être sur les réseaux sociaux pour s’en rendre compte. Que ce soient d’autres chrétiens, ou les réactions de nos contemporains… notre place publique est en question. Cela ne veut pas dire qu’elle est remise en question, ou niée, mais il y a une question légitime sur la place que nous pouvons avoir.
Le Fils serviteur
Vouloir trouver dans la Bible un verset qui parlerait clairement et directement de cela est un peu difficile. La société de Jésus est loin d’être une société sécularisée comme l’est la France du 21e siècle. Pourtant, un épisode rapporté dans le seul Évangile de Matthieu est instructif. Il se trouve au chapitre 17 :
« Lorsqu’ils arrivèrent à Capernaüm, ceux qui percevaient les deux drachmes s’adressèrent à Pierre et lui dirent : Votre maître ne paie-t-il pas les deux drachmes ? Si, dit-il. Et quand il fut entré dans la maison, Jésus prit le premier la parole et dit : Simon, qu’en penses-tu ? Les rois de la terre, de qui prennent-ils des taxes ou un tribut ? De leurs fils, ou des étrangers ? Il lui répondit : Des étrangers. Et Jésus lui répondit : Les fils en sont donc exempts. Mais pour que nous ne les scandalisions pas, va à la mer, jette l’hameçon, et tire le premier poisson qui viendra, ouvre-lui la bouche, et tu trouveras un statère. Prends-le, et donne-le-leur pour moi et pour toi. » (Matthieu 17.24-27)
Ces quelques versets mériteraient d’en discuter longuement. Notons une chose : Jésus affirme qu’en tant que Seigneur de tout, Il a un privilège… un privilège que partage Pierre. Il est Fils, et tout appartient à son Père, d’où la réponse a priori surprenante de Jésus : « Les fils en sont donc exempts. » Tout lui appartient. Pierre, son disciple et son frère, partage ce privilège.
Jésus réclame-t-il exemption sur la base de sa Seigneurie sur tout l’univers ? Non. Il aurait tout à fait pu. Ceux qui récoltaient la taxe ne l’auraient pas compris, mais de la part du Fils, en qui, par qui, et pour qui ont été créées toutes choses, cela aurait été légitime.
Au lieu de cela, que fait Jésus ? Il se fait serviteur, ce qui est le cœur de l’incarnation. Le Fils est serviteur. Il n’exige pas de bénéficier de tous les droits qui sont les siens en tant que Fils éternel. Il envoie ainsi Pierre « pécher la taxe » de deux drachmes.
Jésus a un privilège, Il a des droits qu’Il pourrait exercer, réclamer. Il n’en fait rien. Son statut de serviteur n’est pas en jeu, sa messianité et sa proclamation du royaume non plus. C’est au contraire une opportunité pour lui de démontrer sa messianité et sa mission de serviteur. Afin de ne pas scandaliser Jésus, le Serviteur, accepte de payer la taxe.
De Jésus à ses disciples
Cette attitude n’est pas visible chez notre Seigneur seulement car ceux qui portent son nom sont appelés à être à son image. L’apôtre Paul s’est lui aussi fait serviteur de cette manière. Il n’a pas exigé le bénéfice de tous ses droits. Lorsqu’il défend son ministère, Paul rappelle aux Corinthiens qu’il a les mêmes droits que tous les autres apôtres : celui de vivre de la proclamation de l’Évangile (1 Corinthiens 9.1-14). Cependant, Paul ne demande rien des Corinthiens car il a en vu quelque chose de supérieur à ses propres droits : les Corinthiens eux-mêmes, et la proclamation de l’Évangile. Le terme qu’emploie Paul est significatif parce qu’il rappelle l’identité de Jésus : « Car, bien que je sois libre à l’égard de tous, je me suis rendu le serviteur de tous, afin de gagner le plus grand nombre. » (1 Corinthiens 9.19) Le mot est lâché : serviteur. Jésus a été serviteur, Paul se veut serviteur.
L’exemple de Jésus, dont nous trouvons l’écho dans le ministère de Paul, met en lumière une dimension cruciale de notre présence dans le monde : nous sommes serviteurs. Ceux de Jésus avant tout, et peut-être parfois, contre tout… mais nous sommes aussi serviteurs de notre prochain. Cet aspect de notre service est encadrée de cette qualification de Jésus : « pour que nous ne les scandalisions pas ».
Dans notre vie publique, sommes-nous conscients des limites qui pourraient faire de nos convictions un objet de scandale ? Exigeons-nous nos droits ? Réclamons-nous, avec force et arguments, tout ce à quoi nous estimons avoir droit ? C’est une tentation bien naturelle. Ce faisant, oublions-nous que nous sommes serviteurs ? Nous sommes serviteurs de Jésus, serviteurs de son Évangile. Tout ce que nous faisons doit être tourné vers ce service.
Tout ce que nous disons et faisons, même les droits que nous réclamons doivent avoir en vue le service de Jésus et de l’Évangile de grâce. Scandalisons-nous, choquons-nous, sans nécessité, et sans y réfléchir ? Si nous sommes un objet de scandale, est-ce vraiment à cause de l’Évangile ? Lui seul devrait être une pierre qui fait chuter (1 Pierre 2.7 ). Les droits dont nous nous réclamons, même lorsqu’ils sont vraiment des droits que nous pourrions réclamer, valent-ils la peine de l’offense qu’ils pourraient causer ? Oui, nous voulons exercer notre « liberté », mais Paul nous rappelle dans la même lettre aux Corinthiens : « Prenez garde, toutefois, que votre droit ne devienne une pierre d’achoppement pour les faibles. » (1 Corinthiens 8.9)
Il se peut que nos affirmations, notre foi, et notre attitude, deviennent un scandale, une offense. Prenons garde à ce que ce soit pour les bonnes raisons.