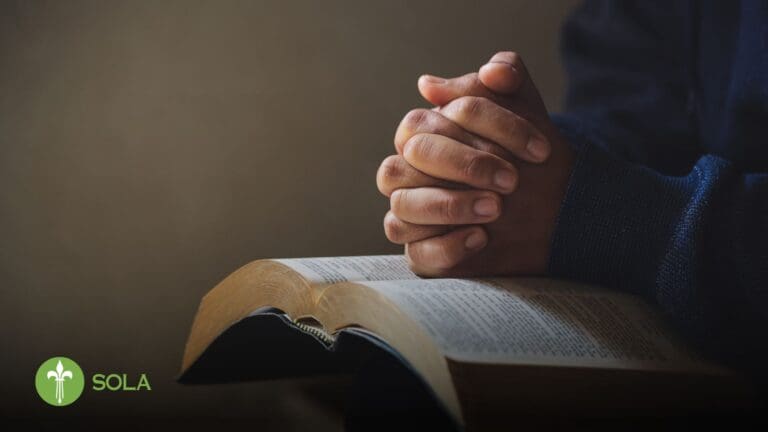Quand il est question d’accompagnement spirituel ou de relation d’aide – ou plus largement de relations humaines ou encore fraternelles – il est courant d’entendre parler d’accueil inconditionnel, d’amour inconditionnel ou encore de non-jugement ou de non-discrimination. Tout cela participe de ce qu’on appelle maintenant la vision inclusive. Ces notions sont d’autant plus difficiles à évaluer qu’elles paraissent contenir la réponse parfaite à toutes les mesquineries du passé. Quiconque voudrait s’interroger sur leur véritable pertinence donnerait l’impression de vouloir attaquer l’Evangile lui-même.
1. Le contexte
Ces expressions se sont développée dans des contextes définis : celui de la psychanalyse, celui de l’action sociale, puis dans celui d’une certaine théologie empreinte de psychanalyse et de sociologie. Parler d’accueil inconditionnel dans le domaine humanitaire ou social, c’est s’assurer qu’on n’usera pas de discrimination dans l’aide à apporter aux personnes en difficulté. Cette disposition est très heureuse. Parler de non-jugement en psychanalyse, c’est offrir la possibilité à celui qui parle de tout dire sans recevoir ipso facto une leçon de morale. Cela peut s’avérer très précieux. Parler d’amour inconditionnelc’est, en théologie, se référer à l’amour immérité de Dieu (ce n’est pas en raison de nos qualités ou de nos œuvres que nous sommes aimés) ou encore à l’assurance du salut que peut avoir celui qui croit en Jésus-Christ.
Parler d’amour inconditionnel c’est, en théologie, se référer à l’amour immérité de Dieu (ce n’est pas en raison de nos qualités ou de nos œuvres que nous sommes aimés) ou encore à l’assurance du salut que peut avoir celui qui croit en Jésus-Christ.
Parlant de ses brebis, Jésus dit : Je leur donne la vie éternelle, elles ne périront jamais et personne ne les ravira de ma main (Jn 10.28). Ces trois affirmations sont à prendre à la lettre, mais elle se situent dans un contexte précis : Jésus parle de ses brebis, qu’il connaît et qu’elles connaissent – y compris d’ailleurs la brebis perdue de Luc 15. Ce qui pose question, par contre, c’est l’emploi généralisé de ces formules, leur utilisation… inconditionnelle.
2. Les contre-exemples bibliques
Que l’amour de Dieu soit totalement immérité, c’est un fait qui ne peut se contredire. Que l’amour de Dieu soit inconditionnel, cela est loin d’aller de soi. Quand le Psaume 1er recommande de ne pas s’asseoir sur le banc des moqueurs, on n’y voit pas l’expression d’un accueil ou d’un amour inconditionnels.
Jean-Baptiste a-t-il accueilli tous ceux qui se sont approchés de lui ? Il a parlé sévèrement à certains, les appelant races de vipères (Mt 3.7) et mentionnant la réalité d’un jugement à venir qui séparera les uns d’avec les autres (3.10).
Jésus a-t-il accueilli tous ceux qui se sont tenus devant lui ? La réponse est non. Etait-ce un manque d’amour ? Quand Jésus traite Hérode de renard (Lc 13.32) et les pharisiens de sépulcres blanchis (Mt 23.27), quand dans sa prière il dit : Je ne te prie pas pour le monde mais pour ceux que tu m’as donnés(Jn 17.9), on ne trouve pas exactement ce qu’on entend aujourd’hui pas ‘amour inconditionnel’. Alors qu’il est sur la croix, Jésus est entouré par deux malfaiteurs qui, tous les deux, s’adressent à lui. Un seul sera accueilli ; à l’autre, Jésus ne dira pas même un mot.
En somme, il n’y a jamais de mérites, mais il y a des conditions qui sont imposées par les termes de l’alliance que Dieu offre et dans laquelle il s’engage. Il y a là quelque chose de mystérieux et d’incontournable. Si mon peuple sur qui est invoqué mon Nom s’humilie, prie et me cherche… (2 Ch 7.14). Tout ne revient pas au même. En réalité, on trouve beaucoup de conditions dans la Bible qui ne nient pas la réalité de la grâce : elles en indiquent au contraire le chemin.
3. Ne pas faire acception de personnes
L’expression ne pas faire acception de personnes, que l’on trouve plusieurs fois dans le Nouveau Testament, n’est pas aisée à comprendre à première lecture. Elle peut cependant nous aider à saisir le sens juste des expressions que nous examinons ici.
Plusieurs comprennent cette expression comme s’il s’agissait de ne jamais faire de différence entre les personnes. Est-ce le sens ? Dans le livre des Actes, Pierre dit : En vérité, je reconnais que Dieu ne fait pas acception de personnes ; mais en toutes nations, celui qui le craint et qui pratique la justice lui est agréable (10.34-35). Y aurait-il une contradiction entre les deux parties de la phrase ? Que dit Pierre ? Il dit que les distinctions traditionnelles que font les Juifs (entre Juifs et non-Juifs) ne correspondent pas à celles que Dieu fait maintenant. Il n’y a donc plus de différences à faire à ce niveau-là. Cependant, une autre différence demeure entre celui qui craint Dieu et celui qui ne le craint pas ! Quand Paul écrit que le mur de séparation (entre Juifs et non Juifs) a été renversé (Ep 2.14), il ne dit pas que tous les hommes de la terre sont maintenant agréés par Dieu et regardés comme ses enfants. Il dit que Dieu va se susciter un peuple parmi les nations, d’entre les nations (Lc 24.27 ; Ac 10.35 ; 14.27 ; 1 Tm 3.16).
C’est pour cela que les notions d’accueil inconditionnel ou de non-jugement peuvent s’avérer trompeuses si elles sont utilisées de manière absolue. Ce qui est juste, c’est de ne pas faire de différence en fonction de l’origine ou de l’apparence, ou en fonction de nos goûts ou de notre intérêt personnel ; c’est de ne pas user de préférence pour des raisons subjectives[1]. Cette impartialité du regard est naturellement demandée aux magistrats qui agissent de la part de Dieu (Ro 13.4) et non à sa place ; elle est demandée aux anciens dans les églises, qui doivent eux aussi être loyaux,désintéressés (1 Tm 3.3 ; 1 Pi 5.2) et ne pas traiter de manières différentes les chrétiens selon qu’ils sont riches ou pauvres (Jc 2.1-9). Cette impartialité est demandée à nous tous, si nous désirons agir comme des serviteurs avisés, approuvés par leur maître.
Il y a donc une manière juste d’accueillir et d’aimer, de juger et de se séparer, et il y a une manière dévoyée qui sera, selon les cas, trop sévère ou trop laxiste. Une est selon Dieu, l’autre est selon l’homme. Il importe de juger entre les deux.
4. Juger ou ne pas juger ?
Le verbe juger est assez souvent utilisé dans la Bible, tantôt avec le sens positif de discerner, tantôt avec le sens négatif de mépriser ou condamner. Le nombre d’emplois positifs est très nettement supérieur. Avec Moïse jugeant le peuple, bientôt secondé pour cela par les anciens (Ex 18.13, 21-23) , avec Salomon qui, pour ce faire, recevra de Dieu la sagesse et l’intelligence (2 Ch 1.11), nous comprenons que juger signifie exercer un discernement accordé à la pensée de Dieu, en vue d’aider. C’est dans ce sens que Paul demandera aux Corinthiens s’il n’y a pas parmi eux un homme sage qui puisse juger (départager) entre ses frères, plutôt que d’avoir des querelles (1 Co 6.5).
Mais n’est-il pas écrit aussi qu’il ne nous convient pas de juger (Mt 7.1 ; Ro 14.10) ? Cela est écrit, et le mot grec est le même. Mais le contexte montre, dans ce cas, que celui qui exerce un jugement ne le fait pas de la part de Dieu (ce qui est légitime) mais à la place de Dieu (ce qui ne convient pas). Cela apparaît clairement quand Paul écrit : Mais toi, pourquoi juges-tu ton frère ? Ou toi, pourquoi méprises-tu ton frère ? puisque nous comparaîtrons tous devant le tribunal de Christ (Ro 14.10-11).
Il est significatif de voir que peu après avoir dit de ne pas juger (à la place de Dieu), Jésus recommande de ne pas donner les choses saintes aux chiens, de ne pas jeter les perles aux pourceaux (Mt 7.6), ce qui nécessite d’exercer un jugement, de discerner, de distinguer. Entre les deux passages, il y a la parabole de la poutre et de la paille (7.3-5) qui indique le chemin d’un nécessaire jugement (sur soi-même) en vue d’aider.
5. L’amour croit-il tout ?
Croyants et incroyants aiment se référer au chapitre 13 de la première lettre aux Corinthiens où on peut lire notamment que l’amour croit tout (v. 7). Beaucoup en déduisent que l’amour tient toutes choses et toutes les opinions comme étant égales, que l’amour ne dit jamais non. Est-ce juste ? La réponse est au v. 6 : L’amour ne se réjouit pas de l’injustice, mais il se réjouit de la vérité. On comprend que la vérité et la justice recouvrent une même réalité, celle de la volonté juste de Dieu. Quand l’amour (on pourrait mettre là le nom de Jésus-Christ) voit une chose que Dieu approuve, il se réjouit et dit oui. Quand il voit une chose que Dieu désapprouve, il s’attriste et dit non.
L’amour croit ‘tout et n’importe quoi’, mais que l’amour croit et espère tout ce qui est juste et vrai, tout ce que Dieu approuve, sans trier, sans retenue, entièrement
A cette lumière, nous comprenons que le verset 7 ne dit pas que l’amour croit ‘tout et n’importe quoi’, mais que l’amour croit et espère tout ce qui est juste et vrai, tout ce que Dieu approuve, sans trier, sans retenue, entièrement[2]. C’est le sens du Psaume 119, ou encore de ce qu’écrit Paul aux Philippiens : Que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est digne d’être aimé, tout ce qui est digne d’approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l’objet de vos pensées (4.7-8). Cette énumération impose bien une totalité (tout ce qui est vrai, et pas seulement ce qui me plaît), mais elle exclut bel et bien tout le reste !
__________
Les notions d’amour inconditionnel et de non-jugement devraient être utilisées avec parcimonie, sous peine de promouvoir un Evangile trompeur. Est-ce faire une restriction à l’amour que de dire cela ? C’est plutôt rendre justice à l’amour de Dieu qui seul est vrai.
Quand la Bible évoque le caractère inconditionnel de l’amour de Dieu (sans utiliser ce terme), c’est pour parler des élus, de ceux dont Jésus peut dire (à son Père) : Ils étaient à toi, tu me les as donnés, et ils ont gardé ta parole (Jn 17.6). La réalité d’un amour inconditionnel de Dieu existe, mais il relève du mystère de l’élection et il ne convient pas de s’y référer avec légèreté.
Faudrait-il alors ne jamais en parler ? Il faut en parler en respectant la mesure de l’Ecriture, notamment dans une perspective pastorale comme le fait le Catéchisme de Heidelberg (1563) avec sa question 21 : Qu’est-ce que la vraie foi ? Ce n’est pas seulement une connaissance certaine par laquelle je tiens pour vrai tout ce que Dieu nous a révélé par sa Parole ; mais c’est aussi une confiance de cœur que l’Esprit saint produit en moi par l’Evangile et qui m’assure que ce n’est pas seulement aux autres mais aussi à moi que Dieu accorde la rémission des péchés, la justice et le bonheur éternels, et cela par pure grâce et par les seules mérites de Jésus-Christ.
Faisons attention de ne pas profaner les choses saintes.