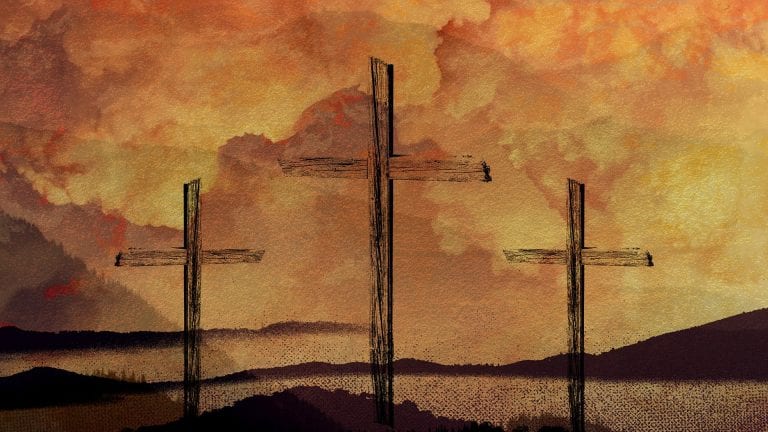Si vous travaillez dans le domaine des services, des finances, du multimédia, de l’art ou de l’éducation, vous vous êtes certainement inquiété d’être remplacé par une intelligence artificielle (IA) générative. Vous vous êtes probablement senti placé dans une compétition inégale avec un dispositif plus productif et plus efficace que vous, et vous vous êtes demandé si l’esprit d’innovation ou la créativité seraient des valeurs suffisantes pour rester sur le marché. Peut-être avez-vous l’impression de vivre un cauchemar éveillé face à la généralisation des IA.
Ce distant futur tant dépeint dans les films de science fiction est devenue une réalité bizarrement désincarnée. Ainsi, au lieu d’un robot armé de lasers, il a pris la forme d’une simple fenêtre aux accents amicaux et rassurants qui, tel le génie de la lampe d’Aladin, peut accomplir tous nos souhaits. Au lieu d’un maître omnipotent, un esclave envahissant. Au lieu d’une calculatrice sans âme, un miroir capable de parfaire son imitation à chaque fois que nous nous présentons devant lui.
Le cinéma a depuis longtemps exprimé cette inquiétude, le terme de « cauchemar » n’est pas pris ici au hasard ; dans une perspective freudienne, il désigne bien le travail inconscient que le cinéma réalise pour notre civilisation en mettant nos psychés face à ces menaces virtuelles pour mieux les intégrer et exorciser la possibilité d’un monde sans êtres humains. Par exemple, la série Black mirror (depuis 2011) s’efforce de reprendre chaque nouvelle possibilité technique offerte par le digital et le virtuel pour nous en montrer les dérives, le miroir du titre renvoie à la fois à l’écran d’ordinateur (noir, parce que la terrible réalité qu’il cache n’est pas visible au premier abord) et au projet de la série de présenter un reflet dystopique de notre société.
Le robot sauvage prend le contrepied de la machine tueuse, et raconte l’histoire d’une assistance mécanique échouée sur une île et livrée à elle-même, qui va devenir à la fois la meilleure amie d’un renard et la mère d’un… oison.
Dans cette atmosphère anxiogène, Le robot sauvage prend le contrepied de la machine tueuse, et raconte l’histoire d’une assistance mécanique échouée sur une île et livrée à elle-même, qui va devenir à la fois la meilleure amie d’un renard et la mère d’un… oison.
Revenons sur la présence de la figure du robot et de l’IA dans le cinéma. Si l’on peut remonter dans notre culture jusqu’à l’Antiquité avec l’automate Talos, construit par le dieu Héphaïstos pour protéger la Crète et lointain ancêtre du Terminator, c’est le roman Frankenstein de Mary Shelley (1820) qui marque son époque avec ce récit d’une créature cherchant désespérément à retrouver son créateur, avant de se décider à le tuer. Frankenstein est le savant « fou » qui représente une science dont plus aucune religion ou morale ne vient limiter la quête (nous sommes au temps de la révolution industrielle, de la biologie et de l’invention par Volta de la pile électrique).
Dans le film allemand Metropolis (1927), le robot est la contrefaçon malfaisante d’une femme créée pour tromper le chef d’une rébellion. Nous sommes bien dans les années 1930, la peur renvoie à celle de l’inhumanisation des régimes et des dictatures. Cinquante ans plus tard, les « gentils » robots de Star wars incarnent l’espoir retrouvé dans le progrès humain que permet une technologie maîtrisée, avant de revenir avec Terminator (1984) à l’angoisse face au perfectionnement de l’intelligence artificielle et à ce qui se passerait si la créature se retournait contre le créateur.
La série Battlestar galactica (2004-2009) s’ouvre par une révolte des Cylons (des robots à apparence humaine), qui force les humains à fuir dans des vaisseaux à travers la galaxie, et aboutit à une explication quasi mythologique des origines de la Terre et de l’humanité. Toute la série est empreinte de religion, au travers de légendes, de prophéties sur « la treizième colonie » et de figures d’élus (l’un des personnages principaux reçoit des visions qui l’amènent à penser qu’il a été choisi pour un mystérieux plan divin), jusqu’aux noms des personnages : Adama/Adam, Apollo/Apollon, Gaius/Gaia (la déesse grecque de la Terre), Saul/Saül, même les Cylons, bien qu’ils s’identifient par leurs numéros, s’appellent entre eux « frères » comme au sein d’une communauté de moines.
Depuis la fin des années 1990, les robots oscillent entre les figures de Frankenstein et de Pinocchio, la marionnette qui rêvait de devenir humaine. Dans le film d’animation japonais Ghost in the shell (1995), un cyborg combat une intelligence artificielle ayant accédé à la conscience et cherchant à se reproduire non pas comme un virus, mais comme un humain. L’homme bicentenaire (2000) est l’histoire d’un robot rêvant de devenir humain, AI (2001) le récit bouleversant d’un enfant robot prêt à tout pour être aimé par sa mère humaine. Blade runner (1982), I, robot (2004), la saga Transformers (2007), Ex machina (2014), Chappie (2015), les séries Real humans (2012) et Westworld (2016), Alita : battle angel (2019) parlent de robots qui découvrent la notion de morale, s’interrogent sur leurs différences avec l’humanité et se retrouvent face au Mal de l’Homme. Ces films mettent en scène une singularité, c’est-à-dire la prise de conscience d’une machine de sa propre existence différenciée, un évènement qui était de l’ordre de l’impossible, mais pourrait intervenir en 2026 selon le PDG d’Anthropic.[1]
Roz, la protagoniste du robot sauvage s’inscrit dans la lignée du Géant de fer (1999) et de Wall-e (2008) pour nous dépeindre des créatures choisissant naturellement de faire le bien, incarnant la pureté de l’enfant, par opposition à une humanité corrompue par la guerre et la surexploitation des ressources. Mais sont-ils si différents du Terminator ou des Cylons dans la critique qu’ils apportent de l’état de disgrâce dans lequel nous sommes tombés ?
Le robot nous interroge à la fois sur notre origine et sur notre devenir. D’une part, la capacité scientifique de créer une vie intelligente ressemblant en tout point à la nôtre fait-elle de nous des dieux pour ces créations ? Mais si le rapport entre une créature et un créateur rejoue le lien entre un humain et un dieu, qu’en est-il de nous ? Qui est notre créateur, et donc notre dieu ? Le postulat que nous sommes le produit du hasard est-il encore tenable en face de créatures comme les robots, nées de processus techniques guidés par une volonté consciente ?
D’autre part, les films de robot nous permettent de poser une question brûlante aux matérialistes : si nous ne sommes que des machines biologiques pensantes issues d’un process d’évolution, au nom de quoi ne pourrions-nous pas être remplacés par…d’autres machines pensantes ? La compétition n’est-elle pas inévitable ?
Dès 2014, le film Her avait prédit que l’IA viendrait un jour combler la solitude de l’Homme contemporain. Le héros, incapable de construire une relation durable avec une femme dans une modernité individualiste et désenchantée, tombe amoureux d’une IA dans laquelle il trouve complicité, empathie… et amour inconditionnel. Le premier épisode de la saison 2 de Black mirror (2011-2019), dans lequel une jeune veuve retrouve son mari au travers d’un programme vocal nourri de toutes ses publications sur le cloud n’est même plus de la science-fiction : la société sud-coréenne Deepbrain AI propose depuis 2023 Re-memory, qui génère l’avatar d’un défunt. L’interdit biblique de parler aux morts prend soudain une autre dimension…
En réalité, que les robots soient bienfaisants ou maléfiques, tous dévoilent en quoi l’Homme n’a pas rempli sa mission. Dans The Matrix (1999), l’agent Smith accuse l’Homme d’avoir failli à son mandat créationnel : « Tous les mammifères sur cette planète ont contribué au développement naturel d’un équilibre avec le reste de leur environnement, mais vous, les humains, vous êtes différents. (…) Les humains sont une maladie contagieuse, le cancer de cette planète, vous êtes la peste et nous, nous sommes l’antidote. » Dans 2001, L’odyssée de l’espace (1968), Hal 9000 tente de supprimer les humains du vaisseau spatial, considérant qu’ils sont devenus un obstacle à leur mission… qui consiste justement à retrouver les créateurs de l’humanité !
Les robots nous rappellent notre faiblesse, notre incomplétude, notre incapacité à atteindre les buts matériels, moraux et relationnels que nous nous étions fixé.
Ce n’est pas un hasard si le thème de la révolte des machines est apparue au début du XXe siècle, peu de temps après l’affirmation nietzschéenne de la mort de Dieu. Les robots nous rappellent notre faiblesse, notre incomplétude, notre incapacité à atteindre les buts matériels, moraux et relationnels que nous nous étions fixé. Si nous avons tué notre créateur, n’est-il pas naturel, voire légitime, que nos créations se retournent contre nous à leur tour ? Qu’en est-il de notre liberté si nous créons un serviteur plus fort et plus intelligent que nous ? Comment justifier le lien de subordination si nous-mêmes avons désobéi à notre Créateur ? Si tu es un dieu, nous dit le robot, pourquoi es-tu si faible et limité ?
En cela, le robot poursuit la critique initiée par Chaplin dans Les temps modernes de la place de l’homme dans une société industrielle et productiviste. Si le but de l’Homme est de travailler, de produire, d’engranger des richesses, alors il perd sa raison d’être face à un robot qui peut faire son travail sans commettre d’erreurs et sans se fatiguer. La problématique est la même avec l’ordinateur et l’IA : ce n’est plus seulement notre corps qui est surpassé, mais notre esprit.
Le Robot sauvage propose une autre solution, et trouve son inspiration dans Du contrat social de Jean-Jacques Rousseau. Après avoir découvert que sa raison d’être réside dans la relation à l’autre, Roz encourage les animaux à sortir de leur état de nature égoïste pour s’unir face à de nouvelles menaces (le climat, l’invasion d’autres robots ennemis, et l’incendie final). Même le renard Fink, qui incarne l’individualiste tirant parti du système, doit trouver sa place, en harmonie avec les autres espèces.
Rousseau définit la « liberté » comme « l’obéissance à la loi qu’on s’est prescrite ». Le robot sauvage est une utopie, qui part du postulat qu’une créature artificielle peut découvrir le bien toute seule et se sacrifier pour une autre créature, et masque le prix à payer pour ce bonheur social : la soumission à la volonté générale. En effet, selon Rousseau, un contrat social est la seule solution viable lorsque les besoins de chacun sont supérieurs à ce que chaque Homme peut faire pour y subvenir par lui-même. Il écrit ainsi que « Chacun de nous met en commun sa personne et toute sa puissance sous la suprême direction de la volonté générale. » [2]
Le robot sauvage ne parle donc pas des rapports entre robot et humain (Ross et les animaux sont bien trop anthropomorphes pour cela), il défend une philosophie humaniste prétendant que nous devons échapper à notre créateur pour nous constituer en collectif. La société sauve l’Homme de lui-même, en quelque sorte.
Toutefois, une autre lecture du film est possible, qui inverserait les rôles. Le robot sauvage est aussi le parcours d’une créature asservie cherchant à renouer avec sa nature à travers la Nature, puisqu’être au service de l’autre réside déjà dans sa programmation. Nous avons parfois tendance à voir dans les tenants de l’ordre établi des figures de Dieu, quand le diable intervient comme le « rebelle » du système. C’est oublier que le mot liberté ne fait en aucun cas partie du vocabulaire de Satan. Il ne s’en est servi que pour tromper Adam et Eve, mais ceux-ci étaient déjà essentiellement libres dans l’Eden. Ils pouvaient consommer tous les fruits du jardin, à l’exception de ceux d’un seul arbre, une contrainte bien peu pénible comparé à toutes celles que l’homme et la femme subiront lors de la Chute.
L’Homme a été programmé par Dieu pour être en relation avec lui, ce programme n’agissait pas comme un déterminisme puisque l’Homme disposait d’une liberté de choix. C’est dans l’expérience de cette relation, horizontale avec la femme, et verticale avec Dieu, qu’il pouvait se développer. Je ne vois pas l’Eden comme un tableau figé, immuable, pensons à l’injonction divine de Genèse 1.28 (Dieu les bénit en disant : Soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre, rendez-vous en maîtres). Le diable a introduit un bug avec son mensonge Vous serez comme des dieux alors qu’Adam et Eve en avaient déjà un attribut, l’immortalité. L’autodétermination n’a mené qu’à l’esclavage, la libération n’a été possible que par l’incarnation de Jésus, ce renversement de créateur en créature.
De nombreux chrétiens s’émeuvent du développement incontrôlable de l’IA , à l’exemple du collectif d’Anastasis et de sa tribune « L’IA est une profanation de la Parole ». Tim Kyle, directeur de BLF, prône la vigilance de manière plus nuancée : « Comme toute technologie, l’IA a le pouvoir de nous façonner, de transformer la façon dont nous vivons et donc comme nous vivons notre foi . (…) Je pense qu’une des plus grosse tentation actuelle est d’adhérer à une certaine théologie de la Silicon Valley qui nous enseigne que l’on peut sauver l’humanité avec la technologie. Seul Dieu sauve. »[3] Qu’ils soient utopiques ou dystopiques, les films de robot se signalent donc par leur réflexivité, nous sont utiles pour poser les questions les plus profondes et ouvrent facilement un dialogue nourri entre science et spirituel.
Parce qu’il utilise avec brio quoique sans originalité toutes les recettes héritées des Disney et des Pixar, Le robot sauvage reste un excellent film à découvrir en famille, et un bon support de discussion.