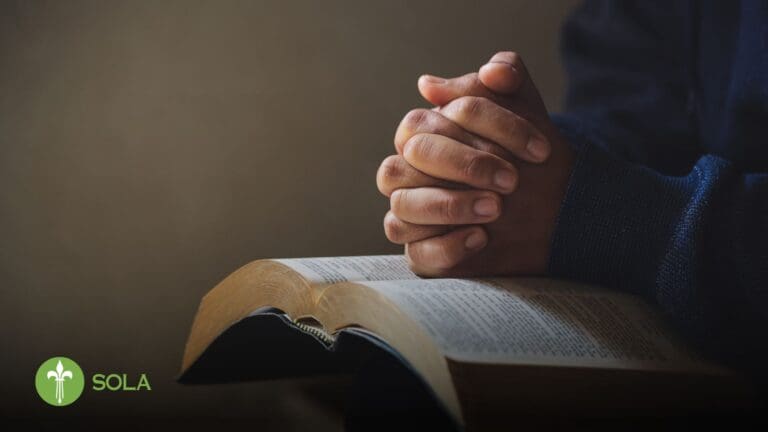Introduction
Dans la cuisine de notre petite maison, une discussion revient de temps à autre. Elle débute souvent par un monologue, quand j’exprime à haute voix ma déception quant aux résultats obtenus après avoir fourni quelques efforts derrière les fourneaux. Ce peut être lié à un gâteau pas assez cuit, à un plat salé plus que nécessaire, à un gratin trop sec ou à des gaufres molles. Ma femme pose alors la question récurrente : « As-tu suivi une recette ? » La réponse est souvent négative… Mais cette première question en soulève une autre : suivre une recette à la lettre, est-ce la garantie de réussir tous ses plats ? Et, plus largement, les recettes sont-elles la clé du succès dans d’autres domaines ? Peut-être même dans le domaine spirituel ?
C’est ce qui semble transparaître de Josué 1.1-9. Alors que Moïse vient de mourir, la lourde tâche de prendre la relève incombe à son disciple, éponyme du livre déjà cité. Sans doute à cause de l’ampleur du défi, ce dernier reçoit un encouragement personnel de la part de Dieu :
Après la mort de Moïse, le serviteur de l’Éternel, l’Éternel dit à Josué, fils de Nun et assistant de Moïse : « Mon serviteur Moïse est mort. Maintenant, lève-toi, passe le Jourdain avec tout ce peuple pour entrer dans le pays que je donne aux israélites. Tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne, comme je l’ai dit à Moïse. Votre territoire ira depuis le désert et le Liban jusqu’au grand fleuve, jusqu’à l’Euphrate, tout le pays des Hittites et jusqu’à la mer Méditerranée vers le soleil couchant. Personne ne pourra te résister tant que tu vivras. Je serai avec toi comme j’ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai pas et je ne t’abandonnerai pas. Fortifie-toi et prends courage, car c’est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j’ai juré à leurs ancêtres de leur donner. Seulement, fortifie-toi et aie bon courage en te conformant fidèlement à toute la loi que Moïse, mon serviteur, t’a prescrite. Ne t’en écarte ni à droite ni à gauche afin de réussir où que tu ailles. Que ce livre de la loi ne s’éloigne pas de toi! Médite-le jour et nuit pour agir avec fidélité conformément à tout ce qui y est écrit, car c’est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c’est alors que tu réussiras. Ne t’ai-je pas ordonné : ‘Fortifie-toi et prends courage’? Ne sois pas effrayé ni épouvanté, car l’Éternel, ton Dieu, est avec toi où que tu ailles ». (Jos 1.1-9, S21)
Dans ce texte, ce qui frappe particulièrement, c’est la promesse adressée à Josué : s’il médite la Loi de Moïse, et bien sûr s’il l’applique, il aura « du succès dans ses entreprises, il réussira ». En tant que lecteurs modernes, nous ne pouvons que nous interroger : cette promesse est-elle valable pour nous aussi ? La clé du succès se trouve-t-elle dans la Loi de Dieu ? Une application stricte de cette loi, à la manière d’une recette de cuisine, est-elle le moyen d’atteindre le succès ?
1. Une lecture analogique : Josué et nous
Une première manière de faire un pont entre ce texte et nous consiste à nous identifier à Josué. Dieu lui confie une mission importante, il est responsable de guider le peuple et de le faire entrer dans le pays promis. À notre échelle, nous pouvons nous considérer, nous aussi, missionnés par Dieu. Nous avons la charge de faire des disciples, nous sommes responsables les uns des autres, nous œuvrons à l’établissement du Royaume de Dieu sur la Terre. Si une analogie est possible entre la mission de Josué et la nôtre, pourquoi la promesse ne tiendrait-elle pas ? Vivre selon la Loi de Dieu nous garantirait alors un certain succès dans nos vies.
C’est bien là le parti pris par certains courants évangéliques. Si nous respectons suffisamment la loi de Dieu, alors nous aurons du succès. Certains le prêchent subtilement en évoquant le succès familial, social ou spirituel : une vie de couple épanouie, des relations apaisées et peut-être même un service dans l’Église gratifiant. D’autres le sont moins et promettent une belle maison et un compte en banque bien garni. En réalité, peu importe la définition donnée au succès, cette manière de conditionner la bénédiction à l’effort correspond à la variante contractuelle de l’évangile de la prospérité.
Cette compréhension découle, me semble-t-il, d’une mauvaise compréhension du récit biblique. James Hely Hutchinson défend que :
Ce genre de conception est cohérent s’il n’existe qu’une seule alliance. Mais si l’on estime qu’il faut distinguer nettement l’alliance du Sinaï de l’alliance nouvelle, on n’embrassera pas une théologie de la prospérité / de la guérison automatique en fonction de l’obéissance[1].
Un accent trop grand sur la continuité entre l’Ancien et le Nouveau Testament court le risque de négliger la dimension pédagogique de l’alliance mosaïque dont Josué est l’héritier. Nous observons bien que les plus obéissants ne sont pas épargnés par le malheur et les plus respectueux des commandements de Dieu ne réussissent pas tout ce qu’ils entreprennent. Soit nous ne sommes pas assez obéissants, concédons que peu d’entre nous méditent jour et nuit leur Bible, soit nous nous leurrons en nous identifiant à Josué.
Peut-on alors proposer une autre lecture de Jos 1.1-9 ?
2. Une lecture dramatique : Josué et le narratif biblique
Quel pont, alors, entre Josué et nous ? Il me semble qu’une lecture de ce texte à la lumière du narratif biblique[2] permette de prendre un peu de recul sur cette promesse. Bien sûr, l’obéissance de Josué sera accompagnée d’un certain succès. Sous sa direction, le peuple prend possession d’une bonne partie du pays promis. Mais le conditionnement de la bénédiction à l’obéissance ne lui permet jamais de perdurer dans le temps. Après Josué, le livre des juges est une démonstration flagrante de l’incapacité humaine à obéir fidèlement à Dieu dans la durée. « L’histoire d’Israël est essentiellement une histoire d’infidélités et de désobéissances à la loi divine, ainsi que d’abandon de Dieu de la part de ce peuple, même s’il y a eu quelques périodes plus lumineuses[3]». Tim Keller relève que :
Il existe une tension entre la grâce et la loi, entre la conditionnalité et l’inconditionnalité. Nous trouvons dans les Juges une contradiction apparente. D’une part, Dieu exige l’obéissance parce qu’il est saint. D’autre part, il fait des promesses d’engagement et de loyauté envers son peuple. Sa sainteté et ses commandements conditionnels (fais ceci et ensuite je ferai cela) l’emportent-ils sur ses promesses (je serai toujours avec toi, quoi que tu fasses), ou ses promesses l’emportent-elles sur ses commandements ? En d’autres termes, ses promesses sont-elles conditionnelles ou inconditionnelles ? La question des juges est cruciale, car elle montre qu’aucune des deux réponses à cette question n’est correcte[4].
L’Ancien Testament est une démonstration empirique de l’incapacité humaine à « mériter » la bénédiction de Dieu. Cette démonstration impliquait de la part de Dieu une certaine cohérence : l’obéissance momentanée pouvait donc se retrouver récompensée. Mais c’est déjà la grâce, sous-jacente aux promesses conditionnées, qui a permis à la relation entre Dieu et son peuple de subsister. C’est aussi par grâce que Dieu permet un changement d’Alliance dans laquelle plus aucune promesse n’est conditionnée :
Il y a ainsi abolition de la règle précédente à cause de son impuissance et de son inutilité, puisque la loi n’a rien amené à la perfection. Mais par ailleurs, il y a l’introduction d’une meilleure espérance, par laquelle nous nous approchons de Dieu (Hébreux 7.18-19).
Quand nous oublions ce changement d’Alliance, ou que nous négligeons la discontinuité entre l’Ancienne et la Nouvelle, nous courons le risque de faire à nouveau la démonstration de l’inefficacité de ce système caduque, au lieu de jouir de la progression de la révélation. Ce faisant, « nous réduisons la sainte loi de Dieu à des principes efficaces et pensons qu’en les observant relativement bien, la vie se pliera à nos désirs. Ensuite nous nous sentons fiers si c’est le cas, et abattus dans le cas contraire. Dans les deux cas, nous sommes sous pression. Nous insistons sur la nécessité des bénédictions et acceptons la responsabilité d’agir pour les obtenir[5] ». Nous passons alors à côté du but du texte. Pour les premiers lecteurs, il s’agissait de les faire réaliser leur besoin d’un nouveau système pour entrer en relation avec Dieu et susciter la foi dans le fait que ce changement aurait lieu un jour. Pour nous, il s’agit de réaliser le privilège du changement et la liberté acquise par la Nouvelle Alliance de grâce.
3. Une lecture typologique : Josué et Jésus
La meilleure lecture de Josué 1.1-9 me semble être une lecture typologique. Josué nous permet de découvrir une facette particulière de Christ : celui qui, par son obéissance, nous octroie les bénédictions divines. Bien sûr, Josué l’a fait à une autre échelle : son obéissance a « seulement » permis la conquête de la terre promise, et cette prise de possession n’a pas été définitive.
Nous n’avons pas à nous mettre la pression pour obtenir la bénédiction, nous n’avons pas à méditer jour et nuit les commandements de Dieu pour être sûrs de n’en dévier ni à droite ni à gauche. Christ l’a fait pour nous !
Toutefois, il préfigure bien le Christ comme l’on fait Adam, Noé, Melchisédech, Joseph, David, et d’autres. Son obéissance annonce celle de Jésus. Le repos imparfait dans lequel il fait rentrer l’Israël ethnique de son époque (Jos 1.13, 21.44, etc.) illustre le repos parfait qu’obtient Christ à l’Israël spirituel[6] (Hé 4.8-10). Comme l’obéissance de Josué a profité au peuple de l’Ancienne Alliance, l’obéissance du Christ qui « accomplit la Loi » (Mt 5.17-18) bénéficie au peuple de la Nouvelle[7]. L’auteur de l’épître aux Hébreux s’attarde longuement à démontrer la supériorité des bénédictions obtenues par Christ sur celles obtenues par Josué parce que spirituel dépasse de loin le terrestre. Toutefois, ce qui est terrestre nous permet de saisir un peu mieux en quoi consistent les réalités célestes.
Cette lecture typologique est reposante : nous n’avons pas à nous mettre la pression pour obtenir la bénédiction, nous n’avons pas à méditer jour et nuit les commandements de Dieu pour être sûrs de n’en dévier ni à droite ni à gauche. Christ l’a fait pour nous ! Réjouissons-nous de la solution apportée plutôt que de faire la démonstration, jour après jour, du problème. Notre seul refuge est de saisir l’espérance qui nous est proposée (Hé 6.18) !
Deux sentiers, deux choix, deux façons de vivre [8]
| La voie ancienne de Moïse |
La voie nouvelle de Christ |
|---|---|
| Notre objectif : la vie meilleure des
bénédictions de Dieu |
Notre objectif : l’espérance meilleure
de la proximité de Dieu |
|
|
|
|
|
|
|
LA PRESSION PÈSE |
NOUS POUVONS LÂCHER PRISE |
|
Vous êtes sous la loi de la linéarité |
Vous êtes sous la loi de la liberté |
Conclusion
L’auteur de l’épître aux Hébreux est sans aucun doute l’un des plus brillants théologiens de sa génération. Une bonne partie de son épître se consacre au lien qui existe entre Ancienne et Nouvelle Alliance, entre continuité et discontinuité. Curieusement, au moment de saluer ceux à qui il s’adresse, il reprend quelques éléments de la promesse adressée par Dieu à Josué. En Hébreux 13.5-6, il dit :
Que votre conduite ne soit pas guidée par l’amour de l’argent, contentez vous de ce que vous avez. En effet, Dieu lui-même a dit : Je ne te délaisserai pas et je ne t’abandonnerai pas. C’est donc avec assurance que nous pouvons dire: Le Seigneur est mon secours, je n’aurai peur de rien. Que peut me faire un homme ?
Le seul élément de la promesse qu’il fait subsister, et qu’il transpose à notre époque, c’est la présence de Dieu à nos côtés. Sa finesse théologique doit nous inspirer. Il trie avec soin ce qui perdure et ce qui s’arrête. L’ubiquité du Christ nous encourage, parce qu’il nous a tout acquis, parce que nous avons le repos en lui, parce que nos mérites ne rentrent pas dans l’équation.