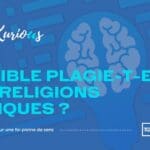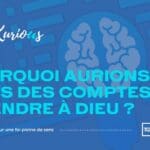Dans notre précédente émission, nous avions vu que l’existence de Jésus est un fait largement admis parmi les historiens. Toutefois, la question de l’identité de ce Jésus historique fait débat.
En effet, bien des spécialistes ont tenté de déterminer qui pouvait bien être ce Jésus historique, en distinguant alors le Jésus de l’histoire et le Christ de la foi. Il y aurait donc, d’une part, un personnage historique, dont l’existence nous est rapportée par plusieurs auteurs non chrétiens de l’Antiquité, et un personnage de foi, c’est-à-dire ce même Jésus historique, mais à qui on aurait ajouté nombre de récits plus ou moins mythique, récits qui nous sont relatés par les auteurs des évangiles du Nouveau Testament.
Cette recherche du Jésus historique s’est déroulée en plusieurs phases, qu’on nomme habituellement des « quêtes » du Jésus historique, et parmi lesquelles l’entreprise la plus connue est celle du « Jesus seminar », fondé par Robert Funk en 1985. Il s’agit du travail conjoint de plus de 70 érudits qui se sont donné pour objectif l’examen intellectuellement rigoureux des traditions évangéliques sur Jésus, afin de démystifier la perception que les évangiles offrent de Jésus. Leur travail repose notamment sur 7 piliers, à savoir que le Jésus historique est à distinguer du Christ de l’Eglise, que le Jésus de l’évangile de Jean est fictif, que les évangiles de Matthieu et de Luc sont largement repris de celui de Marc, qu’ils s’appuient beaucoup sur un document que l’on nomme Q, que Jésus n’a pas annoncé de seconde venue ou de fin des temps, que Jésus doit être considéré dans le cadre d’une culture orale totalement différente de notre culture écrite, et que les évangiles ne sont pas fiables historiquement, jusqu’à preuve du contraire. Parmi les conclusions du Jesus seminar, on trouve l’affirmation que seulement 2% des paroles attribuées à Jésus dans les évangiles seraient authentiques, 82% d’entre elles ne le seraient pas et 16% seraient douteuses. Voilà qui laisse bien peu de données à disposition pour sonder le Jésus de l’histoire.
Que peut-on penser de ces quêtes du Jésus historique, et des conclusions du Jesus seminar ?
La première chose que l’on peut en dire, c’est que ces entreprises reposent sur nombre de postulats gratuits et non étayés. Ainsi, si l’on reprend par exemple les 7 piliers du Jesus Seminar, on s’aperçoit que seuls deux d’entre eux sont fondés académiquement, à savoir que les évangiles de Matthieu et de Luc sont largement repris de celui de Marc et qu’ils s’appuiraient sur un document « Q ». Les piliers restants sont tous fruits des présupposés des spécialistes impliqués dans le Jesus seminar, présupposés que l’on retrouve également dans les autres quêtes du Jésus historique, des présupposés tels que : les évangiles ne sont pas fiables historiquement, Jésus n’a pas tenu de propos eschatologiques, il n’a pas fait de miracles, etc. Plus simplement, ces quêtes reposent sur un fort postulat naturaliste, c’est-à-dire sur l’idée que rien de surnaturel ne peut exister, ne peut avoir lieu ou avoir eu lieu dans le passé. Or, cette position naturaliste n’est pas fondée scientifiquement, elle n’est que le reflet des convictions propres aux spécialistes concernés. Ainsi, ces érudits partent du principe que rien de surnaturel n’existe, et arrivent à la conclusion que Jésus n’a rien fait de surnaturel. Ce qui s’apparente fortement à un raisonnement circulaire, et donc fallacieux, bien loin de leur prétention à la rigueur intellectuelle.
Un autre de leurs présupposés est justement qu’avant eux, tout ce qui a pu être dit ou écrit sur Jésus n’était pas intellectuellement rigoureux. Là encore, c’est un présupposé qui n’a rien de scientifique et qui dépend directement de leur postulat naturaliste. Quand on regarde de plus près le travail des évangélistes, et notamment de Luc, on s’aperçoit qu’ils étaient bien plus rigoureux qu’on ne voudrait bien le croire.
Pour conclure, opérer une nette distinction entre le Jésus de l’histoire et celui des évangiles ne peut se faire sans étudier préalablement la fiabilité des récits évangéliques, ce qui suppose de mettre de côté ses présupposés naturalistes. Les sources chrétiennes sont les plus abondantes et les plus riches d’informations sur la personne de Jésus, et il n’est donc pas intellectuellement rigoureux de les écarter d’un revers de la main sans justifications sérieuses. Avant de justement se pencher sur la fiabilité des récits des évangiles, notons tout de même que les sources non chrétiennes que nous mentionnions dans notre précédente émission corroborent toutes les récits des évangiles. A leur lecture, nous apprenons en effet que Jésus était un homme Juif de Palestine, dont les enseignements étaient suivis par plusieurs disciples, qui était connu pour opérer des prodiges et guérir les malades, qui fut crucifié sous Ponce Pilate, accusé par les Juifs, et qui est à l’origine d’une nouvelle religion, dont les adeptes le tiennent pour Dieu. Les évangiles ne disent rien de moins, ni rien de contradictoire avec ces informations.