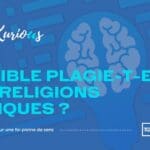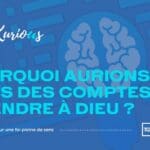Bien des athées affirment ne se fier qu’à la science et exigent donc une preuve scientifique de l’existence de Dieu. Et si la science était aussi une question de foi ?
Transcription
Nous avons vu que bien souvent, certaines personnes se refusent à considérer l’existence de Dieu car elle ne peut être démontrée de manière physico-mathématique. Ces personnes affirment la fiabilité de la science et leur méfiance à l’égard de ce qui relève de la croyance. Elles adoptent en fait la position dite matérialiste, ou scientiste, qui stipule qu’il n’existe rien d’autre que la matière, pas de Dieu ou d’esprit supérieur, simplement ce que la science décrit, l’univers tel qu’on le connaît. Mais cette position présente plusieurs erreurs manifestes.
Tout d’abord, l’affirmation que la vérité scientifique est la seule vérité se contredit elle-même. En effet, elle n’est pas établie par la science, c’est un postulat de fait et il est impossible de l’établir scientifiquement. Il est également impossible d’expliquer scientifiquement que les phénomènes de la nature soient explicables par la science, sans quoi il faudrait alors expliquer pourquoi la science parvient à expliquer que les phénomènes de la nature sont explicables par la science, et ainsi de suite…
De plus, la science ne peut rendre compte de toutes les vérités qui nous sont accessibles. Le fait que le monde existe, que vous et moi existions par exemple, est impossible à prouver. Comment prouver scientifiquement que le réel n’est pas en fait simplement un cerveau soumis à une simulation électro-cérébrale comme dans le film Matrix ? Pourtant l’existence du monde est bel et bien rationnelle et la science le présuppose. Autre exemple, les vérités des principes fondamentaux de la logique ne peuvent pas non plus être prouvées scientifiquement, car là encore la science présuppose ces vérités, elle en a besoin pour fonctionner. On voit donc que tout n’est pas explicable par la science.
On s’aperçoit donc au final que la thèse matérialiste n’est pas seulement scientifique, comme elle voudrait bien le croire, mais qu’elle repose également sur des croyances.
L’athée et le croyant basent tous deux leur raisonnement sur un équilibre de raison et de croyances. La science repose par exemple sur la croyance que nos sens cognitifs ne nous trompent pas, ce qui est impossible à prouver là encore. De même, Wittgenstein affirmait qu’il est impossible de prouver scientifiquement que la terre ne soit pas simplement apparue il y a 100 ans, en portant les marques d’une plus grande ancienneté, ce que pourtant chacun de nous croit fermement. La science présuppose enfin que la réalité est un système fermé de causes naturelles, mais elle ne peut le prouver. C’est une croyance qui est d’ailleurs nécessaire à l’exercice de la science. Pourquoi la réalité ne serait-elle pas l’émanation d’un esprit absolu, comme le croient les hindous ?
Pour conclure, nous voyons donc que la science ne peut pas tout expliquer et qu’elle repose elle-même sur certaines croyances. A partir de là, le débat sur l’existence de Dieu entre croyants et athées est rééquilibré. Il suffit maintenant de comparer ces deux systèmes de croyances pour se faire une idée de laquelle est la thèse la plus probable. Pour ce faire, nous étudierons d’un peu plus près les indices en faveur de l’existence de Dieu, et ceux que les athées avancent en faveur de son inexistence.
Nathanaël Delforge est passionné de théologie et de philosophie, il est également le créateur et l’animateur de Kurious, une chaîne YouTube d’apologétique chrétienne. Professeur de mathématiques dans le secondaire, il poursuit des études de théologie en parallèle. Il est marié et père d’une petite fille.