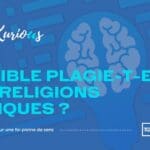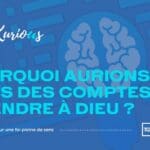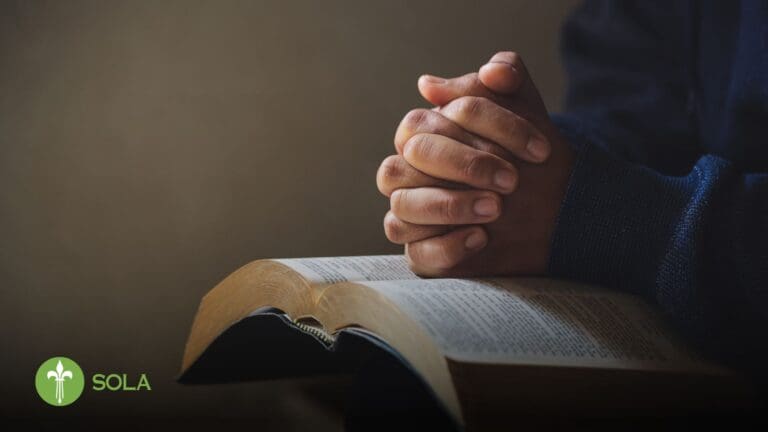Dans cette vidéo, je vous propose de mettre en pratique quelques-uns des principes d’interprétation présentés dans la précédente émission, autour de 5 études de cas de contradictions apparentes du texte biblique.
- Est-ce Dieu ou satan qui a excité David à faire le dénombrement d’Israël ?
- Jésus a-t-il ou non autorisé ses disciples à partir avec un bâton ?
- Jésus a-t-il pris son dernier repas le 14 ou le 15 nisân ?
- Les différents récits de la résurrection sont-ils conciliables ou contradictoires ?
- Est-on justifié par la foi seule (Paul) ou par les oeuvres (Jacques) ?
Transcription
Transcription réalisée de manière automatique, merci de vous référer à l’original avant toute citation.
Le texte biblique est parfois accusé de contenir plusieurs centaines de contradictions.
Nous en avions parlé dans notre précédente émission dans laquelle je proposais quelques principes élémentaires d’interprétation, justement quand on se trouve confronté à deux passages bibliques qui semblent se contredire l’un l’autre.
Et dans cette émission je vous propose justement une mise en application de ces principes, ou en tout cas de certains de ces principes, à partir de cinq contradictions apparentes du texte biblique que vous avez proposé dans les commentaires de la précédente vidéo.
Premier exemple, au moment où David s’apprête à faire le dénombrement d’Israël, nous avons deux passages bibliques qui semblent effectivement se contredire l’un l’autre.
Je cite, 2 Samuel 24, 1 qui dit « La colère de l’Éternel s’enflamma de nouveau contre Israël, et il excita David contre eux en disant, Va, fais le dénombrement d’Israël et de Judas. »
En 1 Chronique 21, verset 1, nous lisons « Satan se leva contre Israël, et il excita David à faire le dénombrement d’Israël. »
Nous avons là dans ces deux passages une même action, le fait d’exciter David à faire le dénombrement d’Israël, qui est imputé une fois à Dieu et une autre fois à Satan.
Dieu et Satan étant particulièrement antagonistes dans cette affaire, il semble bien que nous avons une apparente contradiction entre ces deux passages.
Qui de Dieu ou de Satan a effectivement excité David à faire ce dénombrement ?
Et si la contradiction n’était effectivement qu’apparente et n’allait pas plus loin ?
En effet, il n’y a pas nécessairement contradiction à dire d’une part que c’est Dieu qui a excité David à faire ce dénombrement, et d’autre part que c’est Satan.
Je m’explique, et pour cela je vais prendre un exemple.
Imaginons que je me mette d’accord avec mon petit frère pour qu’il aille dans la chambre de ma petite soeur afin de casser son bureau.
Mon petit frère va donc dans la chambre de ma petite soeur et il casse son bureau.
Ma petite soeur rentre dans sa chambre, elle découvre son bureau cassé, elle apprend que c’est mon petit frère qui l’a cassé, elle apprend que c’est moi qui me suis mis d’accord avec lui et qui d’une certaine façon l’ai envoyé casser son bureau.
Ma petite soeur est donc en colère et elle peut tout à fait dire, quand mon père lui demande par exemple « Mais pourquoi es-tu en colère ? »
« A cause de mon grand frère, en parlant de moi, il m’a mis en colère. »
Et quand ma mère lui demande « Mais pourquoi es-tu en colère ? »
elle pourrait dire cette fois-ci « A cause de mon petit frère », donc notre petit frère commun, « parce qu’il a cassé mon bureau. »
Dans un cas comme dans l’autre, ma soeur ne ment pas et elle dit bien la vérité.
Je l’ai énervé, puisque j’ai fomenté d’une certaine façon le fait de casser son bureau, mon petit frère l’a énervé puisqu’il a fomenté et effectivement cassé son bureau.
Alors l’analogie avec notre situation n’est pas tout à fait parfaite, mais je crois qu’elle illustre bien cette idée que nous pouvons avoir deux acteurs qui effectuent semble-t-il la même action, mais à deux niveaux différents.
De plus, ils peuvent également effectuer une même action, à deux niveaux différents je l’ai dit, mais avec en plus de cela deux motivations différentes.
Il est évident que les motivations de Dieu et de Satan ne peuvent pas être identiques, l’un étant motivé par la justice, la sainteté, l’amour, l’autre uniquement par le mal.
Reprenons l’exemple des deux frères qui fomentent l’action de casser le bureau de leur soeur.
Je pourrais par exemple avoir pensé cette action dans l’unique objectif de rendre complètement inutilisable un bureau qui était devenu depuis un moment déjà défectueux, de sorte à pouvoir faire en sorte que ma soeur accepte que je lui achète un nouveau bureau, tout neuf et de bien meilleure qualité que celui dont elle est actuellement en possession.
Mais motivation aurait ainsi été particulièrement louable.
D’un autre côté, on pourrait tout à fait imaginer que mon petit frère, lui, ait pris plaisir à faire cette action dans le simple but d’énerver ma soeur et dans le simple but de la priver de son bureau.
Ces motivations auraient donc été particulièrement mauvaises.
Pour autant, on pourrait toujours dire que j’ai énervé ma soeur, mon petit frère a énervé ma soeur, à deux niveaux différents, avec des motivations différentes.
Il en est tout à fait de même pour le dénombrement d’Israël par David, où c’est bien Dieu qui a excité David à le faire à un certain niveau, c’est bien Satan qui l’a excité à le faire à un autre niveau, et les deux l’ont fait avec des motivations tout à fait différentes.
Il n’y a donc pas de contradiction dans ce texte, autre qu’une contradiction apparente à une première lecture.
Deuxième exemple de contradiction apparente, lorsque Jésus envoie ses disciples, les textes de Matthieu et de Marc nous rapportent les instructions de Jésus qui paraissent quelque peu divergentes, voire même contradictoires.
En effet, dans Marc 6, 8, Jésus leur prescrit de ne rien prendre pour le voyage, si ce n’est un bâton.
Dans le texte de Matthieu, il est dit que Jésus dit aux disciples « ne prenez ni bâton, ni quoi que ce soit ».
Donc dans un cas, Jésus semble dire « ne prenez rien d’autre qu’un bâton », donc prenez bien un bâton.
Dans l’autre cas, Jésus semble dire « ne prenez rien, pas même un bâton ».
La question est donc « les disciples étaient-ils autorisés, oui ou non, à prendre un bâton avec eux ? »
Et on se trouve effectivement face à deux textes qui semblent se contredirent directement l’un l’autre.
Mais là encore attention au contexte linguistique.
Quels sont les termes qui sont employés ?
N’oublions pas que le texte n’a pas été rédigé en français, mais pour le coup ici, en grec.
Or, le terme grec dans le texte de Marc et dans le texte de Matthieu n’est pas le même.
En effet, dans le texte de Matthieu, il s’agit du grec « ktaomai », qui signifie « acquérir », « se procurer ».
C’est donc l’idée d’acheter un bâton supplémentaire que Jésus interdit à ses disciples.
Il est en train de leur dire « partez sans acheter de bâton supplémentaire ».
Dans le texte de Marc, par contre, le verbe employé est « kairo », c’est-à-dire « prendre ».
Jésus est en train de leur dire « partez, et quand vous partez, prenez votre bâton que vous possédez déjà ».
Dans le texte de Marc, Marc met l’accent sur le fait que Jésus leur dit « partez avec ce que vous possédez déjà ».
Et dans le texte de Matthieu, Matthieu met l’accent sur le fait que Jésus leur dit « n’achetez rien d’autre que ce que vous possédez déjà ».
Mis en parallèle ainsi, en prenant bien en compte le contexte linguistique de ces deux passages, nous voyons qu’il n’y a en fait pas de contradiction.
Dans les deux cas, Jésus a simplement signifié aux disciples qu’ils partent avec ce qu’ils possèdent déjà, sans chercher à acquérir quoi que ce soit de supplémentaire avant de partir.
Troisième contradiction, « de quand » date le dernier repas de Jésus avec ses disciples.
En effet, les évangiles ne sont pas tous d’accord sur cette datation.
Jean le date du 14 nissan, tandis que les évangiles synoptiques, Matthieu, Marc et Luc, le datent eux du 15 nissan.
Il y a donc effectivement une apparente contradiction entre les différents évangiles qui ne datent pas à un même événement, au même moment.
Très honnêtement, nous ne sommes pas en possession de données suffisantes pour pouvoir trancher avec certitude sur les raisons de ces différentes datations.
Pour autant, si l’on tient compte du contexte culturel de l’époque et dans lequel ces textes ont été rédigés, plusieurs propositions d’harmonisation ont été proposées par différents théologiens qui sont tout à fait plausibles.
Et je vais donc citer ces différentes propositions, ou en tout cas la plupart d’entre elles, simplement dans le but de montrer que des harmonisations sont possibles, et donc la contradiction ici ne semble bien n’être qu’apparente.
Première proposition, il se pourrait tout à fait qu’il y ait eu des accords sur le début du mois de nissan par observation astronomique.
Un petit peu comme aujourd’hui, pour dater le début ou la fin du mois de ramadan, les différentes autorités musulmanes ne sont pas toujours tout à fait d’accord sur la date exacte.
Il se pourrait tout à fait qu’il y ait eu un désaccord entre par exemple les saducéens et les pharisiens sur la date du début du mois de nissan, et donc un décalage d’un jour, et les évangiles synoptiques se seraient donc rangés à l’un de ces deux avis, et l’évangile de Jean à un autre de ces deux avis.
Deuxième proposition, il se pourrait tout à fait que la fête de la Pâque soit tombée ce jour-là un jour de sabbat, et que par conséquent les pharisiens aient décidé, au contraire des saducéens, d’avancer d’une journée la fête de Pâque pour ne pas avoir à la célébrer un jour de sabbat.
Troisième proposition, il existait à l’époque différents calendriers en circulation.
La communauté de Qumran par exemple utilisait un calendrier solaire, tandis que la majorité des juifs utilisait un calendrier lunaire.
Là à nouveau, deux calendriers différents, dont les évangiles pourraient faire usage différent, permettraient de dater un même événement à une date légèrement différente.
Quatrième proposition, il pouvait y avoir également différents systèmes horaires en vigueur.
On sait que la majorité des juifs de l’époque, eh bien en fait, dataient chaque jour, non pas du lever du soleil au coucher du soleil, mais plutôt du coucher du soleil la veille au soir, au coucher du soleil le lendemain, donc le jour même au soir.
C’est-à-dire que par exemple, aujourd’hui imaginons que nous soyons mercredi, nous considérons que nous sommes mercredi à partir de minuit 1 jusqu’à 23h59, eh bien les juifs de l’époque en majorité considéraient que nous sommes mercredi à partir de mardi soir au moment où le soleil se couche, et que donc nous devenons jeudi à partir du moment où mercredi soir le soleil se couche.
Donc là aussi, il pourrait y avoir simplement différents systèmes de datés les jours, et donc les évangiles qui ne se réfèreraient pas exactement au même système, et donc qui expliquerait ce décalage d’une journée.
Dernière proposition, le nombre important de sacrifices à effectuer ce jour-là expliquerait qu’exceptionnellement, les galiléens aient été autorisés à célébrer la Pâque un jour plus tôt que les judéens, ce qui expliquerait là encore le décalage d’une journée dans le calendrier en fonction des évangiles.
Donc à nouveau, nous ne sommes pas en mesure de trancher avec certitude, et d’ailleurs aucune de ces solutions ne fait l’unanimité parmi les exégètes et les commentateurs, mais simplement l’objectif c’était de montrer qu’il y a plusieurs explications possibles qui tiennent compte du contexte culturel de l’époque.
Il ne s’agit pas d’expliquer quelque chose avec des éléments un petit peu farfelus sortis de nulle part, c’est vraiment en prenant en compte le contexte culturel de l’époque qu’on se rend compte qu’il y a tout à fait possibilité d’harmoniser les données des évangiles synoptiques et de l’évangile de Jean, et donc on ne peut pas conclure non plus avec certitude qu’il y ait une contradiction flagrante sur la datation du dernier repas de Jésus.
Quatrième exemple, les récits des évangiles de la résurrection de Jésus ne sont pas tout à fait similaires, ils ne sont pas tout à fait identiques, ils ne rapportent pas forcément les événements dans le même ordre ou avec les mêmes détails.
À titre d’exemple, les femmes présentes ne sont jamais les mêmes selon les évangiles.
L’évangile de Matthieu parle de deux maris, l’évangile de Marc parle de deux maris et de Salomé, l’évangile de Jean parle de Marie de Magdala uniquement et l’évangile de Luc parle des femmes.
Ici, il ne faut pas oublier, comme je le disais dans la vidéo précédente, que le vrai n’est pas l’exhaustif.
Ce n’est pas parce que je ne dis pas tout ce qui doit être dit que ce que je dis n’est pas vrai.
Et là aussi, plusieurs harmonisations ont été proposées et montrent qu’il n’y a pas de contradictions flagrantes nécessaires entre ces différents récits, mais qu’il est tout à fait possible de les concilier les uns avec les autres sans jamais forcer le texte et sans jamais arriver à des solutions complètement farfelues.
Je vais simplement proposer un exemple en me concentrant sur le thème des femmes présentes au moment de la résurrection pour montrer qu’une harmonisation est tout à fait envisageable de ces données qui paraissent divergentes à première lecture.
On pourrait ainsi tout à fait imaginer que Marie de Magdala se rende au tombeau par un autre chemin que les autres femmes, en étant partie peut-être plus tôt parce que le chemin était plus long, et donc ce qui expliquerait que Marie de Magdala emprunte ce chemin alors qu’il fait encore obscur, et qu’au moment où elle rejoint les femmes, les femmes se rendent au tombeau au moment où le soleil est déjà levé.
On pourrait tout à fait imaginer qu’à ce moment-là, alors que le tombeau est ouvert, Marie de Magdala ne rentre pas dans le tombeau, mais va tout de suite chercher Pierre et Jean pour leur annoncer la nouvelle tandis que les autres femmes rentrent bien dans le tombeau et bénéficient du coup de l’apparition des anges.
Alors que Marie revient au tombeau après avoir annoncé la nouvelle à Pierre et Jean, on pourrait imaginer que les autres femmes sont déjà parties avec crainte et avec joie, comme nous le dit le texte, et qu’à ce moment-là, Jésus apparaît uniquement à Marie de Magdala.
C’est enfin dans un dernier temps que toutes les femmes ensemble vont annoncer la nouvelle, cette fois-ci aux onze, et non seulement à Pierre et à Jean.
De cette façon, nous voyons que nous respectons les données des différents évangiles sans jamais forcer le texte, en incluant tous les éléments, et dans une histoire qui est pleinement harmonisée, et qui lève absolument toute contradiction entre les différentes divergences apparentes qui se laissaient voir à première lecture.
Au sujet de ce récit de la résurrection, Henri Blocher, dans un article, en parle en disant quelque chose que je trouve assez intéressant.
Il exprime simplement l’idée que c’est tout à fait pertinent que les différents récits des évangiles ne concordent pas tout à fait sur l’ordre, les événements et les détails de la résurrection de Jésus, puisque cela vient simplement illustrer l’obscurité, le brouhaha, le tumulte qui devait se vivre parmi les acteurs de cet événement, parmi les disciples, parmi les femmes, qui, mettons-nous à leur place, devaient être complètement chamboulées, complètement bouleversées au moment où elles se sont rendues compte que le tombeau est ouvert, Jésus n’est plus dans le tombeau, des anges apparaissent.
Le fait que les évangiles ne soient pas tout à fait harmonisés là-dessus, non seulement nous prévient aussi d’imaginer une rédaction a posteriori dans laquelle les évangélistes se seraient mis d’accord en fomentant un faux récit, justement le fait que les quatre témoins de cet événement-là, en tout cas les témoins scripturaires de cet événement-là, ne s’accordent pas parfaitement sur tous les détails.
Cela vient, je crois, ajouter crédit à leur authenticité.
Mais en plus, cela nous permet de nous plonger dans cette ambiance d’une journée bouleversante.
Cinquièmement, et dernière contradiction apparente pour cette émission, il s’agit de l’affirmation de Paul, dans l’Épîtreau romain, selon laquelle nous sommes sauvés par la foi uniquement et donc non pas par les œuvres, que l’on met en balance et qui semble contredire l’affirmation de Jacques, au chapitre 2, au verset 24, où Jacques dit que nous sommes sauvés par les œuvres et non pas par la foi seulement.
Donc l’un dit que nous sommes sauvés par la foi et non les œuvres, l’autre dit que nous sommes sauvés par les œuvres et non la foi.
Et donc effectivement, nous semblons là nous trouver face à une contradiction apparente, flagrante, entre Paul, d’une part, et Jacques, d’autre part.
Mais là encore, le contexte.
Le contexte est essentiel.
D’une part, le contexte linguistique, et d’autre part, le contexte tout court d’écriture, dans lequel Paul et Jacques s’expriment.
D’une part, le contexte linguistique.
Il a été proposé, en fait, simplement que, même si les mots employés sont les mêmes, le sens que recouvrent ces mots peut tout à fait ne pas être tout à fait identique.
Le terme « justifier », par exemple, peut tout à fait être employé dans le cas de l’épître romain par Paul, dans l’idée d’être justifié devant Dieu, et donc finalement d’être sauvé, tandis que Jacques peut l’employer dans le sens d’être justifié devant les hommes, c’est-à-dire d’être trouvé juste devant les hommes.
Et dans ce cas-là, Paul est en train de dire que pour être sauvé, pour que Dieu nous considère comme étant juste, eh bien ce n’est pas par nos œuvres, puisque nous ne pourrons jamais mériter la justice de Dieu, mais c’est par la foi en l’œuvre de Jésus à la croix à notre place.
Tandis que Jacques serait en train de dire que pour que les hommes nous considèrent comme juste, il ne suffit pas que nous ayons une foi qui ne se manifeste jamais par des œuvres, mais il faut bien que des œuvres accompagnent cette foi, et ce sont ces œuvres-là, le fruit de notre foi finalement, qui va permettre aux hommes de nous considérer comme justes.
D’autre part, le terme foi peut là aussi recouvrir des sens différents.
De quelle foi parle-t-on ?
Parle-t-on d’une foi chrétienne dans l’œuvre de Jésus à la croix et dans tout ce qui en découle, ou parle-t-on d’une foi plutôt juive ?
Parle-t-on également des œuvres dans un sens chrétien ou des œuvres dans un sens juif ?
C’est-à-dire, parle-t-on d’œuvres qui découlent de la foi, ce que fait Jacques, ou parle-t-on d’œuvres qui permettraient d’acquérir quelque chose, un certain mérite, une certaine place auprès de Dieu, comme dans le cas de Paul ?
Finalement, quand nous lisons ces deux passages dans leur contexte, on se rend compte qu’il n’y a aucune contradiction et que les deux disent finalement la même chose.
Paul s’adresse à des chrétiens de Rome, dans le cadre d’une communauté qui est multi-ethnique, et le propos de Paul est simplement de dire « mais comment être sauvé ? »
Eh bien, pour être sauvé, il faut avoir la foi, et cette foi-là qui sauve, ce n’est pas une foi qui s’attache à des œuvres, c’est une foi qui place toute sa confiance dans l’œuvre unique de Jésus à la croix par laquelle nous sommes sauvés.
Et ce n’est donc pas par nos mérites, c’est donc la foi seule qui nous sauve, et non pas les œuvres.
Jacques, à l’inverse, lui, écrit pour répondre à une question un petit peu différente, qui n’est pas « comment être sauvé ? »
Ça, Paul y a déjà répondu, c’est par la foi.
Jacques écrit plutôt « mais quelle est cette foi qui sauve ? »
Et cette foi qui sauve, ce n’est pas une foi qui se déclare simplement comme « j’ai la foi et donc je suis sauvé », mais c’est une foi qui est vivante et qui se manifeste, qui transparaît dans les œuvres qu’elle produit.
Les œuvres donc, quand Jacques dit que nous sommes justifiés par les œuvres, c’est encore une fois, devant les hommes, les œuvres rendent témoignage du fait que nous possédons bien la foi qui seule nous sauve au regard de Dieu.
Donc, Paul et Jacques ne l’expriment pas de la même façon, et finalement, parce qu’ils ne sont pas dans le même contexte, mais expriment bien la même vérité, nous sommes sauvés par la foi seulement, mais cette foi-là se manifeste par des œuvres qui viennent témoigner de notre foi qui nous permet d’être sauvés.
Voilà, c’est tout pour cette deuxième partie d’émission sur les contradictions dans la Bible.
Nous continuerons notre discussion des contradictions apparentes dans la Bible dans une troisième émission, où j’aimerais prochainement discuter de la différence entre la contradiction et le mystère ou le paradoxe, qui eux sont bien présents dans la Bible, et je crois à juste raison.
C’était Curious, j’espère que cette émission vous a plu.
N’hésitez pas à partager, à liker, à commenter, et on se retrouve dans deux semaines pour une prochaine émission.
Nathanaël Delforge est passionné de théologie et de philosophie, il est également le créateur et l’animateur de Kurious, une chaîne YouTube d’apologétique chrétienne. Professeur de mathématiques dans le secondaire, il poursuit des études de théologie en parallèle. Il est marié et père d’une petite fille.