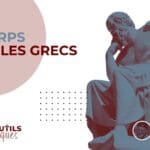La Grèce à la source
La culture européenne a un triple enracinement :
- dans la Grèce antique
- dans la culture romaine
- dans la tradition chrétienne
On relie parfois ce triple enracinement dans les trois villes qui les symbolisent, à savoir ; Athènes, Rome, et Jérusalem.
S’il existe des liens évidents entre Athènes et Rome, par contre, la Bible, elle, ne rien doit rien de la Grèce, et les deux entre même le plus souvent en opposition.
Dans cet ensemble de quatre séquences, nous examinerons chaque fois un outil, provenant de la source grecque, et qui éclaire la culture européenne moderne.
Il s’agit des outils suivants :
- L’affirmation de Nietzsche : « Ma philosophie, la platonisme inversé. » Quelles sont les répercussions de cet aphorisme ?
- Les concepts « Eros et Thanatos » dans la pensée de Freud. Ils sont extraits de l’essai Malaise dans la culture, titre révélateur.
- Pourquoi les dieux grecs Apollon et Dionysos éclairent-ils la modernité, en passant par la philosophie de Nietzsche, qui crée, à partir d’eux, les notions d’« ordre apollinien » et « ordre dionysiaque » ?
- De la « tekhné » grecque au « dispositif » de la technique moderne, selon Heidegger ; que s’est-il passé ?
1 – La tekhné chez les Grecs, d’après Heidegger :
Heidegger est sensible au fait que « les Grecs appelaient du même nom, tekhnitès, l’artisan ainsi que l’artiste » (1) Depuis, on a nettement distingué les deux. L’artisan produit, par son travail, une réalisation concrète et utile, quel que soit son domaine d’activité. L’artiste, lui, crée une œuvre n’ayant pas de fonction, de vocation à être utile, mais celle de montrer, de faire apparaître. Si les Grecs ne différenciaient pas les deux, cela implique qu’ils mettaient sur le même plan production et création. Comment comprendre cela ? Qu’est-ce qui a bougé depuis les Grecs ?
Heidegger précise : « Tekhné ne désigne jamais un genre de réalisation pratique. » (1) L’affirmation bouscule effectivement notre mode de pensée traditionnel. « La tekhné (…) fait venir l’être à découvert (…) c’est-à-dire dans sa vérité. Cette activité est complètement déterminée et régie par l’essence de la création. » (1) Donc : l’artisan ou l’artiste, ainsi présentés, sont engagés tous deux dans un acte de création, qui engage la pensée, et qui révèle l’être. Que veut dire par là Heidegger ? Passons par un exemple.
Pour Heidegger, la chose ( produite par l’artisan ) n’est pas seulement une chose. Il prend l’exemple de la cruche. Elle n’est pas uniquement de la terre mise en forme par un potier. Mais, elle « déploie son être dans le versement de ce qu’on offre. » (2) L’utilité d’une chose ne dit donc pas tout de ce qu’elle est. « Dans l’eau versée, la source s’attarde. Dans la source, les roches demeurent présentes et, en celles-ci, le lourd sommeil de la terre, qui reçoit du ciel la pluie et la rosée. Les noces du ciel et de la terre sont présentes dans l’eau de la source » (2) versée par la cruche.
Conclusion : « La chose déploie son être en rassemblant. » (2) Quoi ? Le tout de l’être : ce que Heidegger, dans l’étape ultime de sa philosophie, nomme : « le quadriparti », à savoir : la terre, le ciel, ceux qu’il nomme « les divins » et les mortels. C’est à ce titre que l’artisan et l’artiste se rejoignent : par le fait que la chose créée, par l’un et par l’autre, opère un dévoilement de l’être, dans sa présence ( ce qui est particulièrement la fonction de l’art, dans la perspective de ce philosophe ). Mais cette vision s’est perdue peu à peu.
2 – Le « dispositif » de la technique tel que le conçoit Heidegger :
Que la technique n’ait cessé d’étendre son pouvoir sur la face du monde est une évidence. La technique moderne est une manifestation éclatante de la volonté de puissance de l’être humain. Ce développement continu est extrêmement inquiétant, dans la mesure où il remet l’homme en question, à la fois son avenir et son devenir. Jusqu’où cela ira-t-il ?
Selon Heidegger, il s’est produit un dévoiement de la technique. Elle a été asservie à des critères d’objectivité mathématique, depuis le travail de savants comme Copernic, Galilée, ou Newton. La réalité n’est plus perçue de la même manière. Le réel est compartimenté. Tout doit être mesuré. « Les choses présentes, par exemple : la nature, l’homme, l’histoire, le langage se mettent en évidence séparément, en tant que réelles dans leur « objectivité ». » (1)
Ainsi, l’homme moderne se trouve pris dans un « dispositif », qui révèle l’essence de la technique : l’oubli de l’être. Plus rien ne se révèle au travers des choses, prises dans ce « dispositif » technique. Le monde est objectivé. Toutes les choses se voient réduites à leur fonction utilitaire. C’est l’un des aspects du drame vécu par l’homme moderne. La technique « tient l’homme en son pouvoir, il n’en est nullement le maître. » (1)
3 – Perspective biblique :
La pensée heideggerienne n’est pas une pensée chrétienne, ce qui n’empêche pas, pour autant, d’établir des liens entre les deux. J’en soulignerai trois, en ce qui concerne son rapport à la technique.
1° – Le fait de voir, dans le développement de la technique, une preuve de l’extension de la volonté de puissance de l’homme me semble conforme à la Bible, qui révèle que, dès l’origine, l’homme a voulu prendre son autonomie par rapport au Créateur ( par la désobéissance ) et rivaliser avec Dieu.
2° – La mathématisation du monde réel est un rapport faussé à la réalité. La technique, selon Heidegger, implique un oubli de l’être. Heidegger souhaite que l’on remonte de la chose à la totalité de l’être, dont elle révèle la présence. Ce mouvement de « remontée vers » est bibliquement juste, si l’on remplace l’être par Dieu, le Créateur. Remonter de la créature au Créateur. Mais aussi, de ce que l’homme est capable de créer à Celui qui lui donne la capacité de créer.
3° – Heidegger évoque la dépossession de l’homme par la technique. Il se voit dépossédé du monde. Non pas que le monde lui appartienne. Mais, dans la perspective biblique, Dieu a voulu que l’homme entre avec le monde réel dans un rapport de bienveillance ( et non de domination ), bien rendu sensible par cette parole du Christ : « Observez comment croissent les lis des champs : ils ne travaillent ni ne filent. Cependant, je vous dis que Salomon même, dans toute sa gloire, n’a pas été vêtu comme l’un d’eux. Si Dieu revêt ainsi l’herbe des champs (…) ne vous vêtira-t-il pas à plus forte raison, gens de peu de foi ? » Observation du monde. Remontée au Créateur, le Donateur de toutes choses. Mise en parallèle de la Création divine avec la création artisanale. Reconnaissance et confiance. Il est bien question, ici, d’un mode de rapport au monde qui soit libérateur.
Pour aller plus loin
Articles Wikipédia
Vidéo :
(1) – Martin Heidegger Essais et conférences. Essai : « La question de la technique » (1953)
(2) – Martin Heidegger Essais et conférences. Essai : « La Chose » (1953)