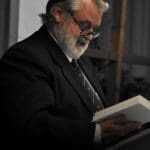Note de l’éditeur : Cet article a été initialement présenté lors de la Conférence sur la Tradition du Regent College en mai 2006, avec Gordon Fee et Paul Stevens. Cette conférence porte sur une spiritualité «simple et concrète», ancrée dans le quotidien. Notre but est de démystifier ce mot encore trop souvent entouré de malentendus — comme s’il ne concernait que des personnes d’exception, les «vraiment spirituels», ou encore des exercices et disciplines particulières. Or, aucune de ces idées n’est fondée bibliquement. Ce que nous voulons montrer ici, c’est à quel point la spiritualité biblique est en réalité accessible, incarnée, enracinée dans la vie de tous les jours.
L’un des défis que nous tentons de relever aujourd’hui touche d’ailleurs un domaine auquel nous croyons tous deux : les «disciplines spirituelles» — la prière, l’étude et la mise en pratique des Écritures, la méditation, la contemplation. Ce sont effectivement des activités guidées par l’Esprit, bénéfiques pour nourrir le type de spiritualité que nous défendons ici. Ce qui me préoccupe, toutefois, c’est que le mot «spiritualité» soit devenu synonyme de ces disciplines, comme si ceux qui ne les pratiquent pas fidèlement ne pouvaient pas être considérés comme spirituels.
La première chose que je souhaite faire, c’est démystifier ce mot, car «spirituel» peut désigner au moins huit choses différentes, et c’est probablement l’un des termes les plus vagues du vocabulaire chrétien contemporain. C’est même devenu un des mots à la mode dans le langage postmoderne, où la spiritualité renvoie surtout à une forme de réconciliation avec son moi intérieur — et à toutes sortes d’inepties qui n’ont absolument rien à voir avec le sens que ce mot revêt dans le Nouveau Testament. Mis à part deux occurrences dans 1 Pierre 2, le terme est propre à l’apôtre Paul dans le Nouveau Testament, et il fait toujours référence au Saint-Esprit, sans exception. Ainsi, lorsque Paul écrit dans Colossiens 1.9 qu’il demande à Dieu «…que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté, en toutes sagesse et intelligence spirituelles,…» (S21, c’est moi qui souligne), la version BDS a eu raison de rendre cela ainsi : «Nous lui demandons qu’il vous fasse connaître pleinement sa volonté, en vous donnant, par le Saint-Esprit, une entière sagesse et un parfait discernement.» Ce choix est justifié, car Paul s’appuie ici clairement sur le langage d’Ésaïe 11.2: «L’Esprit de l’Éternel reposera sur lui, [le Messie] et cet Esprit lui donnera le discernement, la sagesse…» Et lorsque Paul parle, dans 1 Corinthiens 15, que nous recevrons un «corps spirituel», un oxymore s’il en est, il entend par là un corps adapté à la vie finale dans l’esprit.
Je voudrais commencer par souligner que, dans le Nouveau Testament — chez Paul et Pierre en particulier — le mot «spirituel» n’est pas un terme vague lié à une idée générale de spiritualité. Il s’agit plutôt d’un adjectif précis, qui désigne la présence et l’action de l’Esprit de Dieu. C’est dans ce sens-là que je souhaite aborder le mot «spirituel» dans cette intervention. Et pour aller directement à l’essentiel, je voudrais attirer votre attention sur une expression que l’on remarque rarement dans les lettres de Paul. Dans Galates 3.14 et Éphésiens 1.13, il parle de l’Esprit comme étant «le Saint-Esprit de la promesse» — c’est-à-dire l’Esprit Saint que Dieu avait promis de donner à son peuple. Ce qui est particulièrement important ici, c’est que la compréhension que Paul a de cette expression va bien au-delà de ce que la plupart des gens connaissent à travers le discours de Pierre dans Actes 2, où il affirme que, le jour de la Pentecôte, la promesse de Dieu s’est accomplie par la venue de l’Esprit sur tout son peuple.
Il est vrai que la venue de l’Esprit promis comprenait le renouvellement de la parole prophétique annoncée dans Joël 2. Mais pour Paul, cela ne représente qu’un aspect d’une réalité bien plus vaste. Pour lui, l’expérience de l’Esprit signifiait surtout que Dieu avait inauguré la nouvelle alliance anticipée dès Deutéronome 30.6, où il est question de la «circoncision du cœur». Cette promesse devient ensuite explicite dans la grande prophétie de la nouvelle alliance que l’on trouve dans Jérémie 31.31-34. Peu de temps après, Ézéchiel reprend cette même promesse dans les chapitres 36 et 37, en la liant expressément à l’Esprit que Dieu allait «mettre en vous». Puisqu’Ézéchiel prophétisait à un peuple captif à Babylone qui avait connu la chute de Jérusalem et la destruction du temple, par-dessus tout, en tant qu’accomplissement de la nouvelle alliance, l’Esprit promis marquait le retour de quelque chose que tout Israël désirait ardemment: la présence perdue de Dieu.
Le thème de la Présence de Dieu est fondamental, tant dans l’Ancien que dans le Nouveau Testament. Il encadre même l’ensemble du récit biblique, formant ses deux pôles. Tout commence dans Genèse 2 et 3, où le Créateur du ciel et de la terre est présent dans le jardin, aux côtés des êtres humains qu’il a façonnés à son image. Et tout s’achève dans Apocalypse 21.1 à 22.5, avec les images magnifiques des nouveaux cieux, de la nouvelle terre et d’un nouvel Éden. Jean y affirme clairement: «Je ne vis pas de temple dans la ville, car le Seigneur, le Dieu tout-puissant, est son temple, ainsi que l’Agneau.» (Apocalypse 21.22). Quoi qu’il en soit, le peuple d’Israël se considérait lui-même comme «le peuple de la Présence» — le peuple au milieu duquel le Dieu éternel avait choisi de demeurer sur la terre.
La présence de Dieu dans l’Ancien Testament est ressentie de la manière la plus éclatante à travers le tabernacle et le temple. De ce fait, le thème de la Présence, qui atteint son apogée lorsque la gloire de Dieu descend sur le tabernacle, constitue la clé de voûte de la structure du livre de l’Exode. Dans l’épisode du buisson ardent (Exode 3), le Dieu vivant se révèle pour la première fois à Moïse comme étant présent, au Sinaï, le lieu même où Dieu ordonnera plus tard à Moïse de ramener le peuple pour qu’il l’adore. Quand Israël arrive à la montagne sainte au chapitre 19, il se rend donc à l’endroit où Dieu «demeure», un lieu qu’il leur est interdit de toucher, sous peine de mort. Seul Moïse est autorisé à entrer dans la présence de Dieu.
Dieu a l’intention de «quitter» la montagne pour venir habiter au milieu de son peuple, par l’intermédiaire d’un «tabernacle». Ainsi, après avoir donné le Livre de l’Alliance (chapitres 20 à 24), Dieu transmet à Moïse les instructions pour la construction du tabernacle (chapitres 25 à 31). Mais entre les instructions et la construction (35-39), l’épisode désastreux dans le désert se produit (32), suivi de l’annonce de Dieu à Moïse: «Ma Présence ne vous accompagnera pas»; un ange ira à sa place (33, c’est moi qui souligne). Moïse comprend que cette solution n’est pas suffisante. Il plaide alors avec ferveur: «Si tu ne marches pas toi-même avec nous, ne nous fais pas partir d’ici. Comment sera-t-il donc certain que j’ai trouvé grâce à tes yeux, ainsi que ton peuple? Ne sera-ce pas quand tu marcheras avec nous et quand nous serons différents, moi et ton peuple, de tous les peuples qui sont à la surface de la terre?» (33:15-16, c’est moi qui souligne).
Le thème de la Présence de Dieu est crucial pour l’Ancien comme pour le Nouveau Testament, servant en fait de «cadre» à la Bible.
Ce moment est suivi par une révélation plus profonde du caractère de Dieu — «plein de compassion et de grâce, lent à se mettre en colère, et riche en amour et en fidélité!» (Exode 34.4-7) — puis par la construction du tabernacle. Tout cela culmine avec la descente de la gloire de Dieu qui «remplit le tabernacle» (Exode 40.35). Dès lors, le peuple est prêt à se mettre en route vers le lieu que «le Seigneur, votre Dieu, choisira pour y faire résider son nom» (Deutéronome 12.11), guidé par la Présence de Dieu représentée par la colonne de nuée et de feu.
La promesse formulée dans le Deutéronome s’est finalement réalisée avec la construction du temple de Salomon, lorsque la même gloire divine qu’en Exode 40 est descendue et a «rempli le temple» (1 Rois 8.11). C’est pourquoi Jérusalem et le temple sont souvent décrits comme «le lieu que Yahvé a choisi pour y faire résider son nom». Le temple, en tant que lieu de la présence de Dieu, est ainsi devenu le centre de la vie d’Israël dans le pays promis.
Plus encore que la loi, ou d’autres «marqueurs d’identité» tels que la circoncision, les lois alimentaires et l’observance du sabbat, c’est la présence de Dieu avec Israël qui les distinguait comme son peuple. Et même s’ils comprenaient bien que le Dieu qui créa les cieux et la terre ne pouvait être contenu par une structure terrestre, néanmoins, parce que Dieu choisit d’y faire résider sa présence, le tabernacle puis le temple devinrent les symboles premiers de la présence de Dieu parmi son peuple.
Ainsi, bien que le temple ait aussi été un lieu de sacrifices, le peuple de Dieu dans l’Ancien Testament le voyait surtout comme un lieu de prière, un lieu où l’on pouvait expérimenter la présence de Dieu. Cette compréhension revient encore et encore dans le livre de louanges d’Israël, le Psautier. Prenons, par exemple, le grand hymne d’intronisation du Psaume 68, qui célèbre la présence de Dieu établie sur le trône de Sion — source d’espérance pour son peuple et objet d’envie pour les nations environnantes. C’est ainsi que le psalmiste s’exclame aux versets 16 et 17:
16Montagne de Dieu, montagne du Basan,
montagne aux nombreuses cimes, montagne du Basan,
17 pourquoi, montagnes aux nombreuses cimes, êtes-vous jalouses
de la montagne que Dieu a choisie pour résidence?
Cependant, l’Éternel en fera sa demeure à perpétuité.
Le Psalmiste poursuit :
18 Les chars de Dieu se comptent par dizaines de milliers,
par milliers de milliers;
le Seigneur est au milieu d’eux sur le Sinaï, dans le sanctuaire.
19 Tu es monté sur les hauteurs, tu as emmené des prisonniers,
tu as pris des dons parmi les hommes;
les rebelles aussi habiteront près de l’Éternel Dieu.
Ce même thème revient constamment dans les prières individuelles que l’on trouve tout au long des Psaumes, alors que les croyants méditent sur la beauté d’être dans la présence de Dieu — comme dans le Psaume 84.2-3:
2Combien tes résidences sont aimées,
Éternel, maître de l’univers!
3Mon âme soupire et même languit après les parvis de l’Éternel.
Tout mon être pousse des cris de joie vers le Dieu vivant.
Ou le Psaume 63.2
C’est pourquoi je t’ai contemplé dans le sanctuaire
pour voir ta force et ta gloire
Plus encore que la loi ou d’autres «marqueurs identitaires» tels que la circoncision, les lois alimentaires et l’observance du sabbat, c’était la présence de Dieu auprès d’Israël qui distinguait ce peuple comme étant le sien.
Mais l’infidélité d’Israël lui a fait perdre la présence de Dieu. C’est ce qui rend la chute de Jérusalem et l’exil si profondément bouleversants pour le peuple. Le temple de Jérusalem — ce lieu que Dieu avait choisi pour y faire résider sa présence — a été détruit. Le peuple a été emmené en captivité, et même ceux qui sont restés ne formaient plus un peuple distingué par la présence du Dieu vivant au milieu d’eux. Toute la douleur de cette tragédie atteint son expression la plus poignante dans Ézéchiel 10, où — comme cela s’était déjà produit avec l’arche de l’alliance dans 1 Samuel 4 — la «gloire du Seigneur» quitte le temple de Jérusalem.
Mais tout n’était pas perdu. Au cœur même de l’espérance prophétique se trouvait la promesse du retour de la présence de Dieu. Par la voix d’Ézéchiel, Dieu déclare: «Ma demeure sera parmi eux; je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple» (Ézéchiel 37.27). Et Malachie annonce: «Alors, soudain, le Seigneur que vous cherchez entrera dans son temple» (Malachie 3.1). Cette espérance ne s’est pas éteinte. Elle s’est prolongée dans le judaïsme de la période intertestamentaire, notamment chez les auteurs apocalyptiques. On la retrouve, par exemple, dans le Testament de Daniel 5.13: «Et Jérusalem ne connaîtra plus la désolation… car le Seigneur sera au milieu d’elle.»
Dans la continuité de l’histoire d’Israël, le thème du retour de la présence de Dieu est directement lié à l’espérance d’un temple restauré. Cette idée trouve son expression la plus saisissante, sur le plan symbolique, dans la grande vision d’Ézéchiel (chapitres 40 à 48), mais son moment le plus marquant se trouve dans l’oracle d’Ésaïe 2.2-3, où l’un des motifs centraux est aussi l’inclusion des nations (les païens):
2 Il arrivera, dans l’avenir,
que la montagne de la maison de l’Éternel
sera fondée au sommet des montagnes.
Elle s’élèvera au-dessus des collines
et toutes les nations y afflueront.
3 Des peuples s’y rendront en foule et diront:
«Venez, montons à la montagne de l’Éternel,
à la maison du Dieu de Jacob!
Il nous enseignera ses voies
et nous marcherons dans ses sentiers.
Cependant, le second temple ne répond pas à toutes ces attentes. Il suscite donc des sentiments partagés parmi le peuple. À la lumière du temple de Salomon et du temple futur promis dans la vision d’Ézéchiel, Aggée se lamente: «Reste-t-il, parmi vous, quelqu’un qui ait connu ce temple dans son ancienne gloire? Et à présent, comment le voyez-vous? N’est-il pas comme rien aujourd’hui à vos yeux? » (Aggée 2.3). Dans bien des milieux, l’espérance d’un temple reconstruit, majestueux, demeurait donc vivante au sein du peuple de Dieu.
Pour Paul, l’enjeu fondamental lié à ce motif réside dans le fait que, dans Ésaïe 63.9-14, la présence divine évoquée dans le récit de l’Exode est expressément identifiée comme étant «l’Esprit Saint du Seigneur». En rappelant le passé d’Israël, le prophète déclare :
9Dans toutes leurs détresses,
il a été lui-même dans la détresse,
et l’ange qui se tient en sa présence les a sauvés.
Dans son amour et dans sa compassion,
il les a libérés,
il les a soutenus et il les a portés
tous les jours d’autrefois.
10 Mais eux, ils se sont rebellés
et ils ont attristé son Esprit Saint.
Dès lors, il s’est changé pour eux en ennemi,
et les a combattus.
Alors le prophète demande, rappelant les jours d’autrefois :
11…Où est celui qui les a fait sortir
de la mer avec le berger de son troupeau?
Et où est celui qui a mis son Esprit Saint au milieu d’eux,
12 celui qui a tendu son bras glorieux
aux côtés de Moïse,
pour fendre les eaux devant eux
et qui s’est fait ainsi un renom éternel?
Et à la fin, il chante leur entrée dans la Terre Promise (vv. 13-14):
13Oui, il les a fait avancer à travers les abîmes
comme un cheval dans le désert
sans qu’ils trébuchent.
14 Ils ressemblaient à un troupeau qui rejoint la vallée,
lorsque l’Esprit de l’Éternel les a menés vers le repos ;
ainsi tu as conduit ton peuple
et tu t’es fait une glorieuse renommée.
Cette association du motif de la Présence et l’Esprit de Dieu est bien connue de Paul, comme en témoigne clairement l’écho intentionnel qu’il fait du langage du verset 10 dans Éphésiens 4.30: «N’attristez pas le Saint-Esprit de Dieu car, par cet Esprit, Dieu vous a marqués de son sceau comme sa propriété pour le jour de la délivrance finale.»
Ainsi, lorsque nous passons de ces antécédents de l’Ancien Testament à l’apôtre Paul, il est évident qu’il comprend la venue de l’Esprit comme l’accomplissement de trois attentes étroitement liées:
(1) l’association de l’Esprit à la nouvelle alliance;
(2) le langage de l’«habitation» (ou de la présence intérieure);
(3) l’association de l’Esprit à l’imagerie du temple.
En accomplissant à la fois les motifs de la nouvelle alliance et du temple renouvelé, l’Esprit devient la manière dont Dieu est désormais présent sur la terre: en habitant au sein de son peuple.
Pour Paul, l’Esprit est la manière dont Dieu lui-même «habite» actuellement dans son «saint temple». De manière significative, une telle «habitation» a lieu à la fois dans la communauté rassemblée, comme on pourrait s’y attendre compte tenu de l’arrière-plan vétérotestamentaire de cet usage, mais aussi dans le «cœur» du croyant individuel.
L’imagerie du temple revêt ici une importance particulière, puisque le temple a toujours été compris comme le lieu de la «demeure» de Dieu. Pour Paul, l’Esprit est le moyen par lequel Dieu lui-même «habite» actuellement dans son «saint temple». Ce qui est remarquable, c’est que cette «habitation» se manifeste à la fois dans la communauté rassemblée — ce qui correspond bien aux usages de l’Ancien Testament — mais aussi dans le «cœur» de chaque croyant individuellement.
Les implications de cet aspect central de la pensée de Paul sont considérables pour nous, et cela dans deux directions : d’une part, pour notre compréhension de l’Esprit, et donc de la nature même de Dieu; d’autre part, pour notre perception de l’Esprit comme la venue de la puissance de Dieu en nous et au milieu de son peuple.
Tout d’abord, quoi qu’on en dise, pour Paul, l’Esprit n’était en aucun cas une simple «force», «influence» ou «puissance» impersonnelle — comme c’est malheureusement le cas pour beaucoup de chrétiens aujourd’hui. J’en ai eu une illustration frappante il y a de nombreuses années, alors que Russ Spittler et moi enseignions tous deux au Southern California College. Un jour, il est entré dans mon bureau pour me raconter une conversation qu’il venait d’avoir avec un étudiant — un étudiant pentecôtiste dans un collège pentecôtiste.
«Dieu le Père, je peux m’y identifier, et Dieu le Fils, je le comprends,» lui avait dit l’étudiant, «mais le Saint-Esprit, c’est pour moi une sorte de tache floue grisâtre, allongée.»
Je repense souvent à ce moment et me dis: «Mais bien sûr.» Comment cela aurait-il pu être autrement? Toutes nos représentations de l’Esprit étaient centrées sur une expérience unique, initiale. Nos discours parlaient de l’Esprit en termes de «vent, feu, eau, huile» — des images impersonnelles, tirées principalement de l’Ancien Testament. Nous priions pour que Dieu «envoie la puissance maintenant», et sous l’influence de la Bible King James, nous appelions l’Esprit par un pronom neutre, «it» (ça). Pas étonnant, dans ce contexte, que l’Esprit soit perçu comme une «tache floue allongée» par notre jeune ami. Comment peut-on entretenir une relation personnelle et intime avec le vent ou le feu?
L’Esprit de Dieu, dans le Nouveau Testament, n’est pas appelé à la légère l’Esprit de Jésus-Christ. De même que Christ a, pour ainsi dire, donné un visage humain au Père, il a également donné un visage humain à l’Esprit.
Le ministère du Saint-Esprit peut, bien sûr, être représenté par ces images. Mais l’Esprit lui-même n’est ni le vent, ni l’eau, ni le feu. Le Saint-Esprit est une personne; il est l’Esprit du Dieu vivant, rendu présent au milieu de nous; il est l’Esprit de Christ qui habite en nous pour glorifier le Dieu du ciel. Dans le Nouveau Testament, il n’est pas anodin que l’on parle de l’Esprit de Dieu comme de l’Esprit de Jésus-Christ. De la même manière que Christ a, en quelque sorte, donné un visage humain au Père, il a aussi donné un visage humain à l’Esprit.
Pour le dire en mes propres termes : avant d’étudier en profondeur cette question pour l’ouvrage majeur sur Paul et l’Esprit, j’étais déjà trinitaire ; mais désormais, je suis devenu un trinitaire passionné et profondément convaincu.
Le Saint-Esprit, s’il vous plaît, n’est pas un simple «ça»; l’Esprit n’est nul autre que Dieu lui-même, personnellement présent en nous et parmi nous. Paul illustre cela de deux manières. D’une part, l’Esprit a ôté le voile — à la fois celui qui couvrait nos cœurs et celui qui séparait le lieu très saint dans le temple — si bien que Dieu n’est plus caché à nos yeux. Grâce au sacrifice de Christ, offert en notre faveur, nous avons désormais, par l’Esprit, un accès direct à la présence même de Dieu — non pas comme des mendiants craintifs qui mériteraient uniquement le châtiment, mais comme des enfants bien-aimés qui peuvent s’approcher du Père et, par son Esprit, l’appeler: «Abba, Abba, Abba», laissant jaillir de nos cœurs la foi simple et confiante des enfants.
C’est à la lumière de l’Esprit, en tant qu’accomplissement du motif de la Présence, qu’il faut lire ce passage parmi les plus extraordinaires de Paul: 2 Corinthiens 3.1-18. Paul affirme qu’il n’a nul besoin de lettres de recommandation, comme c’est le cas des colporteurs de la parole, car il est ministre de la nouvelle alliance — une alliance de l’Esprit, qui donne la vie.
Contrairement à ces colporteurs, dont le ministère reste enraciné dans l’ancienne alliance et sème la condamnation et la mort, celui de Paul s’inscrit dans le temps de l’accomplissement des promesses: le temps où l’Esprit est désormais accessible à tous. La venue de l’Esprit a mis fin à l’ancienne alliance et a actualisé l’œuvre de Christ, par qui les effets de la chute ont été profondément renversés. En effet, par Christ et par l’Esprit, nous sommes en train d’être transformés pour refléter l’image à laquelle nous étions destinés dès le commencement. Dans la liberté que donne l’Esprit, nous avons contemplé la gloire même de Dieu — telle qu’elle nous est révélée dans le visage de notre Seigneur Jésus-Christ — et cette gloire, nous en faisons maintenant l’expérience. Et nous la connaîtrons de plus en plus pleinement, jusqu’au jour où nous entrerons dans la gloire finale.
On ne prend à la légère l’Esprit qu’à ses risques et périls, dans la théologie de Paul comme dans l’expérience chrétienne; car c’est précisément là que réside la «gloire»: par l’Esprit, non seulement nous connaissons Dieu, mais nous vivons dans sa présence de manière à être sans cesse renouvelés à son image.
Mais il y a plus encore: non seulement nous vivons dans la présence de Dieu par l’Esprit — le voile ayant été levé — mais nous faisons aussi l’expérience, de manière concrète et vécue, que Dieu lui-même, en personne, a établi sa demeure parmi son peuple. Il habite aussi bien la vie de chaque croyant que les rassemblements communautaires pour l’adoration et l’instruction. C’est ici que l’imagerie du temple chez Paul prend toute son importance: Dieu est revenu habiter dans son temple — c’est-à-dire l’Église — tout en demeurant aussi dans chacun de ses enfants. Voilà ce qui nous distingue de tous les autres peuples de la terre.
Ainsi, dans 1 Corinthiens 3.16-17, Paul interpelle les Corinthiens: «Ne savez-vous pas qui vous êtes? Vous — l’Église de Corinthe — vous êtes le temple de Dieu à Corinthe; et vous l’êtes parce que l’Esprit de Dieu habite au milieu de vous» (traduction libre). Bien qu’il y eût vingt-six temples et sanctuaires païens dans la Corinthe antique, le Dieu vivant n’y avait qu’un seul temple — et ce n’était pas un édifice, mais un peuple rassemblé, en qui et parmi qui il demeurait personnellement, par son Esprit. Paul ajoute avec force: «Si quelqu’un détruit ce temple» — c’est-à-dire en se fiant à la sagesse humaine et en divisant la communauté — «Dieu détruira cette personne.»
De même, dans 2 Corinthiens 6.16-18, alors qu’il leur rappelle qu’ils sont le temple de Dieu et qu’ils doivent, par conséquent, se détourner des repas dans les temples païens, Paul cite la promesse d’Ézéchiel 37.27: «Ma demeure sera parmi eux; je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple.» Ainsi, dans un développement particulièrement saisissant de cette image, Paul affirme en 1 Corinthiens 6.19-20 que la raison théologique ultime pour laquelle les hommes de Corinthe ne peuvent plus persister dans la prostitution rituelle issue de leur passé païen, c’est que leur propre corps est, lui aussi, devenu le temple du Saint-Esprit — cet Esprit qu’ils ont reçu de Dieu.
Prendre l’Esprit à la légère, dans la théologie de Paul comme dans l’expérience chrétienne, c’est s’exposer à un grand danger. Car c’est précisément là que réside la «gloire»: par l’Esprit, non seulement nous apprenons à connaître Dieu, mais nous sommes rendus capables de vivre dans sa présence, de telle manière que nous soyons continuellement renouvelés à son image.
Ainsi, l’Esprit est la présence personnelle de Dieu lui-même, dans nos vies et au milieu de nous, pour nous conduire sur les sentiers de la justice, à cause de son nom. C’est l’Esprit, présent parmi nous, qui «opère tout en tous», qui est attristé lorsque son peuple ne reflète pas son caractère et ne manifeste pas sa gloire, et qui est présent dans notre adoration lorsque nous chantons «louange, honneur, gloire et puissance» à Dieu et à l’Agneau.
Il revient au peuple de Dieu, en des temps comme les nôtres, de redécouvrir ces réalités en les expérimentant réellement, si nous voulons véritablement saisir la vision de Paul. Peut-être que notre point de départ devrait être d’accorder moins d’importance aux images impersonnelles — aussi riches soient-elles pour illustrer certains aspects du ministère de l’Esprit (le vent, le feu, etc.) — et de réorienter notre pensée selon les termes mêmes de Paul: comprendre et vivre l’Esprit comme la présence personnelle du Dieu éternel. Et cela, non pas seulement pour notre propre bien, mais pour le bien du monde. C’est cela, la bonne nouvelle: par l’Esprit même de Dieu, nous vivons dans sa présence, et nous connaissons sa Présence qui habite en nous et parmi nous.
Je me risquerais à dire que lorsque nous sommes à la fois remplis d’émerveillement et de crainte révérencieuse devant la présence même de Dieu, et que, par son Esprit, nous sommes attirés dans une intimité réelle avec le Dieu éternel, alors nous sommes véritablement prêts à porter la bonne nouvelle dans le monde — avec la puissance de l’Esprit — et à le faire dans une spiritualité simple, ancrée dans le quotidien, où nous vivons conscients de la Présence vivante du Dieu vivant, compagnon fidèle de chaque instant.
Avec Moïse — mais désormais aussi à la lumière de notre expérience néotestamentaire pleinement accomplie — puissions-nous prier à nouveau: «Si ta Présence ne vient pas avec nous, ne nous fais pas partir d’ici. Comment saura-t-on que tu es favorable à ton peuple, si tu ne marches pas avec nous? Qu’est-ce qui distinguera ton peuple de tous les autres peuples sur la face de la terre?»
Et cela, je vous le dis, n’est pas réservé à une élite super-spirituelle.
C’est ce que la vie chrétienne est appelée à être: une réalité quotidienne, une spiritualité enracinée dans la vie concrète.
Notes de fin
- Toutes les références scripturaires proviennent de la S21, sauf indication contraire.
- Le mot «Présence» (avec une majuscule) indique une référence directe à l’être de Dieu présent, plutôt qu’à la simple idée de «présence».
Cet article a été publié à l’origine dans CRUX, A Quarterly Journal of Thought and Opinion, Regent College, Summer 2008, Vol. 44:2 et est traduit et publié ici avec autorisation.