La Controverse du Marrow est une querelle qui a divisé l’Église écossaise au début du xviiie siècle autour de la réédition de l’ouvrage d’Edward Fisher The Marrow of Modern Divinity. Au cœur de la controverse, la perpétuelle question des rapports entre la grâce et les œuvres, la loi et l’Évangile, non seulement sur le plan de la théologie systématique, mais également en ce qui a trait à notre prédication et à notre pratique pastorale et, en fin de compte, à nos cœurs. Sinclair Ferguson réussit ce tour de force de nous rendre cette controverse à la fois accessible et passionnante. Toutefois, son propos ne se limite pas à cela : à partir d’une dispute vieille de plusieurs siècles, et dans une clarté qui n’a pas son égal dans la littérature évangélique récente, il nous donne à comprendre, mieux que quiconque jusqu’ici, un problème récurrent qui mine l’Église d’aujourd’hui.
Cet ouvrage n’est pas juste une réflexion historique utile : c’est un véritable traité pour notre temps.
1. Bien plus que des positions doctrinales
L’un des traits les plus marquants de la Controverse du Marrow est que ses défenseurs se virent accusés de défendre des positions antinomistes, et que certains de ses opposants furent en retour suspectés de légalisme, alors que de part et d’autre, tous souscrivaient à ce que la Confession de Westminster enseignait en matière de la justification et des œuvres. La doctrine de la Confession est en effet très claire et précise à ce sujet : elle enseigne que la foi en Christ conduit à la justification sur la base de « l’obéissance et la satisfaction du Christ » qui nous est imputée, et non sur la base de ce que nous aurions fait ou qui viendrait de nous. Néanmoins, si les œuvres ne sont en aucune manière source de justification, elles sont les preuves nécessaires que nous sommes justifiés ; néanmoins (encore), bien que les œuvres trouvent leur source dans la reconnaissance et l’assurance de notre salut par la grâce, une telle « obéissance évangélique » n’entre en rien dans notre statut de croyants justifiés devant Dieu, de sorte que nous ne pouvons perdre ce statut, même si en péchant, nous tombons « sous le déplaisir paternel».
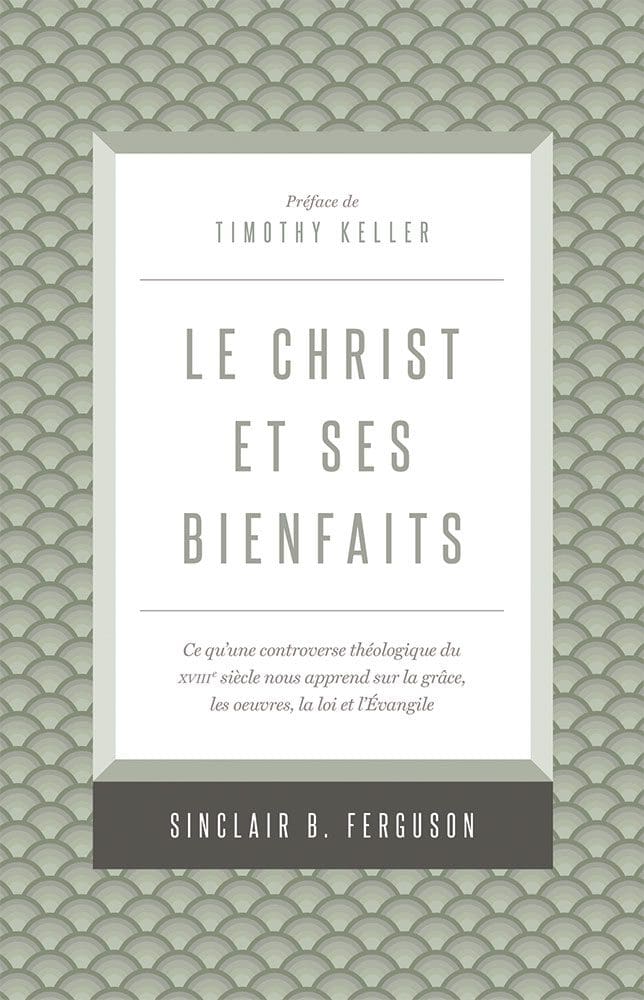
Le Christ et ses bienfaits
Sinclair B. Ferguson
L’auteur nous montre que l’antidote aux poisons du légalisme et de l’antinomisme est le même : l’Évangile vivifiant de Jésus-Christ, en qui nous sommes simultanément justifiés par la foi, libérés pour pratiquer de bonnes œuvres et assurés du salut.
Ce faisant, Sinclair Ferguson nous offre un exposé des plus nuancés de la doctrine protestante de la justification par la foi seule par Christ seul. Tous ceux qui se sont trouvés impliqués dans la Controverse du Marrow avaient souscrit aux articles si précisément formulés de la Confession : comment dès lors avaient-ils pu s’accuser réciproquement d’antinomisme et de légalisme, au point de créer une ligne de fracture au sein de l’Église, qui allait conduire à une scission au sein de leur dénomination ? Aussi précise que fût la formulation des articles de la Confession, cela n’avait manifestement pas suffi à résoudre le problème latent du rôle de la loi et de l’obéissance pour la vie chrétienne.
À partir de la Controverse, Sinclair Ferguson nous ouvre des perspectives et dégage un certain nombre de conclusions qui ne sont pas sans avoir des implications directes sur la vie chrétienne d’aujourd’hui. En voici quelques-unes que j’ai trouvées particulièrement pertinentes.
La première, difficilement réfutable, est que le légalisme et l’antinomisme sont bien plus que des positions doctrinales. Aucune des parties ne défendait des propositions qui auraient consisté à dire : « Vous pouvez être sauvés par les œuvres » ou « Maintenant que vous êtes sauvés, vous pouvez vous dispenser d’obéir à la loi de Dieu ». Aucune des parties ne défendait ouvertement et explicitement l’une ou l’autre des positions. Mais quoi qu’il en soit, le légalisme comme l’antinomisme peuvent l’un et l’autre miner le ministère. L’un et l’autre tissent leur toile jusque dans nos attitudes, caractère, pratiques et manières de lire les Écritures. L’auteur va même jusqu’à suggérer, à juste titre, qu’un esprit légaliste touche à notre manière de nous sentir face à Dieu.
L’esprit légaliste est animé par la jalousie, une sensibilité exacerbée pour les petits écarts, une intransigeance marquée vis-à-vis de l’erreur, et une incapacité inhérente à la prise de décision. Tant Edward Fisher que Thomas Boston, les principaux protagonistes de la Controverse du Marrow, décrivent la manière dont, tout en souscrivant sans faillir à la doctrine de la justification par la foi tout au long de leur ministère, ils agissaient néanmoins comme si la loi de Dieu était une « alliance des œuvres » plutôt qu’une « règle de vie ».
En même temps, l’antinomisme pratique peut se développer même si l’on n’y adhère pas sur le plan doctrinal : il peut prendre la forme d’un évangile séculier de la complaisance qui se travestit sous les formes de la foi chrétienne. Il se manifeste souvent lorsque le ministère et la pratique du pasteur ne parviennent plus à réconcilier devoir et plaisir. L’échec à se soumettre complètement à Dieu à lui obéir de tout notre cœur et à y trouver de la joie – comme un moyen de lui ressembler, de le connaître et lui plaire – devient le signe d’une tendance à l’antinomisme.
2. Deux erreurs, une même racine
La deuxième chose que j’ai apprise en lisant cet ouvrage est que le légalisme et l’antinomisme ont les mêmes racines. Il y a fort à parier que pour beaucoup de lecteurs, cette thèse sonnera comme l’annonce d’un changement de paradigme. C’est une erreur fatale que nous, pasteurs, commettons trop souvent, qui consiste à croire que légalisme et antinomisme sont totalement opposés : pour notre auteur, ils sont plutôt de faux jumeaux, issus d’une même matrice. Tous deux trouvent leur origine dans le mensonge de Satan dans le jardin d’Éden, qui consiste à nous faire douter de la bonté de Dieu et de son engagement complet pour notre bonheur et notre bien-être, au point de croire que si nous lui obéissons, nous allons passer à côté de la vie et finir malheureux.
C’est une erreur fatale que nous, pasteurs, commettons trop souvent, qui consiste à croire que légalisme et antinomisme sont totalement opposés
Une attitude comme l’autre sont un refus de croire à l’amour et la grâce de Dieu : elles partent de l’idée que les commandements de Dieu seraient un signe qu’il se refuse à nous voir heureux. Ni l’une ni l’autre ne peuvent concevoir l’obéissance à la fois comme un moyen de plaire à Dieu et de s’accomplir en tant que personnes, pour devenir ce pour quoi Dieu nous a créés. Ces deux états d’esprit ont en commun une même incompréhension de la joie qui résulte de l’obéissance : tous deux considèrent l’obéissance comme quelque chose qui nous serait imposé par un Dieu dont l’amour dépendrait de nous, et dont les bénédictions seraient conditionnées par nos œuvres. La seule différence est que le légaliste assume péniblement son fardeau, alors que l’antinomiste le rejette en prétendant que si Dieu l’aimait vraiment, il ne lui demanderait rien de tel. Ainsi pour sauvegarder l’idée d’un Dieu bon, les antinomistes trouvent un moyen de se convaincre que Dieu n’exige aucune obéissance de notre part.
3. Deux erreurs et non une seule
La troisième leçon que je retiens de la lecture de cet ouvrage, qui découle de la précédente, consiste à croire que tous les problèmes proviennent de l’une ou l’autre des attitudes, de sorte que rejeter l’une revient à tomber dans l’autre. Si l’on saisit la portée du propos de Sinclair Ferguson – à savoir que le légalisme et l’antinomisme proviennent d’une même incapacité à saisir la grâce et la bonté de Dieu – on comprend rapidement que ce serait une erreur de vouloir équilibrer l’un par l’autre en mettant un peu d’eau dans son vin, de croire qu’on pourrait lutter contre le légalisme en insistant un peu moins sur la loi et l’obéissance, et qu’on pourrait guérir de l’antinomisme par une touche de légalisme.
Une telle erreur est dangereuse : dire à une personne portée au légalisme qu’elle devrait moins parler de loi et d’obéissance revient à encourager une attitude antinomiste qui peine à voir que la loi est un magnifique don de Dieu ; et dire à un antinomiste qu’il devrait plus souvent évoquer les menaces divines et insister sur les dangers de la désobéissance équivaut à encourager un esprit légaliste qui considère la loi comme une alliance des œuvres plutôt qu’un moyen d’honorer Celui qui l’a sauvé par la grâce.
4. Une seul moyen de guérir
Enfin, ce livre m’a montré que le seul moyen de guérir à la fois du légalisme et de l’antinomisme, c’est l’Évangile :
L’Évangile est venu pour nous délivrer du mensonge du Serpent. En effet, il révèle, derrière la venue et la manifestation du Christ et de sa mort pour nous, l’amour d’un Père qui nous donne tout ce qu’il a : d’abord son Fils pour mourir pour nous, et ensuite son Esprit pour vivre en nous […] Il n’y a qu’un seul traitement véritable au légalisme : comprendre et goûter à l’union avec Jésus-Christ lui-même. Cela nous conduira à un nouvel amour pour la loi de Dieu et à une nouvelle obéissance à son endroit.
Ce livre m’a montré que le seul moyen de guérir à la fois du légalisme et de l’antinomisme, c’est l’Évangile :
Comme la racine du mal est commune aux deux attitudes, le remède sera commun lui aussi : proclamer l’amour et la bonté de Dieu en rappelant l’Évangile qui fait de l’obéissance une joie. Le remède à ces deux problèmes réside dans une compréhension plus profonde, plus biblique et plus complète de la grâce et de la personne de Dieu.
Ce livre regorge de pistes de réflexion : parmi elles, mentionnons la « nouvelle perspective sur Paul » qui peut par certains aspects encourager une lecture encore plus légaliste des textes bibliques, alors que ceux qui critiquent la vision traditionnelle de la loi selon les trois dimensions – morale, cérémoniale et civile – peuvent friser l’antinomisme. Mais les perspectives qu’ouvre ce livre tournent selon moi autour de trois axes.
Calvin a fait de la justification « l’axe de rotation », « l’article principal de la religion chrétienne » :
Que chacun d’entre nous fasse un effort pour bien le comprendre ! Nous n’avons pas de fondement sur lequel établir notre salut, si nous ne savons pas quelle est la volonté de Dieu pour nous ; de même, nous n’avons pas de fondement pour nous édifier dans la sainteté et la crainte de Dieu.
Calvin a certainement raison de souligner que l’article touchant à notre statut de pécheurs justifiés devant Dieu ne saurait avoir d’égal : il doit constituer le fondement de notre pensée, de nos sentiments et de nos actions ; sans cela, notre mode de pensée par défaut – cette croyance que Dieu n’est pas pour nous – reprendra le dessus et nous ramènera dans l’alliance des œuvres.
Or, s’il est vrai que notre problème principal est un manque de confiance en l’amour et la bonté de Dieu, alors la simple exhortation à croire que « Tout ce dont vous avez besoin pour votre sanctification est la foi en votre justification » n’y suffira pas. Elle conduira simplement à soigner un esprit légaliste en donnant moins d’importance à la loi. Il y faut plus qu’une simple croyance abstraite en l’impunité : ce qu’il faut, c’est un renouvellement de notre vision de Dieu. Cependant, comme le souligne John Owen dans son ouvrage sur la mortification, la réponse ne consiste pas non plus à dire qu’il « suffirait de travailler à sa sanctification pour devenir saint ». Selon Owen, l’origine de notre comportement pécheur réside dans notre incapacité à haïr le péché en tant que tel, qui à son tour provient de notre tendance à considérer l’obéissance comme un simple moyen d’éviter le danger et profiter de la vie, et non comme une manière d’aimer et de connaître Jésus pour qui il est.
Tuer la racine
Ainsi, ce n’est pas en renforçant notre croyance en la justification que nous grandirons dans la grâce – même si nous devrions méditer chaque jour sur cette réalité. Dans une perspective plus large, c’est en appliquant le remède de l’Évangile de la grâce aux racines du péché – à savoir au manque de confiance en la bonté de Dieu et à l’amour immodéré de toutes ces choses auxquelles nous attribuons le pouvoir de nous sauver.
Lorsque nous contemplons la gloire du Christ dans l’Évangile, et nous nous délectons en lui, nos priorités se remettent en ordre, et tout ce qui avait pouvoir d’asservissement sur nos vies perd son emprise. Le chemin de la sanctification ne consiste pas simplement à se dire que nous sommes acceptés et pardonnés –bien que cela soit fondamental. La sanctification consiste à aller au plus profond de l’Évangile : c’est ce que fait Sinclair Ferguson en nous montrant l’importance de cette démarche pour la pratique pastorale et la prédication.


































