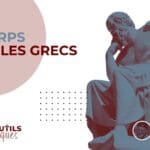1 – La notion de « contrat social »
D’où provient cette notion ? Elle est développée dans l’essai de Rousseau (1712-1778) intitulé Du contrat social ou Principes du droit politique, publié en 1762. D’emblée, Rousseau affirme : « Je veux chercher si, dans l’ordre civil, il peut y avoir quelque règle d’administration légitime et sûre, en prenant les hommes tels qu’ils sont, et les lois telles qu’elles peuvent être. Je tâcherai d’allier toujours, dans cette recherche, ce que le droit permet avec ce que l’intérêt prescrit, afin que la justice et l’utilité ne se trouvent point divisées. » (Livre I, Préambule)
D’où part la proposition de Rousseau ? De ce qu’il nomme « l’état de nature », dans lequel règne le droit du plus fort, soit : l’inégalité entre les hommes. Comment parvenir à la justice, c’est-à-dire, à un ordre social qui serve les intérêts de chacun ? Le « contrat social » est la réponse à cette question. En quoi consiste-t-il ?
On peut le définir comme un pacte, ce qui implique donc deux partis :
- d’un côté, l’ensemble des citoyens, qui acceptent de renoncer à leurs droits particuliers,
- de l’autre, l’État qui, en échange, par l’application de la loi, garantit aux citoyens la liberté et la sécurité.
Par le « contrat social », chacun renonce donc à sa liberté naturelle (« je fais ce que je veux ») pour acquérir une liberté civile, encadrée par la loi, car, précise bien Rousseau : « Nul n’est au-dessus de la loi ».
En affirmant que seule cette convention fonde l’autorité de l’État, Rousseau pose que tout État légitime est ce qu’on nomme aujourd’hui « un État de droit », fondé sur la volonté du peuple, ou « volonté générale ».
2 – Pertinence du concept
C’est bien Rousseau qui est à l’origine de la pensée du « contrat social », mais elle s’est développée, dans la pensée du droit politique, dès le XVIIe s. chez Hobbes, ou bien Locke. La grande question à laquelle le « contrat social » apporte une réponse est la suivante : qu’est-ce qui fait que, sans que les hommes y soient contraints, ils acceptent, en toute conscience, d’obéir à la loi ?
Ce concept est fondamental pour garantir le fonctionnement démocratique de l’État. En effet, quand le pouvoir politique n’est qu’un fait arbitraire, non garanti par le droit, par la loi, mais qu’il est pris par la force, on est alors dans un régime tyrannique.
Le « contrat social » est un concept totalement positif :
- Il repose sur le consensus de tous les citoyens, libres et égaux face à la loi.
- Il contraint les gouvernants à garantir aux citoyens la liberté, l’égalité, ou le respect du droit à la propriété. Le pouvoir qu’ils ont leur est délégué par « la volonté générale » du peuple.
- Enfin, le « contrat social » se fonde sur la notion d’« intérêt général ».
Rousseau crée le concept au moment où la France bascule de la monarchie dans la démocratie, avec la Révolution française. Peut-être vaudrait-il mieux dire, en fait : une première tentative d’instauration de la république. L’Histoire, ne serait-ce que de l’Europe, du XVIIIe au XXe s., montre bien qu’il est nécessaire de veiller afin de ne pas tomber dans un pouvoir politique qui ne se fonde plus sur le droit mais sur la force.
3 – Perspective biblique
Porter un concept relié à la pensée politique à la lumière de la Bible ne relève pas de l’évidence. Toutefois, je voudrais souligner le fait qu’il y a quelque chose de profondément juste dans ce concept de « contrat social ». Auparavant rappelons que Rousseau est né en Suisse, où sa famille, protestante, avait émigré. S’il n’est pas demeuré dans cette religion, le protestantisme a tout de même été à la base de son éducation.
Quel point de connexion entre la foi chrétienne et le concept de « contrat social » ai-je identifié ? Nous l’avons vu, il repose sur le consentement de chaque citoyen au renoncement à ses droits naturels, au profit du gouvernement qui doit, selon la loi, lui assurer la liberté et la sécurité. Ce principe du renoncement me fait penser à ce qui se produit lorsqu’un individu, par la conversion, choisit librement de renoncer à ses droits sur sa vie, afin de la confier à Dieu qui, selon les promesses de sa Parole, le libère du péché, par la foi en Jésus-Christ et lui donne la sécurité liée à sa protection.
J’ajouterai, enfin, que si les relations humaines se fondaient sur un amour sincère, il ne serait pas nécessaire de passer un « contrat social ». Mais il n’en va pas naturellement ainsi entre les hommes. C’est dans l’Église que les croyants peuvent expérimenter la vie commune renouvelée par l’amour. D’où le partage et l’entraide. En société, un état de droit est bien une protection effective contre le mal.