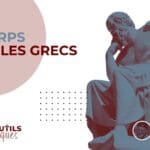Le thème de l’autre
La relation à autrui est un thème majeur de la philosophie.
La Bible révèle que l’homme a été créé par Dieu pour entrer en relation avec Dieu et avec son prochain. D’ailleurs, la relation est dans la nature même de Dieu, du fait de la Trinité. L’amour circule entre le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Mais, du côté des hommes, on est bien forcé d’admettre qu’instaurer une bonne relation avec autrui ne coule pas de source.
Dans cette série de quatre séquence, j’ai choisi deux exemples pour montrer que la relation à l’autre a parfois été pensée de manière négative :
- Par Hegel (1770-1831), philosophe allemand majeur, dans la tradition de pensée européenne, et dont « la dialectique du maître et de l’esclave » reste un fondement.
- Par Sartre (1905-1980), qui fait écho à Hegel, dans sa manière de penser le regard de l’autre sur moi, qui m’objective, c’est-à-dire ne me voyant pas tel que moi je crois être. Le regard d’autrui devient alors si insupportable que le personnage de Garcin, dans la pièce Huis-Clos, en vient à prononcer cette fameuse petite phrase : « L’enfer c’est les autres. »
Ces deux séquences sont suivies de deux autres qui, elles, envisagent le rapport à l’autre sur un mode positif, cette fois. Je les ai consacrés à :
- Lévinas (1905-1980), dont la pensée est centrée sur l’éthique. Le concept de « visage », qu’il a créé, est central chez lui et il mérite d’être découvert.
- Derrida (1930-2004), enfin, a ouvert des voies nouvelles à la philosophie. Son concept d’« hospitalité inconditionnelle » remet en question nos manières de nous comporter à l’égard de celui qui nous est tout à fait étranger, que ce soit au niveau individuel ou collectif.
Ces quatre séquences entrent donc en écho les unes avec les autres.
1 – Le concept d’« hospitalité » dans la pensée de Derrida
La pensée de Jacques Derrida (1930-2004) a eu une influence majeure depuis la seconde moitié du XXe s. Il pense à la fois avec et contre la tradition philosophique européenne, issue de la Grèce antique, et aussi avec le judaïsme, en raison de ses origines. Mon approche de cette pensée se limitera ici au seul concept d’« hospitalité » : que faut-il entendre par là, chez lui ?
Pour Derrida, il est essentiel de s’ouvrir à ce qui vient, qui peut être, d’une part, l’évènement, imprévisible et, d’autre part, l’autre, celui qu’on n’attendait pas. L’hospitalité, écrit-il, « est d’avance ouverte à quiconque n’est ni attendu ni invité, à quiconque arrive en visiteur absolument étranger, en arrivant non identifiable et imprévisible, tout autre. » (1) Derrida accole au terme d’« hospitalité » l’adjectif « inconditionnelle ».
En fait, il distingue deux types d’hospitalités :
- « L’hospitalité conditionnelle » : elle s’exerce sur le mode de l’invitation, c’est-à-dire que je choisis qui je reçois et je le reçois conformément aux règles en usage chez moi.
- « L’hospitalité inconditionnelle » : elle s’exerce sur le mode de la visitation, c’est-à-dire que je laisse entrer chez moi n’importe qui.
« L’hospitalité inconditionnelle » est liée à la croyance messianique ( accueillir celui qui vient : le messie ). Comme pour le philosophe Lévinas, l’exercer c’est obéir à un impératif s’adressant à tout homme, religieux ou pas. Le philanthrope est ami des hommes en général. Celui qui exerce « l’hospitalité inconditionnelle » est plus qu’un philanthrope. Il devient le protecteur, le bienfaiteur de l’autre avec lequel il exerce plus que l’amitié, un don d’amour inconditionnel.
2 – L’efficience du concept
La radicalité du concept d’« hospitalité inconditionnelle » de Derrida est dérangeante. Elle remet en cause la tendance naturelle de l’individu et des sociétés au repli sur soi. On peut même aller jusqu’à parler de pensée subversive, puisqu’on ne peut fonder aucune économie sur ce principe. En effet, l’économie repose sur les notions d’échange et de réciprocité. Mais, dans « l’hospitalité inconditionnelle », il n’y a justement ni échange ni réciprocité. Le don est gratuit.
On pourrait reprocher à Derrida un certain idéalisme : quels hommes sont capables d’entrer dans une telle dynamique, si ce n’est ceux qui sont habités par une foi ? Or Derrida n’est pas un penseur religieux. Ce reproche serait malvenu, car Derrida est aussi un penseur politique, qui veut orienter la démocratie vers des valeurs comme : la paix ; la tolérance ; le métissage culturel ; l’accueil des réfugiés ; etc. Il s’adresse aux individus mais il vise aussi le corps social : l’État ; les institutions ; la Justice…
Derrida fut un penseur mais aussi un homme d’action. Voici un exemple d’initiative à l’origine de laquelle il se trouve. Fin novembre 1993 est fondé le Parlement International des Écrivains, en réaction aux nombreux assassinats d’écrivains, en Algérie. Plus de 300 intellectuels sont signataires de l’appel lancé. L’organisation est constituée en 1994. En 2004, le PIE s’auto-dissout. Il est remplacé par le Réseau international des villes-refuges : création de structures d’accueil des écrivains menacés et contraints de s’exiler pour des raisons idéologiques. L’instance fonctionne jusqu’en juin 2005, date à laquelle elle est aussi dissoute.
Le concept d’« hospitalité inconditionnelle » a donc été concrètement appliqué, faisant apparaître la possibilité d’ouverture de voies concrètes nouvelles.
3 – Perspective biblique
Derrida est né dans l’Algérie française : l’Orient est réputé pour sa tradition d’hospitalité. Elle y est un devoir sacré.
La Loi de Moïse ordonne l’hospitalité. Dans le livre du Lévitique, on peut lire : « Vous traiterez l’immigrant parmi vous comme un autochtone du milieu de vous ; tu l’aimeras comme toi-même. » (19:34) Et l’exhortation à l’hospitalité est également adressée aux chrétiens dans le Nouveau Testament : « N’oubliez pas l’hospitalité. » (Hébreux 13:2)
Cette idée d’« hospitalité inconditionnelle » va tout à fait dans le sens de l’Évangile. Car il s’agit bien d’une disposition du cœur de l’homme, prêt à donner, à se donner, sans rien attendre en retour, comme le Christ donna sa vie.
La pensée de Derrida a débouché sur des actions concrètes. L’amour du Christ devrait aussi pousser les chrétiens à l’exercice de cette « hospitalité inconditionnelle », de manières concrètes qui restent encore à inventer.
(1) – Le concept du « 11 Septembre ». Dialogues à New York avec Giovanna Borradori. Galilée. 2004.
Pour aller plus loin :
- Présentation de l’ouvrage de Derrida, Hospitalité. Volume 1. Séminaire (1995-1996). Édition établie par Pascale-Anne Brault et Peggy Kamuf. Seuil, coll. « Bibliothèque Derrida », 400 p.
- Vidéo : « L’hospitalité aujourd’hui » ; Michel Agier ; Collège de France ( 5 minutes )