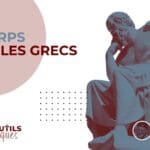La Grèce à la source
La culture européenne a un triple enracinement :
- dans la Grèce antique
- dans la culture romaine
- dans la tradition chrétienne
On relie parfois ce triple enracinement dans les trois villes qui les symbolisent, à savoir ; Athènes, Rome, et Jérusalem.
S’il existe des liens évidents entre Athènes et Rome, par contre, la Bible, elle, ne rien doit rien de la Grèce, et les deux entre même le plus souvent en opposition.
Dans cet ensemble de quatre séquences, nous examinerons chaque fois un outil, provenant de la source grecque, et qui éclaire la culture européenne moderne.
Il s’agit des outils suivants :
- L’affirmation de Nietzsche : « Ma philosophie, la platonisme inversé. » Quelles sont les répercussions de cet aphorisme ?
- Les concepts « Eros et Thanatos » dans la pensée de Freud. Ils sont extraits de l’essai Malaise dans la culture, titre révélateur.
- Pourquoi les dieux grecs Apollon et Dionysos éclairent-ils la modernité, en passant par la philosophie de Nietzsche, qui crée, à partir d’eux, les notions d’« ordre apollinien » et « ordre dionysiaque » ?
- De la « tekhné » grecque au « dispositif » de la technique moderne, selon Heidegger ; que s’est-il passé ?
1 – Deux dieux grecs
Nombreux sont les dieux de la mythologie grecque. Parmi ceux-ci, nous en distinguerons deux, que l’on pourrait qualifier, en tant que fils de Zeus, de frères ennemis, tant ils sont opposés l’un à l’autre. Il s’agit d’Apollon et de Dionysos.
Apollon est d’abord associé à la lumière, ce qui est, déjà, une information d’importance concernant sa nature positive, solaire. On comprend qu’il en découle qu’il soit le dieu des arts, de la musique en particulier, mais aussi de la poésie et de la beauté, masculine. Il est encore doté d’un pouvoir de purification et de guérison.
Dionysos, lui, doit d’abord être relié à la vigne. Il est le dieu du vin, qui procure l’ivresse aux hommes. Une ivresse symbole de la jouissance des plaisirs naturels de la vie, et aussi de la procréation. Une ivresse qu’il faudrait plus rapprocher des effets de la drogue que de ceux du vin seulement. En lui s’associent : l’ivresse, la fête et les excès, notamment dans le domaine sexuel. Le culte de Dionysos est l’orphisme, un culte à mystères, dans lequel se manifeste le côté nocturne du dieu, qui est aussi le maître du monde souterrain.
Pour finir, on peut ajouter que les Grecs ont vu, en Apollon, le symbole de l’ordre, une incarnation de l’harmonie universelle, tandis que Dionysos, lui, est du côté des excès, et du désordre.
2 – De la mythologie à la philosophie
C’est le philosophe allemand Nietzsche (1844-1900) qui, dans son ouvrage La naissance de la tragédie (1872) crée, à partir de ces dieux antagonistes de la mythologie, deux ordres conceptuels qu’il nomme « l’apollinien » et « le dionysiaque ». Nous nous contenterons, ici, de montrer ce qui caractérise ces deux ordres.
L’ordre apollinien est à relier aux notions suivantes : la clarté ; l’équilibre ; l’harmonie ; le sens de la mesure ; la soumission à un ordre rationnel. A ces valeurs correspond l’art que l’on dit classique. L’apollinien serait le propre de la civilisation occidentale.
Inversement, l’ordre dionysiaque correspond à : l’obscur ; le déséquilibre ; le chaos ; la démesure ; la perte du contrôle de soi (expression spontanée des pulsions) ; la folie. On aurait là, selon Nietzsche toujours, un ferment à l’origine des civilisations d’Asie Centrale et du Moyen-Orient.
Entre Apollon et Dionysos, Nietzsche lui-même avait choisi : Dionysos. Cet « ordre dionysiaque » qu’il théorise est véritablement une clef de compréhension des temps modernes. En particulier, le basculement, dans la culture européenne, de la très longue période classique dans la modernité, correspondant à un basculement de l’ordre apollinien dans le dionysiaque.
Dès 1969 (la date est révélatrice) ; le penseur protestant Jean Brun (1919-1994) analysait le retour de Dionysos. Je le cite : « Depuis des siècles, Dionysos étend le cercle de sa ronde, car il ne s’est pas contenté d’être le dieu de quelques mystères grecs, il est devenu l’animateur de la technique, l’inspirateur des intellectualismes les plus poussés, l’éminence grise des ludismes de toutes sortes et l’âme de la cité moderne ». Et ceci encore, à la fin de la préface : « L’homme, se convulsant de n’être que lui-même, s’est projeté dans Dionysos : la danse du dieu qui brouille ses propres traces dans une course à l’inconnu, lui donne l’illusion de débarquer à chaque instant du futur. »
Les temps modernes, suivant cette logique, correspondent donc à une entrée dans l’ordre du dionysiaque.
3 – Perspective biblique
Il existe un abîme entre la pensée grecque et la pensée biblique. Examiner ces deux ordres théorisés par Nietzsche à la lumière de la Bible signifie envisager en quoi ce qu’ils représentent peut être relié au message biblique.
Concernant l’ordre apollinien. D’une part, on aura compris que ce concept contient une idée de respect d’un ordre, qui engendre une harmonie. On trouve aussi, dans la Bible, la notion de cadre créationnel, lié au Dieu Créateur qui, dès l’origine, fixe des limites, tant à l’univers qu’à l’être humain. Respecter ces limites mène à la vie, tandis que leur transgression conduit à la mort. Cet aspect-là est positif. Mais, d’autre part, il est nécessaire de bien différencier les Grecs de la Bible. Pour eux, le principe rationnel organisateur du monde est le Logos : un principe abstrait qui, dans la Bible, chez Jean, devient le Logos, incarné, qui « soutient le monde par sa parole puissante » (Hébreux 1:3). Ce n’est pas en la raison que la Bible encourage l’homme à se confier, d’abord (1). La raison est bonne mais l’homme est appelé à vivre par la foi au Logos de Vie.
Quant à l’ordre dionysiaque, il semble bien avoir pour fonction d’exprimer la réalité d’une sorte de pulsion de transgression des limites, qui pousse les hommes à la destruction, voire à l’auto-destruction. Comment ne pas y voir un lien avec le Destructeur, ennemi de Dieu dès le commencement, et avec les puissances démoniaques ? Le basculement de la modernité dans le dionysiaque correspondrait donc, aussi, à une sorte de déverrouillage, rendant possible l’afflux du démoniaque, sous des formes et dans des domaines multiples, et souvent trompeuses (prendre le mal pour le bien).
Il revient à chaque époque de choisir ses dieux, ou ses démons !
1 – 1 Corinthiens 1 :22 « Les Grecs cherchent la sagesse. »
Pour aller plus loin :
- Vidéo : « Nietzsche – L’apollinien et le dionysiaque » (14 minutes)
- Wikipédia : Présentation de Jean Brun