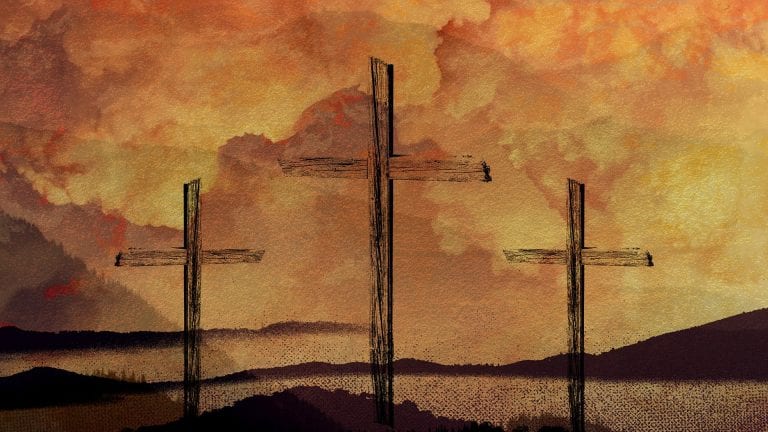En 2013, suite à la démission spectaculaire du pape Benoît XVI et à l’élection du cardinal Jorge Mario Bergoglio comme pape François, l’Église catholique romaine traversait une période de chaos. Elle était empêtrée dans des scandales sexuels, la corruption financière, des attitudes négatives des médias et une opinion publique en baisse. The Promise of Francis: The Man, the Pope, and the Challenge of Change [La Promesse de François : l’Homme, le Pape et le Défi du Changement] du correspondant de la BBC au Vatican, David Willey, exprimait un souhait largement répandu dans les cercles catholiques. Le pape François avait été élu « du bout du monde » pour apporter le changement.
Le pape François a secoué le monde catholique avec un tourbillon de changements : dans les symboles (portant une croix en métal argenté), dans le statut (vivant dans un appartement simple à Sainte-Marthe), dans le langage (parlant comme un curé de campagne), dans la posture (accessible à tous), dans le ton (relationnel et chaleureux), dans le style (non diplomatique et direct), dans l’ouverture pastorale (bénissant les personnes homosexuelles et admettant les personnes divorcées à l’Eucharistie).
Après quelques années de pontificat du pape François, le chroniqueur du New York Times, Ross Douthat, a écrit To Change the Church [Changer l’Église], un livre qui exprimait des inquiétudes quant aux perturbations théologiques que le pape avait provoquées et aux divisions qui en résultaient. Certains cercles traditionalistes ont réagi vivement au pape François car ils voyaient le danger de perdre les éléments romains représentés par les enseignements et les pratiques bien établis de l’Église. Des théologiens catholiques romains de haut rang n’osaient pas le qualifier d’« hérétique ». Ils craignaient que le Catholique n’avale le Romain.
Les changements introduits par le pape François sont devenus controversés, transformant les grandes attentes du début de son pontificat en développements déroutants vers sa fin.
Défiant les Attentes
D’une formation théologique éclectique et inachevée, argentin et non académique, le pape François a immédiatement montré sa frustration face à l’attitude de maintenance de l’Église, à la rigidité des schémas et modèles traditionnels, et au cléricalisme de la culture ecclésiastique. Il a démontré sa frustration en utilisant un langage plus pastoral et en essayant de mettre en œuvre des modes de pensée polyédriques plutôt que descendants.
Le monde théologique du pape François était peuplé de mots et d’expressions comme « théologie du peuple », « conversion missionnaire », « miséricorde », « synodalité », « conversion écologique », et « fraternité ». Tous ne sont pas des termes nouveaux ; certains étaient déjà utilisés dans l’enseignement catholique romain mais ont reçu une nouvelle nuance ou une signification distincte par le pape François.
Il est également devenu le porte-parole des religions mondiales sur des questions comme la migration, l’environnement et la paix, mais moins sur des questions comme la protection de la vie dans l’utérus.
Un catholicisme Romain « fluide »
Le pape François mettait l’accent sur les relations plutôt que sur la doctrine.
Tous ces points de discussion s’inscrivaient dans le contexte de sa compréhension du dialogue interreligieux : Le pape François mettait l’accent sur les relations plutôt que sur la doctrine.
S’exprimant sur la promotion de l’unité chrétienne, le pape François a proposé cette stratégie : « Mettons tous les théologiens sur une île et laissons-les débattre entre eux, ainsi pourrions-nous avancer en paix. » Pour lui, les conversations théologiques étaient presque une perte de temps. Son approche de l’œcuménisme était façonnée comme « marcher ensemble, prier ensemble et travailler ensemble » plutôt que par des discussions théologiques cherchant un accord doctrinal. C’était un « œcuménisme spirituel ». Il a utilisé la même approche avec les protestants libéraux, les évangéliques, les charismatiques de diverses tendances et les orthodoxes orientaux, ainsi qu’avec les communautés de foi non chrétiennes. Son désir d’unité dépassait les cercles chrétiens.
Le pape François a souligné l’unité de l’humanité au-delà des frontières ecclésiales étroites et même religieuses. En 2020, il a publié une encyclique (l’enseignement le plus autoritaire d’un pape) sur la fraternité universelle. Ce document, Fratelli Tutti [Tous Frères], a consolidé l’idée que l’Église catholique romaine est inclusive de tous sur la base d’une humanité commune et partagée, et non sur la base de la repentance et de la foi en Jésus-Christ. Il a régulièrement prié avec des musulmans et des dirigeants d’autres confessions.
Le pape François a mis l’accent sur l’inclusion plutôt que sur la tradition.
Le pape François a mis l’accent sur l’inclusion plutôt que sur la tradition. Il a encouragé son Église à s’adresser aux catholiques divorcés et remariés non pas selon la « lettre » de leur exclusion traditionnelle de la communion, mais en suivant l’« esprit » englobant qui cherche des moyens de les inclure au cas par cas. C’est ce que prévoyait son exhortation post-synodale sur la famille de 2016, Amoris Laetitia.
Le pape François semblait proposer une forme « fluide » du catholicisme romain.
Nous devrions comprendre ce qui s’est passé avec le pape François dans le contexte des tensions entre les pôles Romain et Catholique au sein du catholicisme romain. Le pape François a fortement poussé l’agenda « catholique » de Rome – embrassant tout, affirmant tout et élargissant les frontières traditionnelles de l’Église.
Qui Sera le Prochain : Jean XXIV ?
Le « changement » apporté par le pape François sera-t-il poursuivi par le prochain pape ? Dans l’avion papal revenant de Mongolie à Rome en 2023, le pape François a fait allusion à son possible successeur. Il n’a pas fait référence à un individu spécifique, mais il a proposé le nom papal de Jean XXIV comme celui qu’il souhaiterait que le prochain pape puisse prendre.
Au cours de ses 12 années de mandat, le pape François a façonné le prochain conclave (c’est-à-dire l’assemblée des cardinaux qui éliront le prochain pape) en en nommant 75 %. La plupart des nouveaux cardinaux sont des amis du pape François et des personnes partageant les mêmes idées. Pourquoi « Jean XXIV » alors ? Jean XXIII est connu comme le « bon pape » – il était accessible, gentil, chaleureux et humble. Il a convoqué le Concile Vatican II en 1959 ; le concile n’a commencé qu’en 1962, et Jean XXIII est décédé pendant celui-ci.
Vatican II est l’événement décisif dans l’Église catholique romaine d’aujourd’hui. Lors du concile, Rome a commencé à minimiser son insistance séculaire sur les aspects « romains » de son identité (par exemple, la hiérarchie, l’adhésion complète au catéchisme, la soumission à l’autorité ecclésiastique) et à souligner ses aspirations « catholiques » (par exemple, l’inclusion, l’embrassement, l’absorption). Le pape François se considérait comme promulguant et mettant en œuvre cet aspect de Vatican II. Un pape de type Jean XXIII favoriserait la fraternité universelle dans les relations œcuméniques, interconfessionnelles et sociales tout en préservant l’unité catholique.
Le changement apporté par le pape François n’a pas favorisé un mouvement « évangélique » dans l’Église romaine. Il a rendu son Église plus « catholique » et moins romaine, mais pas plus biblique. Peu importe qui sera le prochain pape, le besoin d’une réforme biblique sera plus pertinent que jamais.