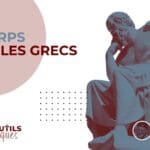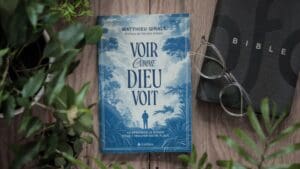Le Christ dans la culture contemporaine
Le processus de sécularisation, amorcé depuis longtemps dans la culture française, et plus largement, en Europe, se poursuit. On tend ainsi à faire disparaître la référence au Christ, au niveau des institutions, par exemple. Et dans le domaine de la culture, il devient de plus en plus rare, depuis les années 2000, que Christ soit au centre d’une création – comme ce fut le cas, en Italie en 1964, avec le film de Pasolini L’Evangile selon Saint-Matthieu. Pour autant, il n’a pas disparu totalement, et il m’a semblé intéressant d’aller regarder de plus près certaines œuvres contemporaines (théâtre ; roman ; poésie ; philosophie…) centrées sur le Christ, afin de voir quel éclairage était porté sur lui.
Jean-Michel BLOCH
François Cheng (né en 1929) a été un passeur extraordinaire de la culture chinoise, en France. Ses talents d’essayiste, de poète, de romancier, ont été consacrés par son élection à l’Académie Française, en 2002. A-t-on raison de chercher le Christ dans l’œuvre de cet homme, venu d’un tout autre horizon culturel, et imprégné par le taoïsme ?
François Cheng et la voie chrétienne
En 1969, deux ans avant d’être naturalisé français, il a reçu le baptême, dans l’église catholique, et s’il a choisi le prénom de François, c’est en hommage à François d’Assise. Mais que représente le Christ pour lui ? « A un moment donné, j’ai compris qu’au sein de l’humanité, il avait fallu que quelqu’un vînt pour dévisager le mal absolu et envisager le bien absolu et le prendre en charge, cela au prix de sa vie, offerte comme un don total, afin de démontrer que le bien absolu est possible, que l’absurdité et le désespoir ne sont pas notre issue ; C’est ce qu’on appelle une vérité incarnée ; c’est ce qu’a accompli le Christ, en qui le bien absolu s’était manifesté comme amour absolu. (…) Que cet accomplissement fût porté par le divin, qu’il révélât par-là la part divine de la destinée humaine, c’est une vision que j’accepte aussi. C’est dire que j’épouse volontiers la voie christique. » [1] Il a été encore plus clair : « Je n’ai jamais refusé qu’on me considère comme un chrétien ou un catholique. Simplement il y a le fait que cette appellation offre, dans l’esprit des gens, une image souvent trop conventionnelle, trop figée.» [2] Par conséquent, « J’ai embrassé la voie christique, voilà la formule la plus juste, en ce qui me concerne. » [2]
Qu’est-ce que Cheng entend exactement par « la voie christique » ? « La voie christique comprend toute la vie qu’a vécue le Christ, depuis sa naissance jusqu’à sa mort, avec tout un ensemble de paroles et d’actes. Et, en même temps, cette idée de voie a été proposée par le Christ lui-même. C’est-à-dire que toute cette expérience et cette proposition forment une voie qui continue. Épouser la voie christique, c’est entrer dans le devenir de cette voie. Et pour moi, dans la voie christique, nos désirs et nos espérances, nos épreuves et nos souffrances ne sont pas seulement des données objectives, ils sont incarnés et pris en charge. Ils trouvent leur réponse dans l’Amour absolu. » [3]
Un poème
« Parfois tu salues
Là-bas
L’homme cloué immobile
L’homme enseignant et saignant
Qui n’aura de cesse
( A ton instar )
De redonner vie
Au bois mort. » [4]
La poésie de Cheng est parsemée de références à l’Évangile, comme en témoigne encore ce fragment d’un autre texte : « Eau contre sang, soif contre soif, / Jaillit le vin – vigne d’oubli. / Vin d’eau, de sang, en quelles noces / D’homme mort et de terre vive ? / Vin d’alliance… » [5] On pense, bien sûr, aux noces de Cana, où Jésus changea l’eau en vin, ce vin devenu vin de l’alliance de Dieu avec les hommes, bu lors de la Cène, avant la crucifixion, où Christ eut soif. Pouvoir de transformation de l’homme, qui, par la foi au christ, passe de la mort à la vie. Ses péchés sont pardonnés, oubliés par Dieu. Il devient une « terre vive », où la graine de vie a germé, pour l’éternité. On a bien là, en quelques mots, un cumul de significations. La poésie fait sens autrement que le discours rationnel.
Sur quels aspects du Christ Cheng met-il l’accent ?
Le Christ a révélé l’absolu de l’Amour : « Christ, afin de montrer que l’Amour absolu est possible et qu’aucun mal ne peut l’atteindre, a accepté librement de mourir sur la croix. Ce fut là sans doute un des plus « beaux gestes » que l’humanité ait connus. » [6]
La voie du Christ passé par la souffrance, est une voie d’incarnation, ce que Cheng comprend bien, lui qui, en Chine, a subi les vicissitudes de l’Histoire : « Après avoir connu les extrêmes conditions humaines, lorsque j’ai entendu l’affirmation du Christ : « Je suis la voie, la vérité, la vie », j’ai reconnu là une « voie incarnée » qui donne vérité et vie… » [2]
Le Christ a triomphé de la mort : « Il a fallu que ce corps soit réduit à presque rien, dénudé par un dénuement total, épuré de toutes scories et pesanteurs, pour qu’il puisse redevenir le consolateur. Lui seul est capable maintenant de consoler ; c’est sa manière de triompher de la mort. » [6]
On perçoit le lien de vie qui s’est créé entre Cheng et le Christ.
Il est nourri d’admiration pour ce que sa mort signifie : une victoire sur le mal absolu. Il est vécu comme une intimité partagée avec celui qui a aussi souffert, dans son corps. Cheng trouve en lui cette consolation profonde que seul le Christ peut apporter à celui qui entre avec lui dans une relation d’intimité.
Une œuvre imprégnée par les valeurs de l’Évangile
Depuis le début du 20e s. on ne compte plus les philosophes, écrivains, ou artistes, qui ont choisi de se placer du côté de la Mort, comme seul horizon de l’humain. Ce n’est pas le cas de Cheng. Son œuvre est une œuvre pour-la-vie : « La mort n’est pas notre issue. » (5) Ce positionnement est constamment perceptible, chez Cheng, que ce soit dans ses écrits, ou bien dans ses nombreuses prises de paroles médiatiques. Sa parole cherche toujours à proposer une orientation de vie, positive.
L’œuvre de Cheng est voie, passage : de la mort à la vie : « Toute mort est vie : / désert – oasis » [5] Vie, et lumière : « Vraie lumière, / Celle qui jaillit de la Nuit » [5]
Christ est vie et lumière, qu’il apporte au monde, conformément à l’enseignement évangélique.
« L’heure est venue, Seigneur,
De dévisager la vie
Selon toi, non selon nous.
Accompagne-nous jusqu’au bout
Pour que rien ne soit perdu. » [7]
Cheng aspire, comme tout chrétien, à une vie réorientée par le Christ. Une vie humble : « S’abaisser jusqu’à l’humus, consentir / A être humus même. » [5] Une vie dans l’attente du retour de Christ : « Viendras-tu à l’heure, Seigneur ? » [7]
« Un mot encore
Jailli du flanc
Du corps percé
Pour fixer le jour
Pour sauver la face. » [4]
Le dernier mot, pour Cheng n’est donc pas celui de « mort » mais bien celui de « vie », une vie sauvée, par le sacrifice de Christ.
Une œuvre de proposition
Pas de prosélytisme dans l’œuvre de Cheng. Son positionnement en faveur de la voie christique est indéniable, mais il reste discret. Et je n’ai volontairement pas abordé, ici, un autre aspect essentiel de l’œuvre de Cheng, lié à ses origines, à savoir son attachement à la tradition de pensée taoïste.
Cheng reconnaît l’existence de la nuit, les ténèbres, en nous et hors de nous, et ce qu’il propose, humblement, c’est une sortie vers la lumière de la vie : « … vraie Nuit, / Celle d’où jaillit la lumière. » [5]
Oui, pour Cheng, la lumière jaillit de la nuit.