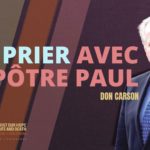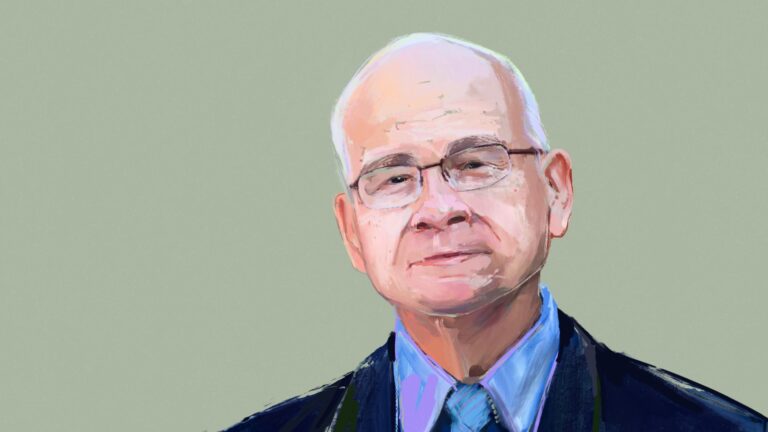Lévitique 23 donne une description des principales « solennités » (v. 2). Celles-ci incluent le sabbat, qui ne nécessitait évidemment pas un pèlerinage à Jérusalem. Les autres fêtes mentionnées sont inséparables du Temple de Jérusalem. Elles sont au nombre de trois, associées à des célébrations (plus tard, les Juifs en ont ajouté une quatrième).
En dehors du sabbat lui-même, la première solennité (ou paire de fêtes) était la Pâque associée à la fête des pains sans levain. La « Pâque pour l’Éternel » commençait entre les deux soirs, le quatorzième jour du premier mois du calendrier juif (nisan), au moment où les Israélites mangeaient le repas pascal et se rassemblaient pour rappeler la sortie spectaculaire du pays d’Égypte. Elle se poursuivait dès le lendemain par la fête des pains sans levain, qui durait une semaine et rappelait non seulement la hâte avec laquelle le peuple avait dû quitter l’Égypte, mais également l’ordre que l’Éternel avait donné de supprimer toute trace de levain pendant cette période. C’était le symbole qu’il fallait rejeter tout mal. Les Israélites ne devaient pas travailler les premier et dernier jours de la fête et répondre à une sainte convocation.
La fête des premiers fruits ou prémices (v. 9-14) était suivie de la fête des semaines (v. 15-22) – les sept semaines qui suivaient immédiatement les premiers fruits et se terminaient en apothéose le cinquantième jour par une sainte convocation. Dans une société principalement agraire, cette fête était un puissant moyen de rappeler que Dieu seul nous donne tout le nécessaire pour vivre. C’était l’occasion de témoigner de notre dépendance de Dieu, d’exprimer notre reconnaissance individuelle et collective à notre Créateur et Pourvoyeur. De nombreux pays protestants (Angleterre, Canada) et beaucoup de communautés évangéliques continuent de consacrer une journée spéciale ou un culte à l’occasion de « la fête des moissons ». La fête américaine du « Thanksgiving » associe à la fête des moissons le rappel de la découverte de la liberté dans un nouveau pays. Mais aucune fête de la reconnaissance ne revêt une importance supérieure à la qualité et à l’ampleur de la gratitude de ceux qui y participent.
Le premier jour du septième mois du calendrier juif, la fête des trompettes ou de la « clameur » (v. 23-25) – avec une sainte convocation – préparait la fête annuelle des expiations (v. 26-32), le Yom Kippour, qui tombait le dixième jour du septième mois. Ce jour-là, le souverain sacrificateur pénétrait dans le lieu très saint avec le sang de l’animal sacrifié conformément aux prescriptions divines, pour expier à la fois ses propres péchés et ceux du peuple (cf. le commentaire proposé pour le 12 avril). Le quinzième jour de ce mois débutait la fête des huttes (v. 33-36) qui durait huit jours ; le peuple devait vivre sous des huttes, des tabernacles ou des tentes pour se rappeler qu’il avait été pèlerin pendant des années avant d’entrer dans le pays promis.
Comment le peuple de la nouvelle alliance peut-il rappeler et célébrer la providence de son grand Dieu ?