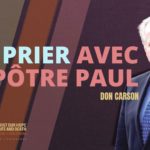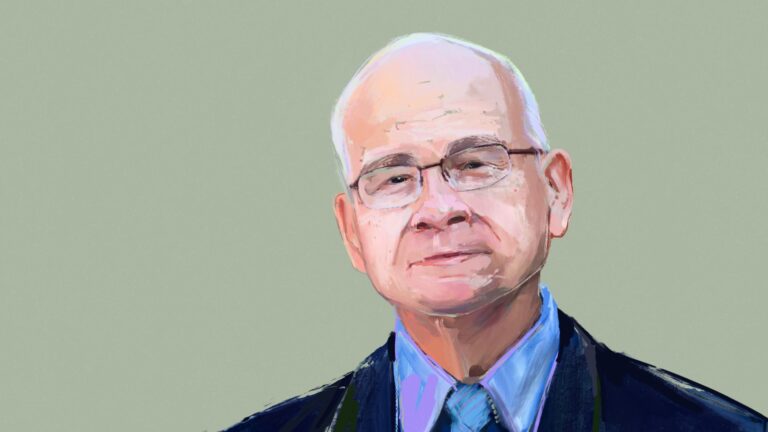En soi, la parabole des dix mines (Luc 19.11-27) est facile à comprendre. En revanche, la manière dont elle est encadrée (par son introduction et sa conclusion) peut interpeller.
1° C’est l’histoire d’un noble qui se rend dans un pays éloigné pour y recevoir l’onction royale. Le tableau ne devait pas surprendre. En effet, les Hérodes se rendaient parfois à Rome pour que César leur confère ou leur confirme l’autorité. Avant de se mettre en route, le noble confie à ses serviteurs dix mines, une somme d’argent considérable, apparemment une mine à chacun. À son retour comme roi, il constate que ses serviteurs ont géré son argent avec des fortunes diverses. La parabole ne mentionne pas le profit récolté par chacun des serviteurs ; elle se limite aux cas significatifs. L’un des serviteurs a gagné dix mines, soit un bénéfice de 1000 % ; un autre cinq mines, soit 500 %. Chacun reçoit une récompense immense, proportionnelle à ses succès. Un serviteur rend tout simplement à son maître la mine que celui-ci lui avait confiée. Il s’excuse en disant qu’il savait que son maître était un homme dur et qu’il avait donc peur de lui. Le reste de l’histoire se déroule comme on pouvait s’y attendre. Nous, lecteurs contemporains, devons savoir que les serviteurs n’étaient pas des employés qui pouvaient quitter leur emploi ou être défendus par des syndicats. C’étaient des esclaves qui devaient le meilleur de leurs efforts à leur maître. Voilà qui explique la sévérité du châtiment infligé à l’esclave irresponsable.
2° L’histoire se termine par une longue déclaration : « Je vous le dis, on donnera à celui qui a, mais à celui qui n’a pas, on ôtera même ce qu’il m a. Au reste, amenez ici mes ennemis qui n’ont pas voulu que je règne sur eux, et égorgez-les en ma présence » (v. 26-27). Le dernier serviteur n’a rien gagné ; il n’a que ce que le maître lui avait confié au départ. Les serviteurs du
maître sont tenus de travailler pour son profit ; s’ils ne le font pas, ils agissent comme des esclaves rebelles et non comme de vrais serviteurs. Ils ne valent pratiquement pas mieux que les ennemis qui refusaient complètement la royauté du maître.
3° Il convient de replacer tout cela dans le cadre de l’attente éveillée par le premier verset de la parabole (v. 11). Jésus la raconte pour répondre à ceux qui pensaient « que le royaume de Dieu devait apparaître à l’instant ». Par ce récit, Jésus fait comprendre que ce n’est pas le cas : le maître s’en va pour recevoir le royaume. Certaines personnes se révoltent contre cette idée. Même ses serviteurs adoptent différentes attitudes quant à leur fidélité et à leur efficacité ; certains se révèlent même être de faux serviteurs. Ceux qui sont vraiment des esclaves dévoués au roi Jésus s’affaireront et s’efforceront d’augmenter les biens de leur Maître, dans l’attente impatiente de son retour.