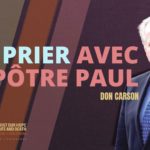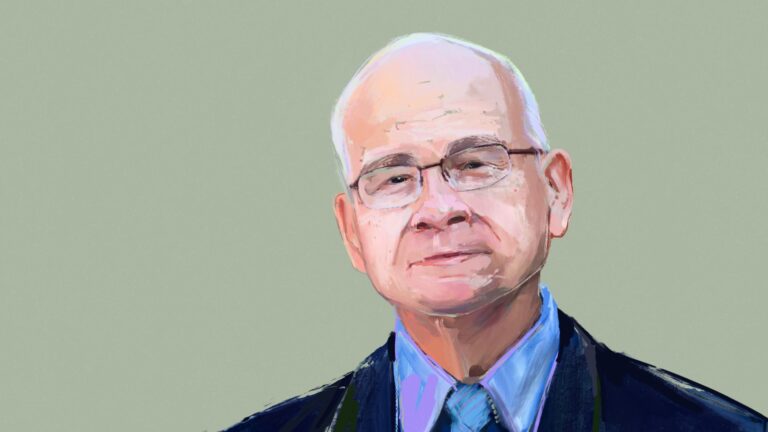Les psaumes historiques de l’Ancien Testament offrent quantité d’exemples où les auteurs rappellent l’histoire des Israélites dans un but théologique ou éthique particulier. C’est notamment le cas lorsque 1 et 2 Chroniques reprennent 1 et 2 Samuel et 1 et 2 Rois en insistant sur le royaume du sud et sur certaines perspectives théologiques. On retrouve cette habitude dans certains sermons du Nouveau Testament. À Antioche de Pisidie, Paul commence par rappeler l’histoire de l’exode et choisit ses arguments historiques pour montrer que Jésus est vraiment le Messie promis (Actes 13.16s ; cf. aussi la méditation du 26 juillet). Ici, dans Actes 7, Étienne, le premier martyr chrétien, commence par l’histoire d’Abraham.
Quels sont les avantages de cette approche ? Et notamment que cherche à prouver Étienne ?
Le rappel historique capte l’attention des auditeurs ; dans le cas présent, l’auditoire était très hostile et avait besoin d’apaisement. Son identité personnelle était fortement liée à son histoire nationale ; au moins au départ, ce rappel historique visait à calmer les esprits et à établir un terrain d’entente, pour montrer qu’Étienne était un homme tout à fait fréquentable. Un autre avantage de cette présentation historique réside dans le fait que le glissement qu’Étienne s’efforçait d’opérer dans la pensée de ses auditeurs juifs était si important que pour l’adopter il fallait une vision transformée du monde. Autrement dit, des Juifs intelligents et réfléchis ne pouvaient pas accepter l’identité de Jésus et encore moins sa mort et sa résurrection s’ils ne saisissaient pas que c’était justement ce que l’Écriture enseignait ; or il était F difficile d’établir cet enseignement sans l’ancrer dans les épisodes historiques de l’Ancien Testament. Voilà pourquoi il fallait raconter et répéter cette histoire pour en souligner les points les plus importants.
En relatant cette histoire, Étienne met en évidence une vérité – la répétition du péché du peuple – qui apparaît d’abord faiblement, puis avec plus de force pour finalement devenir explosive. Au début de sa narration, Étienne ne fait aucune mention du mal qui caractérise Israël. Puis il mentionne brièvement la méchanceté des frères de Joseph (v. 9). Cette méchanceté communautaire refait surface à l’époque de Moïse (v. 25-27, 35). L’allure s’accélère. Les Israélites avaient refusé d’obéir à Moïse et « dans leur cœur ils se tournèrent vers l’Égypte » (v. 39). Étienne évoque ensuite l’épisode du veau d’or et le compare à l’idolâtrie qui sévissait du temps d’Amos (v. 42-43). Il en arrive à l’époque de David et Salomon et déclare avec insistance que Dieu ne peut pas être limité à un édifice. Puis vient la condamnation virulente non seulement des générations passées d’Israélites qui avaient rejeté Dieu et sa révélation, mais aussi de leurs descendants contemporains d’Étienne qui persistent dans leur opposition au Saint-Esprit (v. 51- 53). Quelles leçons pouvons-nous tirer de ce rappel de l’histoire biblique ?