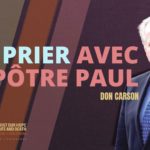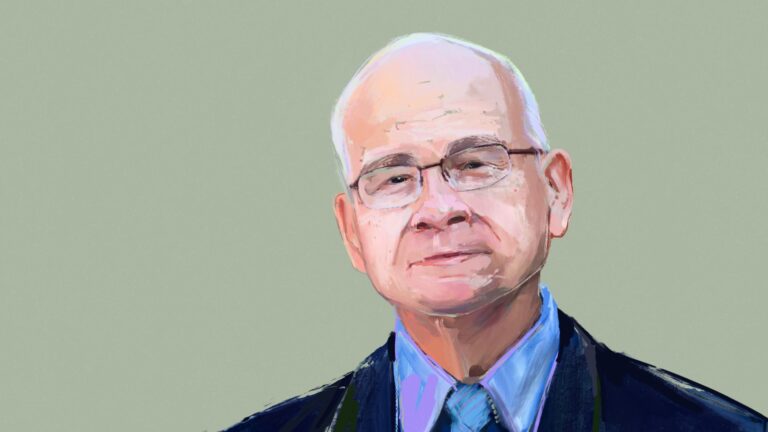Les deux passages proposés à la méditation de ce jour brossent le portrait de deux grands-mères.
Il s’agit d’abord d’Athalie (2 Rois 11), la mère très corrompue d’Ahazia, le roi de Juda mis à mort par Jéhu (comme nous l’avons vu hier), lors de la confusion causée par l’insurrection dans le royaume du nord. On aurait pu imaginer toutes sortes d’actions entreprises par la reine mère en apprenant le meurtre de son fils. Athalie réagit en faisant tuer toute sa famille et s’attribue ainsi un pouvoir absolu ! Elle exerce une telle emprise sur la garde du palais que ses courtisans mettent à mort les enfants et petits-enfants de son fils assassiné, à l’exception de Joas, son petit-fils encore bébé, sauvé par une tante (qui aurait elle-même pu être exécutée). Celle-ci le cache avec sa nourrice.
Quelques années plus tard, alors que Joas est encore un petit garçon d’à peine sept ans, le sacrificateur Yehoyada fait sortir l’enfant de sa cachette et le déclare roi légitime, sous la protection d’unités militaires restées fidèles au sacrificateur et décidées à préserver la lignée davidique. Lorsque Athalie découvre le complot, ses cris de « Conspiration ! » (v. 14) sonnent plutôt creux. Par amour du pouvoir, cette méchante femme avait non seulement commis des crimes (ce qui n’est pas rare), mais surtout a fait périr ses enfants et petits-enfants (une chose beaucoup plus rare et plus ignoble) et maintenant, elle accuse de traîtres ceux qui lui demandent des comptes.
Quel contraste avec la mère et la grand-mère brièvement mentionnées dans 2 Timothée 1.5 ! Loïs, la grand-mère de Timothée, et Eunice, sa mère, sont des femmes de « foi sans hypocrisie », selon Paul, et elles ont transmis cet héritage à Timothée, leur fils et petit-fils. Nous ne savons pas comment elles l’ont fait. Mais à en juger par les modèles présentés ailleurs dans l’Écriture, le moins qu’elles aient pu faire était de présenter au jeune garçon l’exemple d’une vie de piété et de lui donner de saintes instructions. Elles lui ont communiqué l’enseignement de l’Écriture et le modèle de leur « foi sans hypocrisie », pas seulement l’exemple de leur marche avec Dieu, mais aussi l’intégrité qui caractérisait un style de vie résultant de cette foi. Ce passage peut nourrir un grand espoir pour les hommes et les femmes engagés dans des mariages avec un conjoint incroyant. D’après Actes 16.1, Eunice, la mère de Timothée, était juive et chrétienne ; le père du jeune garçon était grec, probablement païen. L’influence chrétienne a prévalu.
Toutes les femmes ne sont pas aussi méchantes qu’Athalie. Toutes ne sont pas animées de la même foi que Loïs et Eunice. Parmi les hommes et les femmes, combien sont davantage intéressés par le pouvoir que par toute autre chose, à la maison, sur le lieu de travail et même à l’église ? Ils ne vont pas jusqu’au meurtre, mais ils mentent, trichent, calomnient pour acquérir plus de pouvoir. Ils devront comparaître devant le tribunal de Dieu et affronter son jugement. Heureux ceux dont la foi sans hypocrisie se transmet à la génération future !