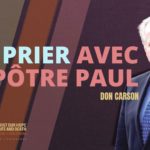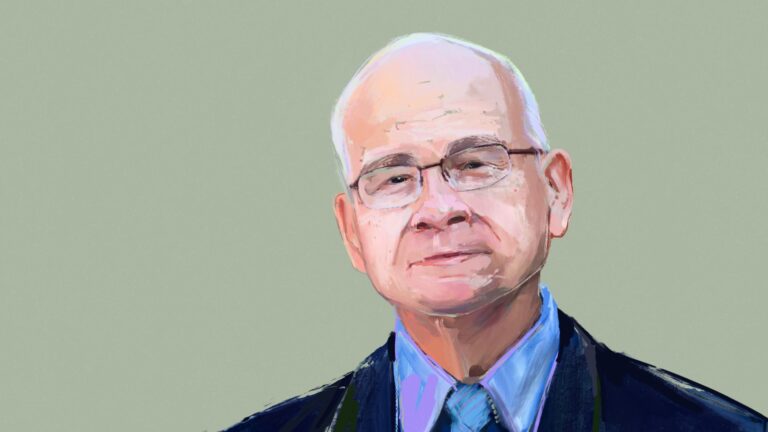Comme son contemporain Aggée, Zacharie est un prophète post-exilique. Si Aggée est vigoureusement intervenu de la part de Dieu pour encourager le peuple à aller de l’avant dans la construction du second Temple, la contribution de Zacharie, plus importante à certains égards, est plus difficile à définir. Ce livre contient des visions apocalyptiques énigmatiques, des passages vraiment difficiles à comprendre, une perspective panoramique. En dépit de leur complexité, les chapitres 9 à 14 constituent la partie de l’Ancien Testament la plus citée dans les récits de la passion des Évangiles canoniques et, après Ézéchiel, la seconde source des nombreuses allusions vétérotestamentaires de l’Apocalypse. Peu de livres prophétiques de l’Ancien Testament ont donné naissance à autant de théories relatives à la multiplicité des auteurs, des théories qui attribuent les chapitres 9 à 14, ou certaines de leurs parties, à des auteurs autres que le Zacharie historique.
Ce n’est pas le lieu d’entrer dans ce débat. Nous nous intéresserons au texte tel qu’il se présente. Nous commencerons par fixer notre attention sur Zacharie 1.1-17.
Les six premiers versets servent d’introduction aux chapitres 1 à 8. La parole de l’Éternel fut adressée à Zacharie en octobre ou novembre 520 av. J.-C. Le but de cette introduction est de rappeler le jugement catastrophique de 587, lorsque Jérusalem et le Temple ont été détruits, quelle était la cause de leur destruction et ce qui l’a suivie. « Revenez à moi […] et je reviendrai à vous » (v. 3) : telle est la leçon qu’il faut apprendre. Le peuple n’avait pas voulu écouter. Il avait donc été déporté en exil et là, il avait commencé à réfléchir plus sérieusement à tous les messages qu’il avait reçus, et la raison lui est revenue : « L’Éternel des armées nous a traités comme il avait résolu de le faire selon notre conduite et nos agissements » (v. 6). La conséquence est évidente : les bénédictions et les jugements de l’alliance sont toujours en vigueur ; le peuple doit s’approcher de Dieu avec respect et une sainte crainte, sous peine de faire la même expérience que ses ancêtres bornés et d’attirer le jugement sur lui.
Interviennent alors huit visions (1.7-6.15), quelquefois rassemblées sous le titre « le livre des visions », qui suivent un schéma plus ou moins classique. Après quelques mots d’introduction, le texte indique ce que le prophète voit. Ce dernier en demande alors la signification à l’ange et celui-ci lui en donne l’explication. Quatre des visions s’accompagnent d’un oracle (1.14-17 ; 2.10-17 ; 4.6-10a ; 6.9-15), souvent à la fin, mais pas toujours. Les huit visions se présentent sous la forme d’un chiasme : la première et la huitième se ressemblent, de même que la deuxième et le septième, et ainsi de suite. Toutes révèlent quelque chose de l’avenir de Jérusalem et de Juda. Que révèle la première ?