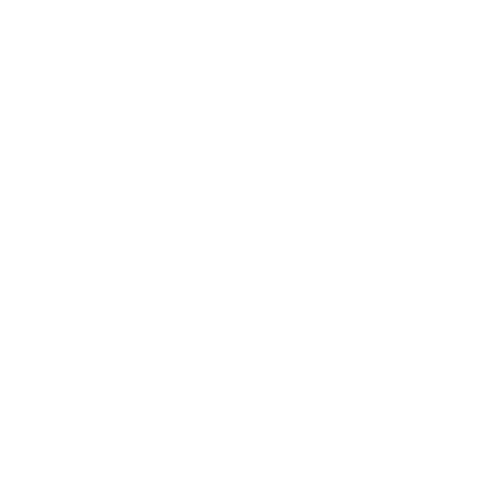Ecouter les chapitres du jour sur le site Audio Bible IBG : Nombres 5 ; Psaumes 39 ; Cantique des cantiques 3 ; Hébreux 3
Si le chapitre 2 du Cantique des cantiques voit la bien-aimée et son fiancé exprimer avec passion leur attachement mutuel et l’exclusivité de leur amour l’un pour l’autre, Cantique des cantiques 3 s’ouvre sur la femme qui cherche frénétiquement son amant. Beaucoup de commentateurs ont suggéré que le chapitre 3, et peut-être toute la partie des chapitres 3 à 6 est un rêve. C’est possible : « Sur ma couche, pendant les nuits, j’ai cherché celui que mon cœur aime » (v. 1, italiques ajoutées), déclare la jeune fille. Dans la première partie (v. 1-5), elle cherche son bien-aimé. Elle s’imagine que, parce qu’elle connaît l’homme qu’elle cherche, tout le monde doit le connaître également, y compris les gardes. Elle finit par le trouver et le ramener dans la maison de sa mère (v. 4), indiquant ainsi la consommation du mariage.
La cohérence de la partie suivante (v. 6-11) est très controversée. Le mieux est de voir dans le pronom démonstratif « celle » (v. 6) la bien-aimée qui est amenée de sa demeure dans le pays à la cour royale. Le voyage s’effectue dans le carrosse royal, luxueux et magnifiquement équipé. Salomon lui-même est présent. Les « filles de Sion » observent et poussent des « hourras ! » au moment où le couple se dirige vers sa nouvelle maison. Le bien-aimé ne peut alors s’empêcher de décrire sa bien-aimée dans un langage extravagant (chap. 4).
Qu’il s’agisse d’un rêve ou non (personnellement je pense que cela en est un), une chose est claire : le langage de l’amour est celui de l’éloge et de l’invitation mutuels. Si la réciprocité fait défaut, l’amour s’étiole. Si la louange et l’invitation ne vont que dans un seul sens, elles s’épuisent avec le temps ou donnent à celui qui les exprime le sentiment de servilité, et il finit aussi par se décourager. Si le langage ne comporte que la louange mais pas d’invitation, il ne favorise jamais l’intimité ; les protagonistes jouissent d’une bonne relation, mais pas de relations sexuelles épanouissantes. Si le langage n’exprime que l’invitation sans faire la louange de l’autre, il risque de dégénérer en satisfaction mutuelle mais sans édification réciproque ; les relations sexuelles sont satisfaisantes, mais la relation personnelle n’est pas bonne.
Beaucoup de couples mariés qui réfléchissent au langage du Cantique des cantiques sont un peu gênés par sa franchise sensuelle. Cette inhibition en dit peut-être davantage sur ce que nous sommes que sur ce que Dieu voudrait que nous soyons. Comme tout ce que Dieu a fait, le mariage, la sexualité et l’intimité peuvent être banalisés, objets d’attentions excessives ou malmenés. Pourtant, Dieu les a créés bons. Dans la mesure où leur nature transformée s’exprime déjà de ce côté-ci des nouveaux cieux et de la nouvelle terre, les croyants doivent manifester la perfection de Dieu et de ses œuvres dans tous les domaines. Nous qui sommes mariés, nous devrions résolument cultiver et développer le langage de la louange et de l’invitation personnelles.
 Don CarsonLe Dieu qui se dévoile
Don CarsonLe Dieu qui se dévoile Fondation du Counseling BlibliqueCôte à côte
Fondation du Counseling BlibliqueCôte à côte Matt MouryThéologie pour tous
Matt MouryThéologie pour tous Paul TrippLe Mot du Mercredi
Paul TrippLe Mot du Mercredi Philippe ViguierPasteur & Compagnie
Philippe ViguierPasteur & Compagnie Michel VincentAu quotidien avec Jésus
Michel VincentAu quotidien avec Jésus SolaSola: La Coalition de l'Évangile, Quebec, Canada
SolaSola: La Coalition de l'Évangile, Quebec, Canada La RébellutionLe blog jeunesse d'Évangile21
La RébellutionLe blog jeunesse d'Évangile21 Accent LouangeLe podcast de Kevin Staufer
Accent LouangeLe podcast de Kevin Staufer KuriousLe podcast de Nathanaël Delforge
KuriousLe podcast de Nathanaël Delforge Parents pour le plaisirLe podcast de Chloé, Rachel & Nico
Parents pour le plaisirLe podcast de Chloé, Rachel & Nico Prédications textuellesUne sélection de prédication par Evangile21
Prédications textuellesUne sélection de prédication par Evangile21 PsautierUne sélection de prédication sur les Psaumes
PsautierUne sélection de prédication sur les Psaumes La boite à outils philosophiquesLe Podcast de Jean-Michel Bloch
La boite à outils philosophiquesLe Podcast de Jean-Michel Bloch