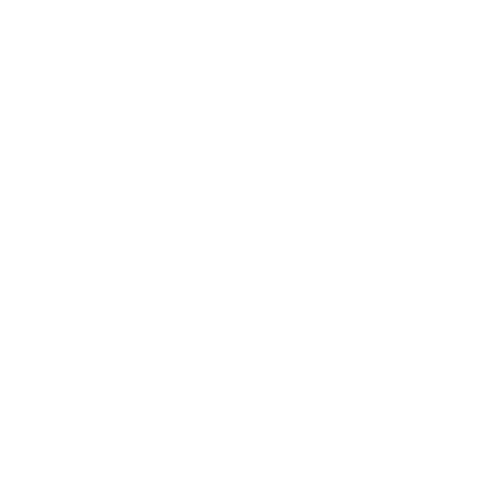251 Alors, la neuvième année du règne de Sédécias, le dixième jour du dixième mois, Nebucadnetsar, le roi de Babylone, vint avec toute son armée attaquer Jérusalem; il installa son camp devant elle et construisit des retranchements tout autour d'elle.2 Le siège de la ville dura jusqu'à la onzième année du règne de Sédécias.3 Le neuvième jour du quatrième mois, la famine était si forte dans la ville qu'il n'y avait plus de pain pour la population du pays.4 Alors on fit une brèche dans les remparts de la ville et tous les hommes de guerre s'enfuirent de nuit en passant par la porte située entre les deux murailles près du jardin du roi, alors même que les Babyloniens encerclaient la ville. Les fuyards prirent le chemin de la plaine.5 Cependant, l'armée babylonienne poursuivit le roi et le rattrapa dans les plaines de Jéricho. Toute son armée se dispersa loin de lui.6 Ils s'emparèrent du roi et le firent monter vers le roi de Babylone à Ribla. On prononça un jugement contre lui.7 Les fils de Sédécias furent égorgés en sa présence, puis on lui creva les yeux, on l'attacha avec des chaînes en bronze et on le conduisit à Babylone.8 Le septième jour du cinquième mois – c'était la dix-neuvième année du règne de Nebucadnetsar sur Babylone – Nebuzaradan, le chef des gardes et le serviteur du roi de Babylone, pénétra dans Jérusalem.9 Il brûla la maison de l'Eternel, le palais royal et toutes les maisons de Jérusalem; il livra aux flammes toutes les maisons d'une certaine importance.10 Toute l'armée babylonienne qui accompagnait le chef des gardes démolit les murailles formant l'enceinte de Jérusalem.11 Nebuzaradan, le chef des gardes, emmena en exil les membres du peuple qui étaient restés dans la ville, ceux qui s'étaient déjà rendus au roi de Babylone et tout le reste de la population.12 Toutefois, le chef des gardes laissa comme vignerons et comme agriculteurs une partie des pauvres du pays.13 Les Babyloniens brisèrent les colonnes en bronze qui étaient dans la maison de l'Eternel, ainsi que les bases et la cuve en bronze qui s'y trouvaient, et ils en emportèrent le bronze à Babylone.14 Ils prirent les cendriers, les pelles, les couteaux, les tasses et tous les ustensiles en bronze qu'on utilisait pour le culte.15 Le chef des gardes prit encore les brûle-parfums et les coupes, aussi bien ce qui était en or que ce qui était en argent.16 Quant aux deux colonnes, à la cuve et aux bases que Salomon avait faites pour la maison de l'Eternel, il était impossible de peser le bronze de tous ces éléments.17 La hauteur d'une colonne était de 9 mètres et il y avait au-dessus un chapiteau en bronze haut d'un mètre et demi; autour du chapiteau il y avait un treillis et des grenades, le tout en bronze; il en allait de même pour la seconde colonne, aussi avec le treillis.18 Le chef des gardes captura le grand-prêtre Seraja, le prêtre adjoint Sophonie et les trois gardiens de l'entrée.19 Dans la ville, il captura un eunuque qui commandait aux hommes de guerre, 5 hommes qui faisaient partie des conseillers du roi et qu'on trouva dans la ville, le secrétaire du chef de l'armée chargé d'enrôler la population du pays, ainsi que 60 hommes pris parmi la population du pays qu'on trouva dans la ville.20 Nebuzaradan, le chef des gardes, les captura et les conduisit vers le roi de Babylone à Ribla,21 et le roi de Babylone les frappa à mort à Ribla, dans le pays de Hamath.22 Nebucadnetsar, le roi de Babylone, plaça le reste du peuple, ceux qu'il laissa dans le pays de Juda, sous l'autorité de Guedalia, le fils d'Achikam et le petit-fils de Shaphan.23 Lorsque tous les chefs des troupes et leurs hommes apprirent que le roi de Babylone avait établi Guedalia comme gouverneur, ils se rendirent vers Guedalia à Mitspa. C'étaient Ismaël, le fils de Nethania, Jochanan, le fils de Karéach, Seraja, le fils de Thanhumeth, de Nethopha, et Jaazania, le fils du Maacathien, ainsi que leurs hommes.24 Guedalia leur fit un serment, à eux et à leurs hommes, et il leur dit: «N'ayez pas peur des serviteurs des Babyloniens. Installez-vous dans le pays, servez le roi de Babylone et tout se passera bien pour vous.»25 Mais le septième mois, Ismaël, le fils de Nethania et le petit-fils d'Elishama, qui était de sang royal, vint en compagnie de 10 hommes et ils frappèrent mortellement Guedalia ainsi que les Juifs et les Babyloniens qui étaient avec lui à Mitspa.26 Alors tout le peuple, du plus petit jusqu'au plus grand, et les chefs des troupes se levèrent et s'en allèrent en Egypte, parce qu'ils avaient peur des Babyloniens.27 La trente-septième année de l'exil de Jojakin, roi de Juda, le vingt-septième jour du douzième mois, Evil-Merodac, le roi de Babylone, releva la tête du roi de Juda Jojakin et le fit sortir de prison. C'était la première année de son règne.28 Il lui parla avec bonté et lui donna une place supérieure à celle des autres rois retenus avec lui à Babylone.29 Il lui fit changer ses habits de prisonnier et Jojakin mangea à sa table tout le reste de sa vie.30 Le roi pourvut constamment à son entretien journalier, durant tout le reste de sa vie.
 Don CarsonLe Dieu qui se dévoile
Don CarsonLe Dieu qui se dévoile Fondation du Counseling BlibliqueCôte à côte
Fondation du Counseling BlibliqueCôte à côte Matt MouryThéologie pour tous
Matt MouryThéologie pour tous Paul TrippLe Mot du Mercredi
Paul TrippLe Mot du Mercredi Philippe ViguierPasteur & Compagnie
Philippe ViguierPasteur & Compagnie Michel VincentAu quotidien avec Jésus
Michel VincentAu quotidien avec Jésus SolaSola: La Coalition de l'Évangile, Quebec, Canada
SolaSola: La Coalition de l'Évangile, Quebec, Canada La RébellutionLe blog jeunesse d'Évangile21
La RébellutionLe blog jeunesse d'Évangile21 Accent LouangeLe podcast de Kevin Staufer
Accent LouangeLe podcast de Kevin Staufer KuriousLe podcast de Nathanaël Delforge
KuriousLe podcast de Nathanaël Delforge Parents pour le plaisirLe podcast de Chloé, Rachel & Nico
Parents pour le plaisirLe podcast de Chloé, Rachel & Nico Prédications textuellesUne sélection de prédication par Evangile21
Prédications textuellesUne sélection de prédication par Evangile21 PsautierUne sélection de prédication sur les Psaumes
PsautierUne sélection de prédication sur les Psaumes La boite à outils philosophiquesLe Podcast de Jean-Michel Bloch
La boite à outils philosophiquesLe Podcast de Jean-Michel Bloch