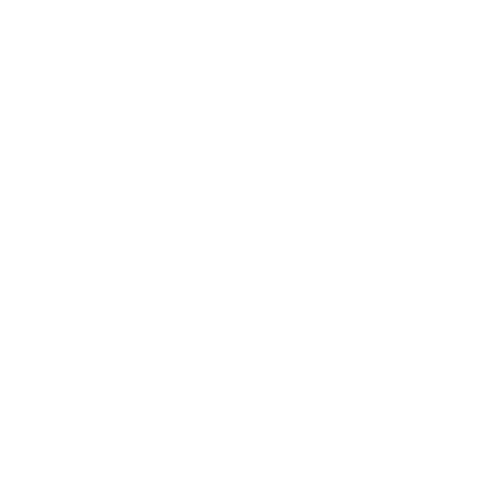Ecouter les chapitres du jour sur le site Audio Bible IBG : Nombres 36 ; Psaumes 80 ; Ésaïe 28 ; 2 Jean
Une lecture cursive de 2 Jean suffit à montrer que l’arrière-plan de cette brève épître recoupe dans une certaine mesure celui de 1 Jean. Les deux épîtres abordent la question de la vérité concernant l’identité de Jésus-Christ. « Car dans le monde sont entrés plusieurs séducteurs, qui ne confessent pas Jésus-Christ venu dans la chair » (v. 7). Paraphrasons en disant que ces séducteurs ne croyaient pas que Jésus fût Christ venu en chair. Ils établissaient une distinction entre le Jésus en chair et en os, et le « Christ » qui l’a habité, et rejetaient donc la doctrine de l’unité essentielle de Jésus-Christ, le Dieu-homme, celui qui était simultanément Fils de Dieu et être humain. Cette hérésie entraînait plusieurs conséquences malheureuses.
Cette aberration doctrinale était liée aux pressions culturelles largement répandues. Ces séducteurs, ces propagateurs d’erreurs estimaient être de grands penseurs, des hommes de progrès. Ils n’avaient pas le sentiment d’examiner la foi chrétienne avec l’intention de nier certaines vérités cardinales, de faire un tri en obéissant à quelque principe obscur. Ils avaient plutôt l’impression d’en donner une interprétation correcte, de faire avancer les chrétiens dans leur connaissance ; ils se considéraient comme des progressistes qui luttaient contre les conservateurs et les traditionalistes à qui ils reprochaient de ne pas comprendre la culture ambiante. C’est pourquoi Jean se moque d’eux et les accuse d’aller plus loin que la vérité : « Quiconque va plus loin et ne demeure pas dans la doctrine du Christ n’a pas Dieu ; celui qui demeure dans la doctrine a le Père et le Fils » (v. 9). La position de Jean ressemble à celle de ce vieux pasteur à qui quelqu’un reprochait de ne pas accueillir les idées dernier cri :
Vous dites que je ne les partage pas.
Mon ami, c’est bien la vérité.
Mais quand je vois ce que je ne partage pas,
Combien je préfère en être privé !
La question fondamentale n’est pas de savoir si nous sommes progressiste ou non, traditionaliste ou non. En effet, nous pouvons être progressiste en bien ou en mal, traditionaliste dans un bon ou un mauvais sens. En soi, ces étiquettes sont souvent réductrices et éclairent rarement les questions difficiles. La vraie question est de savoir si nous nous en tenons à l’Évangile apostolique ou non, si nous persévérons dans la doctrine du Christ ou non. C’est là le test permanent.
Que de mouvements contemporains ratent ce test, soit parce qu’ils vont plus loin que l’Évangile dans leur désir d’être « à la page », soit parce qu’ils se sont figés dans des traditions qui asservissent l’Évangile !
 Don CarsonLe Dieu qui se dévoile
Don CarsonLe Dieu qui se dévoile Fondation du Counseling BlibliqueCôte à côte
Fondation du Counseling BlibliqueCôte à côte Matt MouryThéologie pour tous
Matt MouryThéologie pour tous Paul TrippLe Mot du Mercredi
Paul TrippLe Mot du Mercredi Philippe ViguierPasteur & Compagnie
Philippe ViguierPasteur & Compagnie Michel VincentAu quotidien avec Jésus
Michel VincentAu quotidien avec Jésus SolaSola: La Coalition de l'Évangile, Quebec, Canada
SolaSola: La Coalition de l'Évangile, Quebec, Canada La RébellutionLe blog jeunesse d'Évangile21
La RébellutionLe blog jeunesse d'Évangile21 Accent LouangeLe podcast de Kevin Staufer
Accent LouangeLe podcast de Kevin Staufer KuriousLe podcast de Nathanaël Delforge
KuriousLe podcast de Nathanaël Delforge Parents pour le plaisirLe podcast de Chloé, Rachel & Nico
Parents pour le plaisirLe podcast de Chloé, Rachel & Nico Prédications textuellesUne sélection de prédication par Evangile21
Prédications textuellesUne sélection de prédication par Evangile21 PsautierUne sélection de prédication sur les Psaumes
PsautierUne sélection de prédication sur les Psaumes La boite à outils philosophiquesLe Podcast de Jean-Michel Bloch
La boite à outils philosophiquesLe Podcast de Jean-Michel Bloch