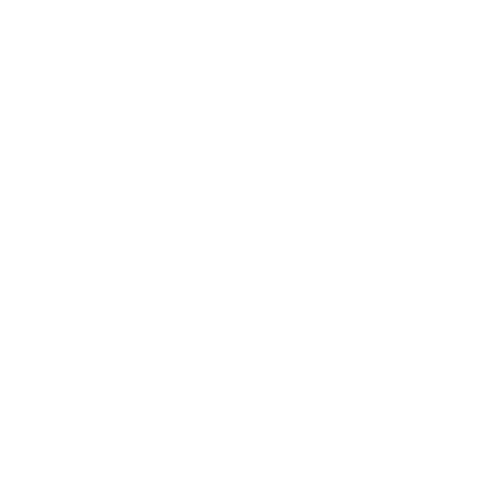101 Jésus partit de là et se rendit dans le territoire de la Judée, de l'autre côté du Jourdain. La foule se rassembla de nouveau près de lui et, conformément à son habitude, il se mit encore à l'enseigner.2 Les pharisiens l'abordèrent et, pour lui tendre un piège, ils lui demandèrent s'il est permis à un homme de divorcer de sa femme.3 Il leur répondit: «Que vous a prescrit Moïse?»4 «Moïse, dirent-ils, nous a permis d'écrire une lettre de divorce et de renvoyer notre femme10.4 Ecrire… notre femme: renvoi à Deutéronome 24.1..»5 Jésus leur dit: «C'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse vous a donné cette règle.6 Mais au commencement de la création, Dieu a fait l'homme et la femme;7 c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère [et s'attachera à sa femme],8 et les deux ne feront qu'un10.6-8 Dieu a fait… qu'un: citation de Genèse 1.27 puis 2.24.. Ainsi, ils ne sont plus deux mais ne font qu'un.9 Que l'homme ne sépare donc pas ce que Dieu a uni.»10 Lorsqu'ils furent dans la maison, les disciples l'interrogèrent encore là-dessus.11 Il leur dit: «Celui qui renvoie sa femme et qui en épouse une autre commet un adultère envers elle,12 et si une femme divorce de son mari et en épouse un autre, elle commet un adultère.»13 Des gens lui amenaient des petits enfants afin qu'il les touche, mais les disciples leur firent des reproches.14 Voyant cela, Jésus fut indigné et leur dit: «Laissez les petits enfants venir à moi et ne les en empêchez pas, car le royaume de Dieu est pour ceux qui leur ressemblent.15 Je vous le dis en vérité: celui qui n'accueille pas le royaume de Dieu comme un petit enfant n'y entrera pas.»16 Puis il les prit dans ses bras et les bénit en posant les mains sur eux.17 Comme Jésus se mettait en chemin, un homme accourut et se jeta à genoux devant lui: «Bon maître, lui demanda-t-il, que dois-je faire pour hériter de la vie éternelle?»18 Jésus lui dit: «Pourquoi m'appelles-tu bon? Personne n'est bon, si ce n'est Dieu seul.19 Tu connais les commandements: Tu ne commettras pas d'adultère; tu ne commettras pas de meurtre; tu ne commettras pas de vol; tu ne porteras pas de faux témoignage; tu ne feras de tort à personne; honore ton père et ta mère10.19 Tu ne commettras… ta mère: citation de cinq des dix commandements (Exode 20.12-16; Deutéronome 5.16-20)..»20 Il lui répondit: «Maître, j'ai respecté tous ces commandements dès ma jeunesse.»21 L'ayant regardé, Jésus l'aima, et il lui dit: «Il te manque une chose: va vendre tout ce que tu as, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens, [charge-toi de la croix] et suis-moi.»22 Mais l'homme s'assombrit à cette parole et s'en alla tout triste, car il avait de grands biens.23 Regardant autour de lui, Jésus dit à ses disciples: «Qu'il est difficile à ceux qui ont des richesses d'entrer dans le royaume de Dieu!»24 Les disciples furent effrayés de ce que Jésus parlait ainsi. Il reprit: «Mes enfants, qu'il est difficile [à ceux qui se confient dans les richesses] d'entrer dans le royaume de Dieu!25 Il est plus facile à un chameau de passer par un trou d'aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu.»26 Les disciples furent encore plus étonnés et se dirent les uns aux autres: «Qui donc peut être sauvé?»27 Jésus les regarda et dit: «Aux hommes cela est impossible, mais non à Dieu, car tout est possible à Dieu.»28 Alors Pierre lui dit: «Nous avons tout quitté et nous t'avons suivi.»29 Jésus répondit: «Je vous le dis en vérité, personne n'aura quitté à cause de moi et à cause de la bonne nouvelle sa maison ou ses frères, ses sœurs, sa mère, son père, [sa femme,] ses enfants ou ses terres,30 sans recevoir au centuple, dans le temps présent, des maisons, des frères, des sœurs, des mères, des enfants et des terres, avec des persécutions et, dans le monde à venir, la vie éternelle.31 Bien des premiers seront les derniers et bien des derniers seront les premiers.»32 Ils étaient en chemin pour monter à Jérusalem et Jésus allait devant eux. Les disciples étaient effrayés et ceux qui le suivaient étaient dans la crainte. Jésus prit de nouveau les douze avec lui et commença à leur dire ce qui devait lui arriver:33 «Nous montons à Jérusalem et le Fils de l'homme sera livré aux chefs des prêtres et aux spécialistes de la loi. Ils le condamneront à mort et le livreront aux non-Juifs.34 Ils se moqueront de lui, cracheront sur lui, le fouetteront et le feront mourir, et trois jours après il ressuscitera.»35 Jacques et Jean, les fils de Zébédée, s'approchèrent de Jésus et lui dirent: «Maître, nous voudrions que tu fasses pour nous ce que nous te demanderons.»36 Il leur dit: «Que voulez-vous que je fasse pour vous?»37 «Accorde-nous, lui dirent-ils, d'être assis l'un à ta droite et l'autre à ta gauche, quand tu seras dans ta gloire.»38 Jésus leur répondit: «Vous ne savez pas ce que vous demandez. Pouvez-vous boire la coupe que je vais boire ou être baptisés du baptême dont je vais être baptisé?» «Nous le pouvons», dirent-ils.39 Jésus leur répondit: «Vous boirez en effet la coupe que je vais boire et vous serez baptisés du baptême dont je vais être baptisé.40 Mais quant à être assis à ma droite ou à ma gauche, cela ne dépend pas de moi et ne sera donné qu'à ceux pour qui cela est préparé.»41 Après avoir entendu cela, les dix autres commencèrent à s'indigner contre Jacques et Jean.42 Jésus les appela et leur dit: «Vous savez que ceux que l'on considère comme les chefs des nations dominent sur elles et que leurs grands les tiennent sous leur pouvoir.43 Ce n'est pas le cas au milieu de vous, mais si quelqu'un veut être grand parmi vous, il sera votre serviteur;44 et si quelqu'un veut être le premier parmi vous, qu'il soit l'esclave de tous.45 En effet, le Fils de l'homme est venu non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour beaucoup.»46 Ils arrivèrent à Jéricho. Lorsque Jésus sortit de la ville avec ses disciples et une assez grande foule, Bartimée, le fils aveugle de Timée, était assis en train de mendier au bord du chemin.47 Il entendit que c'était Jésus de Nazareth et se mit à crier: «Fils de David10.47 Fils de David: titre donné au Messie, le Sauveur attendu par les Juifs, sur la base notamment de 2 Samuel 7.12-16; Esaïe 9.5-6., Jésus, aie pitié de moi!»48 Beaucoup le reprenaient pour le faire taire, mais il criait beaucoup plus fort: «Fils de David, aie pitié de moi!»49 Jésus s'arrêta et dit: «Appelez-le.» Ils appelèrent l'aveugle en lui disant: «Prends courage, lève-toi, il t'appelle.»50 L'aveugle jeta son manteau et, se levant d'un bond, vint vers Jésus.51 Jésus prit la parole et lui dit: «Que veux-tu que je fasse pour toi?» «Mon maître, lui répondit l'aveugle, que je retrouve la vue.»52 Jésus lui dit: «Vas-y, ta foi t'a sauvé.» Aussitôt il retrouva la vue et il suivit Jésus sur le chemin.
 Don CarsonLe Dieu qui se dévoile
Don CarsonLe Dieu qui se dévoile Fondation du Counseling BlibliqueCôte à côte
Fondation du Counseling BlibliqueCôte à côte Matt MouryThéologie pour tous
Matt MouryThéologie pour tous Paul TrippLe Mot du Mercredi
Paul TrippLe Mot du Mercredi Philippe ViguierPasteur & Compagnie
Philippe ViguierPasteur & Compagnie Michel VincentAu quotidien avec Jésus
Michel VincentAu quotidien avec Jésus SolaSola: La Coalition de l'Évangile, Quebec, Canada
SolaSola: La Coalition de l'Évangile, Quebec, Canada La RébellutionLe blog jeunesse d'Évangile21
La RébellutionLe blog jeunesse d'Évangile21 Accent LouangeLe podcast de Kevin Staufer
Accent LouangeLe podcast de Kevin Staufer KuriousLe podcast de Nathanaël Delforge
KuriousLe podcast de Nathanaël Delforge Parents pour le plaisirLe podcast de Chloé, Rachel & Nico
Parents pour le plaisirLe podcast de Chloé, Rachel & Nico Prédications textuellesUne sélection de prédication par Evangile21
Prédications textuellesUne sélection de prédication par Evangile21 PsautierUne sélection de prédication sur les Psaumes
PsautierUne sélection de prédication sur les Psaumes La boite à outils philosophiquesLe Podcast de Jean-Michel Bloch
La boite à outils philosophiquesLe Podcast de Jean-Michel Bloch