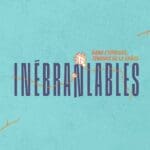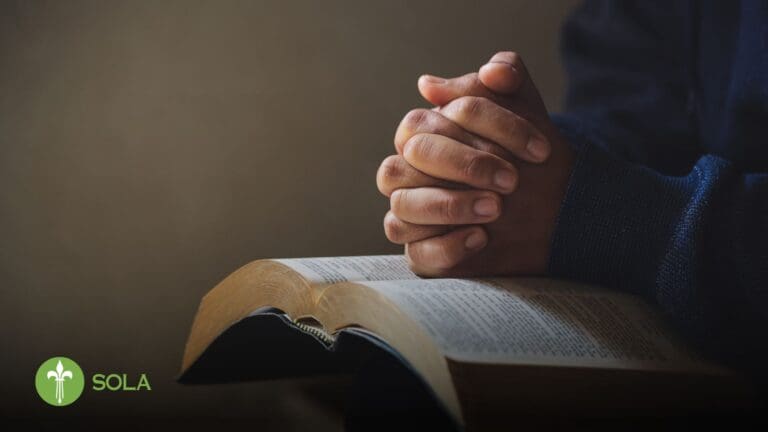Ichtus N°19 – Janvier 1972 – Pages 8 à 12 et 21
« Baptiser de (ou dans) l’Esprit Saint » : la formule n’est pas très fréquente dans l’Écriture, mais elle est devenue le « drapeau » de nombreux chrétiens évangéliques. Ils sont convaincus qu’elle désigne une seconde expérience de la vie chrétienne, comme une autre nouvelle naissance, et que cette expérience ouvre seule l’accès à la plénitude des dons de Dieu. II y a, pour eux, des chrétiens baptisés du Saint-Esprit et d’autres qui ne le sont pas. Les premiers y ont trouvé de telles richesses qu’ils poussent naturellement les autres à rechercher la même bénédiction. Ajoutons que, pour la plupart, ils considèrent le parler en langues comme le signe indispensable : si vous n’avez pas parlé en langues, vous n’avez pas été baptisé dans l’Esprit.
II manquait une étude biblique très fouillée de ce sujet. L’an dernier ont paru en anglais deux ouvrages d’importance décisive. Ils constituent l’apport le plus marquant à la doctrine du Saint-Esprit depuis Swete en 1909. Leur publication me semble un don de Dieu à son peuple, en ces temps de recherche ardente. Plutôt que d’exposer directement comment je comprends l’enseignement biblique, dans un résumé forcément trop court, je crois plus utile de présenter ces deux livres : Une théologie du Saint-Esprit, par Frederick Bruner, et Le Baptême dans le Saint-Esprit, par James Dunn.
Deux avertissements, toutefois, s’imposent. Méfions-nous, d’abord, du piège des étiquettes. On appelle couramment « pentecôtistes » ceux qui voient dans le baptême du Saint-Esprit une seconde expérience, signalée par le parler en langues ; cet article emploiera aussi cette désignation commode, généralement justifiée. II faut savoir, cependant, que les étiquettes ne collent plus toujours très bien. S’il y a depuis dix ans des presbytériens, des baptistes, etc., qui sont devenus « néo-pentecôtistes », il y a aussi dans les Eglises dites de Pentecôte, des responsables qui ne séparent plus naissance en Christ et baptême d’Esprit, et qui n’exigent plus le parler en langues de tous. Toute une branche influente du pentecôtisme allemand (le mouvement de Mülheim) est venue, par l’étude biblique, à cette position amendée. Quand nous parlerons de « pentecôtisme », il ne s’agira donc pas de critiquer des Eglises ou un mouvement, mais une doctrine.
Rappelons-nous ensuite une vérité très générale : l’expérience est une chose, son interprétation en est une autre. Certes, quand on se trompe sur le nom et sur le sens de ce qu’on vit, ce n’est pas sans dommage : le témoignage biblique est déformé, et l’expérience aussi, par contre-coup. II reste que l’expérience pouvait être authentique, et qu’elle a pu faire du bien. Contester l’interprétation « pentecôtiste » du baptême du Saint-Esprit, ce n’est en aucun cas mépriser et condamner tout ce que des frères ont appelé de ce nom.
Dûment avertis, nous sommes prêts à écouter Bruner et Dunn.
Un coup d’œil comparatif
Les deux ouvrages, tout à fait indépendants, ont plus d’un point commun. Ce sont tous les deux des thèses de doctorat remaniées, fruits de plusieurs années de labeur (on est loin d’un certain journalisme facile). Bruner a soutenu la sienne à Hambourg, et son horizon est assez germanique ; Dunn, à Cambridge, où il a travaillé avec C.F.D. Moule. Les deux jeunes théologiens enseignent maintenant : le premier aux Philippines, le second à l’Université de Nottingham.
Tous deux démontrent une connaissance approfondie du pentecôtisme : de ses livres et de sa réalité vécue. La jaquette de l’ouvrage de Bruner assure qu’il s’est mêlé aux réunions pentecôtistes, qu’il a observé de près l’expérience dont on lui parlait, sans préjugé ni prévention ; quelques notes du livre de Dunn (confirmées par une information personnelle) suggèrent que Dunn a connu de l’intérieur les milieux pentecôtistes, et s’est engagé davantage que Bruner dans « l’expérience ».
Tous deux travaillent dans le cadre universitaire courant ; ils emploient une méthode critique, mais ils s’arrangent pour le faire sans léser les textes. Nous aurions préféré qu’ils affichent davantage leur respect évangélique de l’Écriture, et nous déplorons quelques petites concessions, surtout chez Bruner. Dans l’ensemble, cependant, ils s’appuient fermement sur le Nouveau Testament, et la valeur de leur travail n’est pas entamée.
Tous deux, enfin, atteignent une même conclusion, avec une entière netteté. Annonçons la couleur ! Pour Bruner comme pour Dunn, le Nouveau Testament ne connaît aucun autre baptême de l’Esprit que la conversion-initiation chrétienne ; la doctrine qu’on appelle pentecôtiste n’est pas, sur ce point, biblique.
Qu’on ne s’imagine pas que les deux livres fassent double emploi ! Ils ont aussi leurs différences. Le premier se classe dans le casier « science missionnaire », et le second « exégèse systématique ». Le projet de Bruner est vaste : étude du pentecôtisme, considérations théologiques, doctrine des charismes. Dunn, au contraire, se concentre et fouille plus profond. On pourrait continuer : tempéraments dissemblables, talents inégaux, orientations parfois opposées… Regardons-y de plus près.
BRUNER : réaction luthérienne (d’un réformé)
Bruner commence par décrire et raconter. Le premier tiers de son livre (et ce n’est pas le moins utile), fait la généalogie, puis le portrait, du pentecôtisme. Le pentecôtisme prolonge la ligne Wesley-Finney-Torrey : au XVIIIe siècle, la « seconde bénédiction » concerne la sanctification ; au XIXe siècle, l’idée de puissance s’y associe jusqu’à devenir prédominante, et le nom de « baptême du Saint-Esprit » s’impose ; au XXe siècle le pentecôtisme ajoute le signe obligatoire du parler en langues.
Bruner note que le langage pentecôtiste reste assez confus : le baptême n’est pas bien distingué de la plénitude ; la même (seconde) expérience porte souvent le nom de don, ou de réception, du Saint-Esprit, bien que la plupart des pentecôtistes reconnaissent un premier don de l’Esprit à la conversion (à cause de Rom. 8:9 — ils expliquent alors qu’il manque la pleine mesure, ou la puissance). Bruner s’intéresse au moteur de la spiritualité pentecôtiste : le désir de plus. II développe la doctrine des conditions à remplir pour recevoir le baptême du Saint-Esprit : obéissance totale, foi entière, vide intérieur, recherche tendue (comme dans les réunions d’attente). II cite le résumé frappant : « Pécheurs, nous recevons le Christ ; saints, nous recevons l’Esprit » (de Pearlman, cite p. 95). Dans toute cette partie, richement documentée, Bruner s’abstient de juger ; il restitue si fidèlement le plaidoyer pentecôtiste qu’on pourrait le croire sympathisant.
On est d’autant plus surpris quand on passe, à la suite, à l’évaluation. Bruner ne mâche pas sa critique. Son zèle lui donne presque l’air agressif, je le regrette, et lui fait sacrifier des nuances.
Bien que presbytérien, Bruner réagit comme Luther. C’est le « sola fide » qu’il voit menacé par le pentecôtisme. II dénonce le légalisme caché de la doctrine des conditions : la foi entière que les pentecôtistes réclament n’est plus la foi du Nouveau Testament, mais un effort mystique surhumain ; l’accent sur le prix à payer annule la prédication de la grâce. Bruner exagère-t-il ? II ne me paraît pas reconnaître assez le paradoxe de l’Évangile, le paradoxe du prix de la grâce, de l’exigence conjointe au don. Mais sur le fond, j’avoue : touché — et je ne pense pas seulement au pentecôtisme, mais à notre piété « évangélique », souvent.
Les super-spirituels de Corinthe
Au légalisme, déjà au temps apostolique, s’enchevêtre le gnosticisme. Les gnostiques se vantaient d’une « connaissance » supérieure à la simple foi, connaissance-expérience plus mystique que rationnelle. Ils faisaient ainsi deux catégories de chrétiens. Bruner trouve que les pentecôtistes de notre temps leur ressemblent étrangement. La partie la plus forte de son livre reprend plusieurs grandes épîtres de Paul, aux Galates, aux Colossiens, aux Corinthiens surtout ; il les applique de façon saisissante au problème du pentecôtisme aujourd’hui. Bruner décèle chez les adversaires de Paul à Corinthe, justement les traits qu’il a remarqués dans sa première partie : le goût du ravissement mystique, déjà typique du paganisme grec (cf. I Cor. 12:2) ; la recherche de la puissance ; le désir de plus et la prétention au rang de super-spirituel (la préposition hyper est caractéristique des épîtres aux Corinthiens).
Même si la charge est trop violente, comment ne pas être bouleversé en lisant ces pages ? Bruner pose à nos frères pentecôtistes des questions très graves.
Et pourtant, je crains qu’ils ne trouvent un très bon prétexte pour ne pas l’écouter : les faiblesses de son exégèse.
Qui veut trop prouver …
Bruner passe en revue les principaux passages bibliques en cause. Or, s’il abonde en aperçus stimulants, il saute plus d’une fois par-dessus les difficultés ; il affirme souvent quand il faudrait prouver, ou bien il affirme plus qu’il n’a prouvé. Ainsi, à propos de Corneille et du parler en langues qui a marqué sa conversion, il remarque judicieusement le commentaire de Pierre : la chose s’est passée « comme au commencement pour nous aussi » (Actes 11:15), et non pas : « Comme toujours et partout quand un croyant reçoit l’Esprit ». Mais Bruner va trop loin quand il fait de la surprise des croyants juifs (Actes 10:45) la preuve que le parler en langues était tout à fait inhabituel (pp. 191 s.) : en effet, les croyants juifs ne s’étonnent pas qu’il soit accordé, mais qu’il soit accordé aux païens. Bruner avait assez de bonnes et solides raisons pour éviter ces abus d’exégèse.
La plus grande faiblesse de la thèse de Bruner, cependant, c’est le lien étroit qui enchaîne chez lui le baptême d’Esprit au baptême d’eau. Pour lui, il n’y a pas deux baptêmes. Sa présentation reste d’ailleurs flottante : il parle du baptême d’eau tantôt comme du « lieu », tantôt comme du « moyen », tantôt comme du « sceau » de la communication d’Esprit, sans se soucier d’harmoniser ces vues divergentes. II ne se justifie par aucune exégèse, mais par un vague principe d’« incarnation ». II tombe dans la rhétorique creuse. II est triste qu’il puisse se réclamer de quelques baptistes contemporains, contaminées par le sacra-mentalisme ambiant. Les pentecôtistes, qui voient ici plus clair que lui, pourront lui renvoyer la balle.
Ah ! que n’a-t-il lu Dunn !
DUNN: le crible de l’exégèse
James Dunn n’étudie pas le pentecôtisme ; il étudie le Nouveau Testament. II scrute tous les textes qu’on peut verser au débat, avec deux interprétations à l’esprit : pentecôtiste d’un côté, sacra-mentaliste de l’autre. Pas un, me semble-t-il, n’échappe à son regard — et quel regard ! Pour l’acuité, pour la clarté, pour la vivacité, je ne crois pas avoir jamais rencontré son pareil. En pesant chaque fois toutes les possibilités, en n’avançant jamais sans assurer ses prises, Dunn atteste une connaissance impeccable des opinions diverses, et sans faire « acception des personnes » (sans se laisser impressionner par les « grands noms »). La rigueur faite exégèse ! Je le confesse : de mes lectures théologiques en dix ans, aucune ne m’a causé plus de joie.
La démonstration implacablement serrée de Dunn aboutit à des conclusions très fermes : ni chez Luc, ni chez Paul, ni ailleurs, le baptême du Saint-Esprit n’est une seconde expérience. Ce baptême (ou don) fait le chrétien : le rapport à la puissance est second, l’expérience est d’abord initiatrice. En outre, aucun rite ne confère le Saint-Esprit, et certainement pas le baptême d’eau. Le Nouveau Testament contrasterait plutôt les deux baptêmes : le premier est l’œuvre de Dieu ; le second, l’œuvre des hommes que Dieu a commandée. Le Saint-Esprit est donné à la seule foi, qui s’exprime, elle, dans le baptême d’eau. (A mon avis, Dunn pourrait mieux reconnaître le décalage inévitable entre la foi et son expression, mais j’accepte le reproche qu’il fait à la pratique baptiste de trop les séparer.)
Échappatoires barrées
Dunn combat avec la même efficacité sur sa droite et sur sa gauche. Cet article ne peut évoquer que sa controverse à gauche, avec le pentecôtisme.
Les pentecôtistes font appel à l’expérience de Jésus au Jourdain et à celle des apôtres à la Pentecôte : ils ont fait une seconde expérience, disent-ils, alors qu’ils avaient déjà l’Esprit. Dunn consacre deux chapitres à ce problème. II montre qu’il s’agit d’évènements de l’Histoire du Salut, sans répétition, et nullement d’un modèle pour la vie chrétienne. L’interprétation pentecôtiste révèle une tendance dangereuse : la tendance à remplacer, au cœur du Christianisme, la Nouvelle de l’Une-fois-pour-toutes par le schéma d’une expérience.
Pourchassant toute trace d’une séparation entre la naissance dans la foi et le baptême du Saint-Esprit, dans les Actes et dans les Épîtres, Dunn n’en trouve aucune. En revanche, plusieurs passages excluent cette pensée. Dunn bloque les échappatoires qu’ont imaginées des pentecôtistes. Ainsi, l’épisode « cornélien » (Actes 10-11) les gêne beaucoup : les uns ont suggéré que Corneille était déjà converti, mais Actes 11:14 montre le contraire ; d’autres ont voulu séparer le moment de la conversion (pendant le discours) et celui du baptême d’Esprit (après), mais c’est quand Corneille a saisi par la foi le pardon proposé qu’il a reçu l’Esprit ; d’autres, forcés d’admettre que les deux expériences ont été chez Corneille simultanées, ont soutenu qu’elles demeuraient différentes, mais la conclusion (Actes 11:16-18) emploie comme équivalentes les expressions : « Don du Saint-Esprit » et « Repentance pour-la vie ».
De même, la déclaration très explicite de Paul : « Nous avons tous été baptisés en un seul Esprit pour former un seul corps » (I Cor. 12:13) ne peut être déviée de son sens. Certains pentecôtistes ont voulu y voir un baptême par l’Esprit (de tous), différent du baptême dans l’Esprit (seconde expérience). D’autres voudraient traduire « en vue du » corps. Insoutenable, montre Dunn. On ne peut pas dire non plus qu’à Corinthe, par exception, tous avaient fait la seconde expérience car le tous répond à celui de l’adresse (1:2) : « Tous ceux qui, en quelque lieu que ce soit, invoquent le nom de notre Seigneur Jésus-Christ ». Certains pentecôtistes, las de ces vains efforts, adoptent une solution tout aussi désespérée, mais plus digne: à leur avis, Paul n’emploierait pas le mot comme les Évangiles et les Actes. C’est l’aveu que le texte de Paul ne cadre pas avec la doctrine pentecôtiste.
L’élucidation des énigmes
Dunn n’oublie pas les appuis traditionnels de l’argumentation pentecôtiste. II n’a pas de peine à montrer que les « certains disciples » d’Actes 19 (expression unique chez Luc) n’étaient pas des chrétiens, et que la question de Paul avait justement pour but de clarifier ce point « chrétiens ou non ? » ; ils ont reçu le Saint-Esprit, et non pas un surcroît de puissance, quand ils ont cru au Seigneur Jésus, comme Paul les y a exhortés.
Au seul texte réellement difficile (Actes 8), sous le titre « L’énigme de Samarie », Dunn consacre tout un chapitre très soigneux. De toute façon, le récit ne correspond pas au schéma pentecôtiste : c’est la première réception du Saint-Esprit qui a dû attendre la visite des apôtres, ce n’est pas une seconde expérience. Dunn relève toute une série d’indices dans le texte pour montrer que la foi des Samaritains n’avait été que superficielle et superstitieuse (comme celle de Simon ; cf. Jn. 2:23 s.). Sa solution ne me convainc pas totalement : elle ne rend pas assez compte de la visite spéciale de Pierre et Jean ; elle néglige le fait capital de l’affaire, l’ouverture de la Nouvelle Alliance aux Samaritains. Néanmoins, Dunn me persuade que Luc a évité de décrire la foi samaritaine suscitée par Philippe comme la vraie foi chrétienne ; les Samaritains n’étaient pas encore entrés dans le Royaume, que Pierre leur a ouvert.
Dunn, certes n’est pas infaillible. Deux fois, il avoue lui-même son hésitation : quand il traite de la prétendue « Pentecôte johannique, et du chapitre 6 aux Romains. Sur quelques points mineurs, j’ose donc — en tremblant — ne pas le suivre. La théologie d’ensemble qui se profile derrière l’exégèse ne paraît pas aussi solide que cette dernière : Dunn admet l’initiative de l’Esprit dans l’engendrement de la foi, mais comme à regret (pp. 94 s.) ; il reproche à l’orthodoxie d’avoir réduit l’expérience de l’Esprit à la Bible (p. 225). Parole ambigüe, et dangereuse dans son ambiguïté. Sur le baptême d’Esprit, cependant, les conclusions de Dunn, dix fois prouvées, ne risquent pas d’être réfutées.
Charismes éclatants
L’apôtre Paul prisait fort les charismes d’enseignement, de science et de sagesse. A coup sûr, ces charismes ont été donnés dans une mesure peu commune à nos deux auteurs, « pour le perfectionnement des saints ». Si quelqu’un se veut charismatique, il fera bien de ne pas mépriser leur don. Oui, un responsable chrétien qui rejetterait les conclusions de Dunn sans étudier ses preuves se rendrait coupable de légèreté.
Et pour les autres, pour nous qui nous rangeons du côté de nos auteurs, un rappel ! Si nous sommes persuadés d’avoir reçu avec le Christ le baptême de son Esprit, que Dieu nous préserve de l’embourgeoisement spirituel, de l’immobilité confortable ! Qu’il nous donne d’aspirer ardemment non à une « seconde expérience » particulière, mais au renouvellement journalier du Saint-Esprit, à sa plénitude-afflux et à sa plénitude-saturation, à ses dons les meilleurs, enfin — pour que le Père soit glorifié dans le corps spirituel de son Fils.
H.B.
Les seuls passages indubitables sont (a) Matt. 3 :11 (par.) et Actes 1 : 5 (visant la Pentecôte) ; (b) Actes 11:16 (à propos de Corneille); (c) I Cor. 12 :13 texte doctrinal).
En français, les livres bien connus d’E. Guers, G. Tophel, R. Pache, font des exposés plus généraux.
Frederick Dale Bruner, A Theology of the Holy Spirit, The Pentecostal Experience and the New Testament Witness (Londres : Hodder & Stoughton, 1970), 390 pp.
James D. G. Dunn, Baptism in the Holy Spirit, A Re-examination of the New Testament Teaching on the Spirit in Relation to Pentecostalism Today (SBT 15, Londres : SCM Press, 1970), 248 pp.
Je dois cette information au pasteur Samuel Dubois, qui résume un document officiel du mouvement de Mülheim, Foi et Réveil (n° 20, septembre 1967).
Bruner évite simplement ce problème. J’ai essayé de l’exposer et de proposer une solution dans ICHTHUS n° 14.